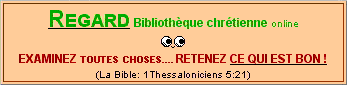
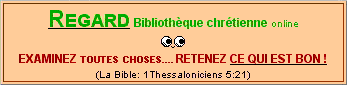
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU PROCHE-ORIENT. COMME LE COEUR DU MONDE, CET ENDROIT PALPITE EN TENSIONS INCESSANTES QUI RISQUENT DE DÉGÉNÉRER GRAVEMENT. LA PLACE ET L'IMPORTANCE D'ISRAEL DANS LE PLAN DIVIN NE SONT PAS ETRANGERES À CETTE AGITATION QUI SECOUE REGULIEREMENT LA RÉGION.
A la fin du mois de février, Israël a renoué avec le principe de la réplique immédiate à toute agression. L'Etat hébreu avait dérogé à cette tradition pendant la guerre du Golfe, en se soumettant à la pression des Etats-Unis. En s'attaquant à un camp militaire israélien proche de la Cisjordanie, dans la nuit du 14 au 15 février, le commando palestinien n'ignorait pas les risques qui en résulteraient; d'autant plus que l'opération fit 3 morts, 3 soldats exécutés à l'arme blanche (hache et couteau), de jeunes recrues immigrées de l'ex-URSS. «Tsahal», l'armée israélienne, répliqua en menant des raids au Sud-Liban dans deux camps de réfugiés palestiniens, puis sur une colonne de véhicules: cette réplique provoqua la mort d'une dizaine de personnes, dont celle du chef du Hezbollah pro-iranien, Cheikh Abbas Moussaoui, de sa femme et d'un de ses fils. L'émotion, côté arabe, se traduisit en désir de vengeance. D'où le cycle des représailles. A partir de rampes de lancement Katioucha disséminées au Sud du Liban, les Palestiniens «arrosèrent» de roquettes le nord d'Israël. Alors, pour la première fois depuis 1989, les Israéliens sortirent de «la zone de sécurité» qu'ils entretiennent au Sud-Liban pour atteindre des villages chiites abritant des combattants islamistes. Les puissances occidentales se sont bien sûr émues de cette incursion israélienne qui «violait» une nouvelle fois la souveraineté du Liban; c'est cependant sans réagir que ces mêmes Etats assistent au subtil effacement d'un Liban qui n'est plus que l'ombre de la Syrie!
De même, bien peu semblent s'étonner de la puissance du Hezbollah pro-iranien dont la vive résistance a surpris l'armée israélienne. Ces intégristes musulmans combattent avec le soutien de l'Iran qui, sorti de l'isolement des années «Khomeini», étend son influence de plus en plus loin et de plus en plus profondément. Le cheikh Nasrallah, qui a pris la succession d'Abbas Moussaoui, comme chef du Hezbollah, est un proche du président iranien Rafsandjani et, dans son premier discours, il n'a pas hésité à qualifier Israël de «cancer». Du Soudan aux républiques musulmanes de l'ancien empire soviétique, les dirigeants iraniens tissent leur filet, avec un grand sens de l'opportunité: leur désir de respectabilité les a même conduit à réactiver l'ECO, l'Organisation de la coopération économique, une structure régionale qui regroupait la Turquie et le Pakistan, outre l'Iran, et qui vient d'accueillir l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, en attendant le Tadjikistan et la Kirgizie.
Les Israéliens discernent les enjeux diplomatiques derrière ces manoeuvres de regroupement «économique». Pendant la poursuite des discussions sur la paix au Proche-Orient, une sourde pression islamiste tente, en coulisse, de nuire à la stabilité et à la sécurité de l'Etat hébreu. Quand les chars de Tsahal bousculent les véhicules de l'ONU, le monde s'émeut et accuse Israël de vouloir gripper l'engrenage de la paix. Mais des forces moins visibles hypothèquent davantage ces espoirs de paix. La Bible prophétise clairement l'isolement d'Israël face à une coalition de plusieurs nations armées (Ezéchiel 38, 15 et 16). Tout se met en place, peu à peu, presqu'imperceptiblement. Y compris sur la terre même d'Israël, où le camp des «colombes» a subi un revers. Dans la perspective des élections du 23 juin, le parti travailliste a en effet durci son image en désignant un nouveau leader pour contrer le Premier ministre Ytzhak Shamir: Yitzhak Rabin a été préféré à Shimon Peres, parce qu'il est davantage perçu comme un ardent défenseur de la sécurité du pays. Pour beaucoup de ses concitoyens, Rabin reste le chef de l'Etat-major israélien victorieux de la guerre des Six jours, en juin 1967. Shamir n'aura donc pas le monopole de la fermeté pendant la campagne électorale. Le parti travailliste devrait récupérer les suffrages d'indécis et de «déçus» du Likoud, même s'il perd les voix d'électeurs de gauche prêts à accepter davantage de concessions pour la paix. Le débat électoral s'annonce donc plus indécis et plus passionnant que jamais, surtout dans le contexte du processus de paix, avec, aussi, 2 inconnues: 250 000 nouveaux électeurs venus de l'ex-URSS et 250 000 jeunes se rendront aux urnes pour la première fois. Mais d'ici le 23 juin, il peut encore couler beaucoup d'eau sous les ponts du Jourdain...
M. Béghin
AVENEMENT Mars 1992 No 41 / P 14