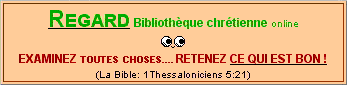
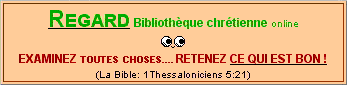
Les élections à la Knesset intéressent le monde entier
LE 23 JUIN, LES ISRAÉLIENS SE RENDRONT AUX URNES POUR ÉLIRE LES 120 MEMBRES DE LA KNESSET, LE PARLEMENT ISRAÉLIEN. TRENTE FORMATIONS POLITIQUES SE DISPUTENT LES SUFFRAGES DES ÉLECTEURS. LE RÉSULTAT S'ANNONCE EN TOUT CAS DES PLUS SERRÉS.
Les partis désireux de prendre part aux élections avaient 2 jours, les 18 et 19 mai, pour s'inscrire devant le comité électoral et déposer leurs listes de candidats. Les représentants des listes nouvelles ont passé la nuit précédant l'ouverture des inscriptions dans le jardin qui fait face à la Knesset pour être parmi les premiers reçus au comité électoral et les premiers à choisir les lettres de l'alphabet hébreu qui représenteront leur parti. Un humoriste des années 50 avait noté qu'une campagne électorale en Israël pouvait ressembler à une campagne de lutte contre l'analphabétisme: les murs des villes sont recouverts d'affiches ou de graffitis représentant toutes les lettres de l'alphabet, isolées ou groupées (l'alphabet hébreu ne comptant que 22 lettres, il a fallu attribuer à plusieurs partis un ensemble de lettres: alef-mem-tav pour le parti travailliste, mem-het-lamed pour le Likoud).
En Israël, comme dans beaucoup de démocraties, les listes nouvelles pullulent (15 sur les trente inscrites) et la plupart n'obtiendront même pas le minimum de voix nécessaire pour être représentées: 1,5%, soit 40 000 suffrages. Parmi ces listes, relevons: le parti des chauffeurs de taxis, celui du Royaume d'Israël (dont le programme est de rebâtir le Temple), le parti de la femme (féministe, bien entendu), celui des victimes des intérêts hypothécaires élevés, le parti de l'espoir (des quartiers déshérités), deux partis de nouveaux immigrants russes, deux partis s'affirmant héritiers spirituels du rabbin terroriste Kahana assassiné aux Etats-Unis en 1990, le parti d'un fabricant de salades en boîtes, Picanti (qui part en guerre contre le fisc) etc.
Le nouveau parti libéral de Yitzak Modaï, ancien membre du Likoud, a des chances d'obtenir quelques mandats. L'extrême-droite est plus fragmentée que jamais: à Moledet, Tehiyya et Tsomet s'ajoutent le parti de «I'Etat de Judée» (contre la restitution des territoires), le parti du rabbin Levinger d'Hébron et les deux partis disciples de Kahana. Chez les orthodoxes, on assiste à un regroupement et à des divisions.
Regroupement: Agoudate Israël, Deguel Hatorah et Moriah (la nouvelle formation du rabbin Perets, ancien membre de Shass) s'unissent pour former un parti unique, Yahadoute Hatorah (le judaïsme de la Torah); divisions: le parti Shass reste autonome, tandis que deux rabbins orthodoxes instaurent, chacun de son côté, un nouveau parti.
Regroupement encore du côté de l'extrême-gauche: Shinouï, Rats, et Mapam fusionnent et constituent le parti Merets («énergie», mélange des consonnes de Rats et de Mapam). Division, en revanche, du côté arabe, où plusieurs partis se constituent autour de personnalités politiques indépendantes.
La campagne est chaude, voire même violente en certains endroits, lorsque les agitateurs de l'un des deux grands partis vont déranger les réunions électorales de l'autre, malgré l'appel au calme du président Herzog et de plusieurs personnalités. C'est que l'enjeu de la campagne est de taille: l'avenir des territoires, des implantations, du statut de Jérusalem, même si, en fait, les décisions réelles se prendront à Washington ou ailleurs. L'incertitude quant aux réactions de l'électorat israélien, contribue également à faire monter la tension. Alors qu'en décembre dernier les sondages d'opinion attribuaient au Likoud une supériorité écrasante sur le Ma'arach (parti travailliste), en mai les deux blocs adverses semblaient s'équilibrer. Des querelles intestines ont affaibli le Likoud, tandis que le Ma'arach, en mettant comme tête de liste le général vainqueur de la guerre des Six-jours, Yitz'ak Rabin, a partiellement rassuré une partie des électeurs déconcertés par la personnalité versatile de Shimon Pères et troublés par la puissante représentation des «colombes» dans la liste travailliste.
Avec sarcasme, les commentateurs politiques soulignent que si les dirigeants du Likoud ont tout fait pour nuire à leur propre parti par leurs luttes internes sans fin, leurs adversaires, en Israël comme à l'étranger, ont tout fait pour voler au secours du Likoud: les travaillistes en présentant un grand nombre de candidats teintés d'une gauche radicale, l'OLP en demandant aux citoyens arabes d'Israël de soutenir Rabin; les Etats-Unis en ne cachant pas, eux non plus, leur préférence pour le parti travailliste et en faisant toutes sortes de tracasseries à Israël sur les plans économique et diplomatique: réduction de l'aide financière, refus de garantir les prêts, accusations vaines (l'enquête menée en Israël par les Américains eux-mêmes l'a démontré) selon laquelle Israël aurait vendu à la Chine le savoir-faire technologique américain dans le domaine des fusées, et en ressuscitant la fameuse résolution 194 de l'ONU sur le droit de retour des Palestiniens sur les terres qu'ils avaient abandonnées en 1948.
Cette affaire est suffisamment exemplaire des liens entre l'histoire et le présent et des rapports entre Israël et l'opinion internationale pour que nous l'examinions en détail. Pendant les premiers mois de la guerre d'indépendance, alors que les combats faisaient encore rage et que la situation dans la région demeurait confuse, une résolution fut votée à l'ONU, dans laquelle était affirmé le droit des «Palestiniens» (c'est-à-dire des Arabes qui avaient quitté leurs terres avant les combats, ou au début de ces combats) à retourner chez eux. Nul ne pouvait prévoir, à l'époque, l'intensité de l'hostilité arabe envers le nouvel Etat, ni le flot de réfugiés juifs que ce «nouveau-né» dut accueillir en provenance des pays arabes où ils abandonnaient tous leurs biens pour fuir la persécution et sauver leur vie. Combien de Palestiniens étaient concernés par cette résolution de l'ONU? Les chiffres les plus incroyables ont été avancés, certains dépassant de loin le total de la population arabe en Palestine britannique en 1948! Se basant sur les statistiques connues et sur l'estimation du nombre d'habitants des localités arabes abandonnées, les sources israéliennes estiment que le nombre des réfugiés arabes palestiniens de l'époque se situe entre 350 000 et 500 000. Ces réfugiés ont abandonné en grande partie des villages pauvres ou des quartiers déshérités des grandes villes du pays. Ce qui est certain, en revanche, c'est que 800 000 juifs en provenance des pays arabes ont dû laisser derrière eux des demeures souvent fastueuses et des entreprises florissantes dans les pays arabes où ils ont vécu pendant des siècles. C'est une des raisons pour laquelle les gouvernements israéliens, quelle que soit leur couleur, ont toujours refusé la réintégration massive des réfugiés palestiniens, exhortant les gouvernements arabes à prendre soin de leurs réfugiés comme l'Etat juif a pris soin des siens... Entre-temps, le nombre de réfugiés palestiniens, parqués, au début, dans des camps exigus par leurs frères arabes et entretenus par l'UNWRA (l'organisation d'aide des nations Unies aux réfugiés) s'est accru; à eux se sont joints un nombre indéterminé d'Arabes locaux désireux de bénéficier du soutien financier international.
Au total, les personnes portant le qualificatif de «réfugiés palestiniens» sont estimées à plusieurs millions. Le bon sens et la réflexion historique permettent de dénoncer l'invraisemblance de ce gonflement démographique. Ces réfugiés se trouvent dispersés dans tous les pays arabes du Moyen-Orient, où beaucoup d'entr'eux, quittant la promiscuité des camps, se sont intégrés dans la société arabe locale et ont réussi, grâce, notamment, à l'instruction et à la formation professionnelle reçues pendant leur jeunesse en Palestine britannique. Cette population, dont on ne peut remettre en cause l'aspiration légitime à une vie décente, est foncièrement hostile à l'Etat d'Israël et à tout ce qui touche au judaïsme. C'est une autre raison qui explique le fait qu'aucun gouvernement israélien, de gauche comme de droite, n'est prêt à se laisser submerger par ces millions d'ennemis déclarés. Cela signifierait simplement l'élimination physique de l'Etat d'Israël...
L'attitude des Etats-Unis à propos de cette affaire est d'autant plus surprenante que l'un des arguments utilisés par Washington pour tenter de convaincre Israël de faire des concessions territoriales importantes était précisément d'affirmer que les Etats arabes et les dirigeants palestiniens avaient, de fait, abandonné l'idée du «droit au retour». Alors pourquoi Margaret Tutwiler, porte-parole du département d'Etat américain, a-t-elle ressorti de l'ombre cette résolution 194 vieille de 44 ans?
Au fil des déclarations et des mises au point, les conseillers du président Bush n'ont fait que s'embrouiller davantage. La dernière déclaration de Margaret Tutwiler se veut formelle: seules les résolutions 242 et 338 de l'ONU forment le cadre du processus de paix actuel.
Pour Washington, l'affaire est close. Mais l'administration du président Bush ne pouvait mieux faire si son intention était de nuire à la gauche israélienne. De l'extrême-gauche à l'extrême-droite, tous les citoyens israéliens ont été choqués par les déclarations de Madame Intweiler selon lesquelles les Etats-Unis continueraient à appuyer la résolution 194. Ceux qui rêvaient d'un changement d'attitude de la part des gouvernements arabes se sont brusquement réveillés: ils ont pu constater que les bases de la diplomatie arabe n'ont pas changé et que l'administration américaine semble s'en accommoder. La position des pacifistes généreux, prêts aux concessions maximales, s'est révélée fragile, reposant sur des rêves et des espoirs plus que sur des faits politiques nouveaux.
Un événement de dernière heure peut encore influencer l'électorat israélien dans un sens ou dans un autre. Ce pourrait être, par exemple, un attentat terroriste spectaculaire, ou une déclaration maladroite d'un politicien israélien. Nous en saurons davantage au lendemain du scrutin. Une chose est certaine: la pression du monde, en particulier du monde occidental, sur Israël n'ira pas en décroissant, d'ici au 23 juin, et, quelle que soit la ligne idéologique du gouvernement qui sortira des urnes, il aura à affronter des temps difficiles.
De Jérusalem, Henri-Léon Vaucher
AVENEMENT Juin 1992 No 47 / P 5