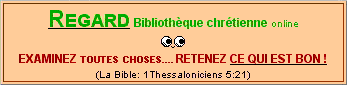
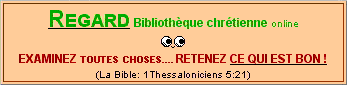
Une certaine «malédiction» plane sur ce lieu d'horreur
De Noach Klieger
Alors que notre bus roulait en direction d'Auschwitz, Shlomo Lahat et ses compagnons de voyage, membres du conseil municipal de Tel Aviv, me prièrent de parler du camp que nous allions visiter. Une violente tempête de neige s'abattit sur la région, ce qui rendit notre voyage très difficile. Je fis de mon mieux pour expliquer à quoi avaient servi ces camps, comment ils avaient été construits et quelles méthodes on y avait employées, non seulement dans celui-ci, mais encore dans des douzaines d'autres camps semblables, dans le but d'aboutir rapidement à la «solution finale» de la question juive, selon l'expression des Allemands. Je relatai mon premier jour à Auschwitz, je leur parlai des innombrables compagnons de sort qui ne revenaient plus, j'essayai de décrire avec exactitude les affreuses conditions pour lesquelles le plus grand génie n'aurait pu trouver de paroles, parce que le langage humain ne suffit pas pour en faire la description.
Je commentai, je dépeignis des situations et répondis aux questions tout au long du trajet. Pendant ce temps, le bus s'approchait du lieu d'horreur qui est de nouveau appelé Oswiecim, comme avant l'occupation allemande.
Mes compagnons de voyage m'écoutaient attentivement. Ils purent entendre chaque syllabe mais ils furent incapables d'en saisir tout le sens. De toute façon, cela aurait été impossible. Le cerveau humain le plus sensible, le plus éveillé et le plus capable de fantaisie n'aurait Pu s'imaginer ces choses. Quelqu'un qui n'a jamais été témoin oculaire de telles horreurs, n'est pas en mesure d'assimiler ce qui s'est passé là-bas, à Oswiecim et dans les autres camps d'extermination où oeuvraient les monstres du Reich, représentants de la «race des Seigneurs», les ennemis des Juifs - ces «criminels».
Gris, froid et repoussant
Nous arrivâmes à Oswiecim. Nous y trouvâmes le gel, la neige, le brouillard et les ténèbres en plein jour! Ces mêmes caractéristiques sont restées gravées dans ma mémoire depuis le temps de mon internement. A cette époque, certains ne devaient pas être exécutés dans les premiers jours qui suivaient afin de «servir productivement lors de l'entrée en action du Reich la quatrième année de la guerre».
Gris, brouillardeux, froid, repoussant comme si Dieu avait maudit cet horrible endroit pour toujours.
Environ deux douzaines d'hommes et de femmes, tous d'âge mûr, participaient à cette «excursion». Il y avait quelques hauts officiers de Tsahal, vétérans des guerres d'Israël. Avec eux, des anciens combattants du mouvement clandestin qui avait lutté contre les Anglais. Il y avait aussi des réchappés de l'holocauste de divers camps et ghettos, des écrivains et des scientifiques, des religieux et des mondains. Tous suivaient notre guide professionnel, une femme, qui relatait d'une voix monotone l'exécution des nombreux Juifs. Elle parlait comme s'il s'agissait d'un musée où d'un endroit historique: «Ici dans le bloc 4, les médecins allemands ont exécuté leur travail expérimental ... Voici l'endroit où on entassa les cheveux des femmes et des enfants ... Contre ce murs, les détenus ont été fusillés ... ici, tous les jours ... des êtres humains brûlés.»
Tous la suivaient, l'écoutaient sans pouvoir vraiment comprendre. Non, ils ne pouvaient pas saisir pleinement de quoi il s'agissait. Je savais que la réaction se ferait plus tard, comme après un gros choc.
Je m'éloignai un peu du groupe. Je n'avais pas besoin d'écouter cet exposé quand bien même il était exact historiquement. Je savais par expérience comment les choses s'étaient passées ici.
«On ne peut y croire»
Je flânai entre les bâtiments en passant aussi devant la petite hutte où le «responsable des rapports» Kaduk recevait les rapports de ses subordonnés qui devaient compter les détenus. Au camp, le mot «règlement» était écrit en grosses lettres - un avant-goût du «nouveau règlement» que les Allemands voulaient introduire dans le monde!
Je m'approchai du bloc 27, actuellement le musée consacré à l'acheminement douloureux des Juifs. Mes compagnons s'y trouvaient déjà. On les pria d'inscrire leurs noms dans le «livre d'hôte», mais tous n'eurent pas le courage de la faire. Beaucoup laissèrent libre cours aux larmes. Ils répétaient sans cesse: «On ne peut y croire!» Le cerveau ne pouvait assimiler ce que voyaient les yeux.
Effondrement au crématoire
Nous nous retrouvâmes ensuite au crématoire. La machine d'incinération est toujours là. Tout le monde était très pâle. Des crises de larmes et des sanglots déchirèrent le silence et remplirent le bâtiment. Le remplaçant du maire de Tel Aviv, Chaïm Basuk, sortit un livre de Psaumes de sa poche et commença à lire à haute voix. Tout à coup, il perdit connaissance et tomba de tout son long. Les efforts, les émotions et la douleur - ce fut trop pour lui.
Voici le portail par lequel on avait fait passer tous les «transports» venant d'Allemagne, de Grèce, de France, de Russie, de Hollande, du Danemark, d'Italie, de Tchécoslovaquie, de Belgique, de Hongrie, de Roumanie et de Pologne.
Les arrivants de ces «transports» organisés depuis au moins une douzaine de pays d'Europe, étaient dirigés vers une surface bétonnée de plusieurs centaines de mètres de long qui, pour la plupart d'entre eux, allait être la dernière station avant la «cheminée» comme on appelait l'acte d'extermination dans les chambres à gaz, pratiqué à côté de l'incinération des cadavres. Et voici, l'immense étendue recouverte de bourbe sur laquelle des centaines de huttes avaient été construites pour ceux qui avaient la «chance» de travailler pendant quelques semaines ou mois avant de passer par la «rampe», à l'exemple de leurs compagnons.
Des couronnes et des larmes
On peut encore voir les vestiges des chambres à gaz et les immenses fours crématoires qui avaient permis au chef du camp, Rudolf Hess, et à ses subordonnés meurtriers, de maîtriser efficacement «l'offre excessive de mains-d'oeuvre» arrivant chaque jour au camp. Toutes ces installations furent dynamitées par les Allemands lorsqu'ils reconnurent enfin que leur rêve du «règne de mille ans» était une utopie.
La place existe encore d'où le «commandant du Reich», Heinrich Himmler, et ses bourreaux avec, à leur tête, le «Obersturmbannführer», Adolf Eichmann, pouvaient observer le travail énergique de Hess et de ses gens, et leur faire des compliments.
Au fond de la «rampe», les Polonais ont érigé un monument en souvenir des millions de victimes du camp. A côté du monument, on voit des plaques commémoratives avec des inscriptions dans les différentes langues des exécutés, entre autres le yiddisch et l'hébreu. Nous déposâmes une couronne près de la plaque à l'inscription hébraïque. Personne ne chercha à lire le Tehelin (Psaume) ou de dire un Kaddisch (prière pour les morts). On ne pouvait plus cacher ses larmes, son émotion et son profond bouleversement.
Ainsi, nous restâmes là, dans le silence, pendant quelques minutes. De temps en temps on entendait des sanglots. Notre guide avait arrêté son flot d'explications depuis longtemps. Elle avait compris que tout commentaire était superflu.
Silence général
Silencieusement, nous retournâmes vers le bus qui s'éloigna lentement de ce lieu lequel, certes, est le plus maudit dans l'histoire de l'humanité.
J'observai mes compagnons de voyage - dont la plupart étaient des membres du conseil municipal de Tel Aviv. Ils étaient assis, le visage fermé, ne trouvant pas de paroles pour tout ce que leurs yeux venaient de voir. Nous roulâmes longtemps, enfermés dans un profond silence. Finalement, Nawa Semer me dit: «Ce n'est que maintenant que je comprends ce dont vous avez parlé tout à l'heure.» Et R.A. Basuk ajouta: «Une visite à Auschwitz change complètement un homme.»
Nouvelles d'Israël 11 / 1983