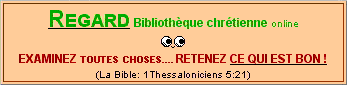
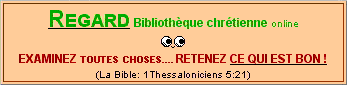
Continuellement à la recherche d'eau, les scientifiques israéliens se sont orientés vers le sol, les rochers et le ciel pour «presser l'éponge jusqu'à la dernière goutte».
«L Eternel dit à Moïse: ... tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira.»
Cet ordre biblique relaté dans le livre de l'Exode a permis au peuple juif assoiffé d'arriver à bout de sa marche de 40 ans dans le désert du Sinaï. L'Israël moderne aussi a frappé le rocher et obtenu de beaux résultats. Il a transformé la recherche d'eau en une science très développée. Il y a 50 ans, on était convaincu qu'à cause de son climat sec, le pays ne pourrait absorber plus d'un million d'habitants. Aujourd'hui, la population en compte plus de quatre millions et augmente toujours. Bien que le soixante pour-cent de la surface d'Israël soit désertique, les habitants ne souffrent pas du manque d'eau. Et quoique la pluie ne tombe seulement qu'en hiver et dans les régions montagneuses au nord du pays, l'irrigation pendant toute l'année permet une végétation vivace, même dans les contrées désertiques du sud. Un ingénieur australien disait, plein d'admiration: «Israël arrive à presser l'éponge jusqu'à la dernière goutte.» C'est dans un bureau installé dans une cave qu'Israël commença ses efforts afin de faire fleurir le désert et de faire couler l'eau du robinet. A la veille de la deuxième guerre mondiale le jeune Levi Eschkol, planificateur d'implantations dans une région à l'époque sous mandat britannique, reconnut que la barrière à une immigration en Palestine n'était pas le pays lui-même, mais le manque d'eau. C'est pourquoi, avec cinq ingénieurs et techniciens, il créa l'association Mekorot chargée de l'approvisionnement en eau. Cette association se développa rapidement. Leur première tâche difficile était de diriger l'eau qui sortait de quatre puits 40 kilomètres plus loin, vers un collectif agricoles Ce projet qui avait pu être réalisé dans le délai fixé, remplit Eschkol et ses collaborateurs d'un optimisme imperturbable.
Deux ans plus tard, Eschkol quitta la Mekorot pour emprunter la voie de la politique qui le conduisit, dans les années soixante, au rang de Premier ministre. Malgré tout, il ne perdait pas de vue l'importance de la Mekorot. En qualité de conseiller de Ben Gourion, destiné à devenir le Premier ministre d'Israël, il surveillait, en 1946, le transfert d'une conduite d'eau de 250 kilomètres qui devait alimenter douze nouvelles implantations dans les régions éloignées du désert. Ce qui ajoutait aux difficultés, c'est que la conduite devait être posée la nuit, à cause de la police britannique ou des Arabes. Cependant, la Mekorot surmonta aussi ce problème.
Pendant la guerre d'indépendance, lorsque des unités arabes occupaient deux stations de pompage d'importance vitale près de Jérusalem, on pouvait se reporter aux expériences du travail nocturne. Dans la course contre la montre, Eschkol détacha 200 soldats pour son service personnel. Alternativement, ils combattaient et installaient une conduite d'eau dirigée vers une source à une distance de 24 kilomètres. Cette nouvelle conduite rejoignit la ville juste avant le dessèchement total des citernes.
Des trésors souterrains
De tels efforts isolés, aussi impressionnants soient-ils, n'étaient qu'une préparation insuffisante à l'exigence de la tâche qui s'approchait de la Mekorot, lorsqu'Israël acquit son indépendance. Un examen hydrologique confirma l'extrême pauvreté en eau. Seulement trois rivières et une vingtaine de ruisseaux parfois secs traversaient les régions du pays non désertique. Cependant, Israël dispose d'un trésor d'une grande valeur, celui de 90 milliards de mètres cubes d'eau accumulés dans deux gisements rocheux, lesdites couches aquifères. L'une s'étend sur une centaine de kilomètres sous la côte méditerranéenne, l'autre sur 140 kilomètres juste derrière la côte. Cependant, la découverte de ce trésor n'était pas sans risques.
La Mekorot prévoyait dans son plan une utilisation jusqu'à l'extrême des couches aquifères, en créant un réseau d'eau d'une longueur de 350 kilomètres pour tout le pays.' Ce réseau composé de tuyaux et de canaux était destiné à alimenter, avec l'eau douce du lac de Génésareth, les communes grandissantes d'Israël et les régions agricoles du sud. Aron Wiener, l'un des ingénieurs dirigeants des débuts de la Mekorot se souvient: «En même temps il nous fallait installer une industrie fabriquant des tuyaux et des pompes, et trouver des entrepreneurs capables de venir à bout de l'une des plus grandes performances technologiques du Proche-Orient.»
Au début, personne ne savait combien d'eau on pouvait tirer des pompes. En épuisant trop rapidement l'eau douce, l'eau salée pouvait s'infiltrer et détériorer les eaux souterraines en Israël. Tout en étant conscients de ce danger, les ingénieurs recouvraient le pays par un ensemble de puits. Rien que le long de la côte, on en comptait plus de mille. Cela permit aux paysans de quintupler l'irrigation. Seulement, les effets secondaires redoutés se firent sentir. A mesure que la pression souterraine faiblissait, l'eau de la mer s'infiltrait dans les couches de grès près de la côte. L'eau de Tel Aviv devint salée.
Là-dessus, Wiener creusa plusieurs puits à l'est de Tel Aviv, près des sources du fleuve Yarkon, et pompa une partie de l'eau douce vers la ville.
Cette disposition fit tarir les sources du Yarkon, mais en même temps, le niveau d'eau souterrain baissait suffisamment pour rendre possible, à la période de la pluie, une récupération de 100 millions de mètres cubes d'eau qui, faute de quoi, aurait coulé dans la mer. Par ce système, la pression de l'eau souterraine dans la zone de Tel Aviv fut rétablie et l'infiltration d'eau salée stoppée.
Système flexible
Lorsque, en 1952 le problème des réservoirs d'eau fut résolu, la Mekorot se consacra à la canalisation d'eau du pays. Mais au moment où les bulldozers au nord du lac de Génésareth voulaient commencer leurs travaux près de la digue et du canal de dérivation, ils furent bloqués par les feux d'artillerie venant de l'autre côté de la frontière syrienne. Les Syriens prétendaient que les travaux de dérivation étaient une violation du traité sur la zone démilitarisée entre les deux pays. C'est pourquoi, les Israéliens firent déplacer le projet directement à proximité du lac de Génésareth. Seulement, ce dernier était situé à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui aurait obligé une grande partie de l'eau à franchir une dénivellation de 400 mètres avant d'arriver à son lieu de destination.
Le déplacement s'avéra plus coûteux que prévu. Rien que le pompage des 450 millions de mètres cubes d'eau en direction des régions agricoles situées plus haut que la côte, dévora 8 pour cent de l'électricité du pays. D'autre part, pour protéger la station de pompage de l'artillerie syrienne, les israéliens l'avaient transférée dans une montagne, ce qui nécessita un encastrement dans du béton armé. 4000 ouvriers et des douzaines d'ingénieurs travaillèrent pendant six ans à ce formidable projet. Lorsqu'il fut enfin terminé, Israël pouvait couvrir un quart de ses besoins en eau.
La station de pompage entièrement automatique placée dans une grotte artificielle de 80 mètres sur 20, est munie de trois pompes de 30 000 PS chacune, qui aspirent 6,7 mètres cubes d'eau par seconde, du lac vers un canal situé à plusieurs centaines de mètres plus haut. Cette eau s'écoule dans le réservoir Eschkolsee où elle est chlorée. De là, elle est dirigée d'une station de pompage à l'autre. Tous les puits de la côte ainsi que les canalisations principales au sud de Beersheba peuvent être alimentés de cette façon. Un réseau de petits tuyaux conduit l'eau jusqu'à Mitzpé Ramon situé à 70 kilomètres plus au sud encore.
Ce système est extrêmement flexible. La conduite d'eau est munie de valves de réglage près des points stratégiques, capables de provoquer un arrêt d'eau total. Les gens de la Mekorot arrivent à faire couler l'eau non seulement dans toutes les directions, mais aussi à la surface comme par voie souterraine. C'est pourquoi, ils sont en mesure de réalimenter les réserves souterraines avec l'eau de pluie excédentaire qui s'accumule dans le lac de Génésareth jusqu'à, 100 000 mètres cubes). L'eau est dirigée dans les puits le long de la côte ou dans de grands étangs sableux, à travers lesquels elle peut s'infiltrer jusque dans les couches rocheuses souterraines.
Chasse après les nuages
Après avoir rendu accessibles les réserves d'eau de la Galilée, la Mekorot avait pour second but le ciel. Les Israéliens cherchaient, par une technique améliorée de «vaccination» des nuages, à diriger la pluie dans les montagnes de la Galilée. D'abord ils installèrent des stations de radars sur la côte pour dépister les nuages de pluie dans le nord et au centre d'Israël. En collaboration avec des savants de l'université hébraïque à Jérusalem, les météorologues s'efforçaient de découvrir où et à quel moment il fallait arroser d'iodure d'argent les nuages pour déclencher une averse de pluie. Ce travail dangereux était exécuté par des pilotes avertis qui, installés dans des machines d'apparence fragile, s'enfonçaient dans la tempête déchaînée afin d'arroser la première couche du nuage.
En 1979, cette technique était développée à tel point que les précipitations avaient augmenté de 17 pour cent au-dessus de la dépression d'Houla.
Tandis que les hydrologues de la Mekorot multipliaient leurs recherches d'eau, des groupes de botanistes et d'ingénieurs s'efforçaient d'utiliser chaque goutte d'eau de la meilleure façon. Le succès le plus spectaculaire fut le développement de l'irrigation par gouttes, par laquelle l'eau pouvait être expédiée tout près des racines par le moyen de tuyaux perforés en plastique. Cette méthode empêche l'évaporation, économise 20 pour-cent de l'eau que les plantes absorbent ordinairement et augmente le rendement. Un autre progrès dans la technologie agricole en Israël est le système informatique conçu spécialement, lié à des appareils sensitifs dans les champs et réglant l'irrigation selon l'humidité du sol, la température, l'humidité et les mouvements de l'air. L'un de ces appareils de la grandeur d'une armoire est installé au Kibboutz Na'an dans le centre du pays. Il permet de distribuer chaque année 2,5 millions de mètres cubes d'eau sur une distance de 375 kilomètres et d'arroser les orangeraies, les champs de coton, d'avocats et de betteraves sucrières.
Lorsque Ran Dinur, kibboutznik robuste de 30 ans, se rend à 17 heures auprès de l'ordinateur, il contrôle les dates imprimées, qui lui révèlent si les champs arrosés pendant la nuit ont eu leur ration, ou s'il y a eu un dérangement quelconque.
Après avoir vérifié les conditions des produits du champ, il communique les instructions du jour à l'ordinateur. Dinur dit en souriant: «Après la programmation du système, je peux aller faire de la natation ou danser. Je sais que nulle part une seule goutte d'eau n'est gaspillée.» Une grande carte de la région du kibboutz munie de lampes clignotantes jaunes et rouges, indique lesquelles des 30 valves distribuent de l'eau aux dispositifs de gouttes ou aux installations d'arrosage. Au cas où un tuyau serait poreux ou que la pression d'eau monterait ou diminuerait, une lampe rouge s'allume et le système s'arrête automatiquement. Si, à ce moment, Dinur était absent, l'ordinateur déclenche un sifflement. Dans le domaine de Dinur, le système informatique irrigue 550 hectares de coton avec près de 15 pour-cent moins d'eau par hectare qu'il y a quatre ans.
Apprendre des ancêtres
Pendant ce temps, des hydrologues cherchent d'autres éponges leur fournissant l'eau pour irriguer les 12 000 kilomètres carrés du Negev. La moyenne annuelle des précipitations sur cette surface desséchée, qui prend plus de la moitié du territoire de l'Etat, est de 200 millimètres, donc seulement la moitié du minimum nécessaire pour une agriculture conventionnelle.
Le professeur Michaël Evenari, botaniste âgé de 70 ans et très considéré, est un peu le Moïse d'aujourd'hui. Lorsque, vers le milieu des années trente, il voyageait dans le désert du Negev, il tomba sur des vestiges d'anciennes implantations agricoles qui, il y a 2000 ans, avaient nourri 100 000 Nabatéens. A l'époque, il était possible de planter tout ce dont ils avaient besoin en utilisant un secteur de pluie 20 à 30 fois la dimension de leurs champs. Plus tard, Evenari rétablit les étangs et barrages qu'avaient installés les habitants autrefois, afin de capter l'eau qui coulait des collines en hiver. Ensuite il remit deux anciens domaines en état d'exploitation et planta du blé, de l'orge, des légumes et des arbres fruitiers. En quelques années, ses champs et vergers se détachaient comme des émeraudes de la couleur ocre du paysage infructueux. Les rendements - principalement des pistaches et des amandes - pouvaient se mesurer avec la plupart de ceux des autres parties du pays. «Un arrosage par l'eau de surface s'est toujours avéré rentable», dit Evenari.
Issar Ari, hydrologue à l'institut de recherche du désert de l'université Ben-Gourion, profite aussi des expériences du passé pour assurer l'avenir du Negev. En examinant une découverte faite il y a 14 ans - en 1968, l'armée israélienne avait trouvé une source de pétrole épuisée dans le Sinaï qui, de façon inexplicable, était remplie d'eau - il établit la théorie que l'eau devait arriver par une couche étendue conduisant l'eau, et qui se remplissait régulièrement au moment des précipitations jusqu'à une époque, il y a des milliers d'années, où le climat changea. Des sondages d'essai laissent supposer que lesdites couches de grès nubien contiennent probablement 200 milliards de mètres cubes d'eau qui, partiellement, pourront être utilisés pour l'irrigation. Un tiers se trouve sous le désert du Negev. Issar évalua qu'avec cette eau, plusieurs villes du Negev pourraient être approvisionnées pendant 300 ans.
Je demandai au savant ce qui arrivera lorsque l'eau sera épuisée? Il me répondit sans hésiter: «Il y a d'autres réserves d'eau, plus grandes encore, sous le grès. On peut trouver de l'eau sous la plupart des déserts, si l'on emploie toute son énergie pour en trouver.»
C'est exactement ce genre d'optimisme qui a fait réussir son peuple depuis le temps de Moïse. (tiré de «Das Beste»)
Milan J. Kubic
Nouvelles d'Israël 02 / 1984