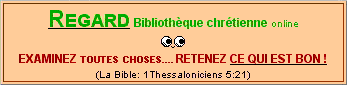
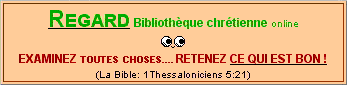
L'originalité de la société israélienne permet une vie politique étonnante pour les Occidentaux
Près de deux siècles d'expérience démocratique ont formé les occidentaux à penser en matière de politique selon un axe de catégories allant de la droite à la gauche. Toutes les opinions touchant aux affaires publiques, aussi variées soient-elles s'alignent sur cet axe unique de coordonnées: les cadres ecclésiastiques, la population paysanne et l'aristocratie étant généralement confondues avec la droite conservatrice, la bourgeoisie avec les milieux libéraux, le «prolétariat ouvrier» et une partie des intellectuels avec la gauche progressiste ou révolutionnaire. De nos jours, ce schéma simpliste parait déjà partiellement anachronique, nombre de théologiens et de prélats se situant idéologiquement à gauche, nombre d'ouvriers et d'employés votant pour des partis de droite.
Appliqué au tiers-monde, ce schéma se révèle inadéquat: où faut-il situer par exemple l'intégrisme musulman? Quel est son contraire, une gauche marxiste ou une droite libérale? Dans la vie politique israélienne, la situation est encore plus compliquée, et une certaine confusion règne dans les médias occidentaux à ce sujet, où l'on parle par exemple de Juifs ultra-orthodoxes d'extrême-droite, ce qui est une absurdité, comme nous le verrons. Pour clarifier les idées, considérons l'espace politique israélien selon trois axes de coordonnées, indépendants les uns des autres, générateurs de toute une série de combinaisons possibles.
L'AXE RELIGIEUX - ANTI-RELIGIEUX
A l'extrême «droite» de cet axe, nous trouvons plusieurs groupes ultra-orthodoxes et violemment anti-sionistes, tels les «nétoreï Karta» («les gardiens de la cité»), qui se refusent à reconnaître l'Etat d'Israël; sa création est, à leurs yeux, une entreprise impie d'hommes sans Dieu qui, dans leur arrogance impatiente, ont voulu réaliser politiquement la rédemption d'Israël avant la venue du Messie. Ces groupes s'interdisent la participation aux élections, refusent de profaner l'hébreu en le parlant (ils parlent le yiddisch dans la vie de tous les jours), refusent d'utiliser la monnaie israélienne (ils n'acceptent que des dollars américains, moins blasphématoires ... ). Leur attitude est apocalyptique: l'Etat d'Israël ira à sa ruine, avec tout ce qui n'est pas conforme à la Torah. Sur le plan politique, ils ont une position plutôt anarchiste: que périsse cette société impie pour que le Messie puisse venir! A la limite, ils sympathisent avec les mouvements terroristes arabes.
Un peu plus modérés sont les groupes orthodoxes non-sionistes - mais participant à la vie politique - tels «Agoudate Israël» (le parti des Hassidim aschkénazes), Deguel Hatorah (le parti des orthodoxes aschkénazes anti-hassidiques), Schass (le parti des orthodoxes séfarades). Leur programme politique: défendre leurs intérêts particuliers, assurer au maximum le financement de leurs institutions religieuses avec l'argent de l'Etat, imposer le plus possible de lois religieuses à la société israélienne (pas de transports publiques le sabbat, interdiction d'élever et de vendre du porc, etc.). Sur le plan pratique, ils sont pragmatiques et rejoindront la coalition qui leur assurera les plus grands avantages financiers et les plus grands succès dans l'imposition de la religion à la société.
Plus modéré encore, et profondément sioniste et patriote, est le Mafdal (Miflagah Datite Léoumite, le parti religieux national). Attachés à la tradition, les membres du Mafdal ne sont pas fanatiques et savent unir la religion des pères avec la vie politique d'un Etat moderne. Leur politique: promouvoir une société israélienne juive, fidèle à la religion et à la culture des pères, fidèle à la terre promise aux pères. Ils s'intéressent à l'instruction publique, préconisant dans les écoles un enseignement aussi juif que possible (étude de la Torah, de la littérature talmudique, de la tradition et du folklore). Ils sont contre un abandon des territoires pris lors de la guerre des Six jours et sont les principaux créateurs de nouvelles implantations. Depuis 1977, ils soutiennent systématiquement le Likoud.
Plus à gauche encore, nous trouvons des religieux dans les diverses tendances du parti travailliste. Il s'agit surtout d'intellectuels religieux qui, au nom de leur religion, ont adopté des positions contraires à celle du Mafdal.
L'AXE DROITE-GAUCHE SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE
C'est le schéma connu des médias internationaux. A l'extrême-droite se trouvent trois partis dont les nuances échappent à bien des observateurs étrangers.
Tehiyah («résurrection, renouveau») est le parti laïc, mais pas anti-religieux, de Guéoula Cohen et Youval Ne'eman. Leur politique: garder les territoires, créer des implantations.
Molédète («patrie») est le parti laïc de Rehavam Zéev qui, à l'idéologie de la Tehiyah, ajoute encore le programme du transfert: avec ou sans accord de paix, si la situation devient impossible, les Arabes des territoires devraient être transférés en Jordanie et au Liban, la terre d'Israël étant réservée aux Juifs.
Tsomète («carrefour») est le parti du général Rafael Eitan. Il combine le programme de la Tehiyah avec une politique anti-religieuse: les orthodoxes, anti-sionistes ou non sionistes, de toute façon non-patriotes, doivent être tenus à l'écart des décisions politiques.
Ces trois partis de droite soutiennent le Likoud, dans la mesure où celui-ci ne dévie d'une ligne nationaliste. Tout compromis du Likoud avec les travaillistes amène à brève échéance le départ de ces trois partis de la coalition.
Plus au centre, le Likoud («union» des libéraux et du «Héroute» l'ancien parti de Menahem Begin) est un parti laïc mais non anti-clérical, libéral désireux, notamment, de libérer le socialisme de la société israélienne telle que l'ont formée les pères de la nation (Ben Gourion et sa génération). Patriote, le Likoud s'oppose en général à l'abandon des territoires, quoique ce fut lui qui accepta de céder le Sinaï à l'Egypte lors de la signature des accords de Camp David. Il préconise une autonomie politique pour la population palestinienne, les territoires devant rester sous contrôle israélien. A deux reprises, en 1984 et en 1988, le Likoud n'a pas hésité à former un gouvernement d'union nationale avec le parti travailliste.
A gauche se trouve l'autre grand acteur de la scène politique israélienne, le Ma'arakh («l'alignement»), connu au dehors sous le nom de parti travailliste. Comme le Likoud, le Ma'arakh regroupe en son sein plusieurs tendances, parfois fort diverses. C'était le parti des pères politiques de la nation. Jusqu'à une époque très récente, il a conservé les slogans et les symboles traditionnels du socialisme de l'ancienne génération (célébration pathétique du 1er mai, drapeaux rouges, chant de l'«Internationale»), ce qui l'a, pour un temps, éloigné de l'électorat nouveau d'origine russe allergique au rouge. Dans l'ensemble, le Ma'arakh accepte l'idée d'un retrait des territoires, sauf de Jérusalem, et semble de plus en plus accepter l'éventualité de la création d'un Etat palestinien.
A l'extrême-gauche se trouvent, outre des groupuscules communistes, deux partis suivant une ligne socialiste stricte, violemment anti-religieuse: Ratss et Mapam. Ils préconisent l'abandon des territoires, la création d'un Etat palestinien et acceptent de soutenir le Ma'arakh dans la mesure où celui-ci suit une politique extérieure qui va dans leur sens.
L'AXE DROITE-GAUCHE SUE LE PLAN SOCIAL
Ici les rôles sont inversés entre le Likoud et le Ma'arakh. L'électorat du parti travailliste est constitué en grande partie de gens de profession libérale, d'intellectuels, de membres de l'«establishment» de la société héritée des pères fondateurs. L'électorat du Likoud, en revanche, se recrute en grande partie parmi les gens du petit peuple. C'est le Likoud qui aimerait nationaliser la caisse-maladie, les hôpitaux et la «Bank Hapoalim» en possession de la Histadroute, le grand syndicat au travers duquel le parti travailliste exerce un pouvoir démesuré sur l'ensemble de la population israélienne. Et, bien entendu, le parti travailliste refuse de perdre cet empire économique qu'est la Histadroute. Il est évident que si la caisse-maladie et la chaîne des dispensaires et des hôpitaux qui dépendent de la Histadroute étaient nationalisés, un grand nombre d'Israéliens quitteraient immédiatement la Histadroute, qui perdrait ainsi une partie importante de ses revenus.
Pour être bref, nous ne mentionnons que pour mémoire des groupuscules sans importance parlementaire, tels que les restes du mouvement du rabbin Kahana, le mouvement Shalom Akhshar («paix maintenant»), ou le parti Shinoui («changement»).
Puissent ces lignes permettre de comprendre la trame embrouillée de la vie politique israélienne!
De Jérusalem, Henri-Léon Vaucher
AVENEMENT Avril 1992 No 43 / P 13