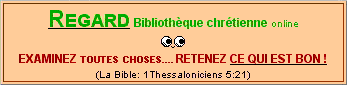
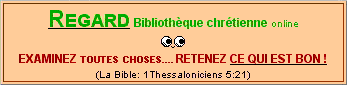
Les affrontements du 8 octobre, sur l'esplanade des mosquées,, sont les plus graves qu'ait connus Jérusalem depuis 1967. Survenant en pleine crise du Golfe, alors que l'Intifada s'essoufflait quelque peu, ces événements ne sont pas le fruit d'un «mauvais hasard».
Les violences du 8 octobre ont eu lieu au coeur même de la Ville Sainte, pendant la semaine où la population juive célébrait la fête des Tabernacles (ou fête de Succoth - voir Deut. 16, 13-15). Pendant que des Juifs priaient devant le Mur, des manifestants palestiniens se sont mis à jeter des centaines de pierres, du haut de l'Esplanade.
Quelques minutes plus tôt, le poste de police, situé au pied des mosquées, avait été attaqué: un policier et deux fidèles avaient été blessés.
Face à cette flambée de violence, les forces de l'ordre ont réagi, envoyant des balles en caoutchouc ou des grenades lacrymogènes, et tirant à balles réelles sur les manifestants palestiniens, massés sur le Mont du Temple. Le bilan est lourd: vingt morts, au moins, et des dizaines de blessés.
Les conséquences politiques de ces affrontements sont nombreuses: les diplomates occidentaux relancent l'idée d'une négociation globale sur tous les problèmes du Proche-Orient, les palestiniens retrouvent auprès de l'opinion internationale un courant de sympathie perdu après la prise de position de l'OLP en faveur de l'Irak, Israël se voit à nouveau accusé d'être inflexible et «dominateur», enfin l'Intifada retrouve un souffle nouveau.
Les effets néfastes de ces violences sont trop nombreux pour que nous croyions que ces affrontements sont fortuits. Le rassemblement de Palestiniens sur l'esplanade des mosquées un lundi (qui n'est pas un jour de prière particulier pour les musulmans) et le regroupement d'un grand nombre de pierres prouveraient qu'il y a eu préméditation, même si les extrémistes arabes rejettent la responsabilité des incidents sur les fanatiques juifs des «fidèles du Mont du Temple».
Quoi qu'il en soit, ce grave événement détruit l'équilibre qui s'était instauré en Israël depuis le début de la crise dans le Golfe.
Celle-ci avait apaisé les tensions intérieures, et le Likoud, le parti de droite au pouvoir, tirait profit de la situation dans le Golfe. A Jérusalem, on soulignait que le Likoud a toujours eu une position très tranchée contre le régime de Saddam Hussein et contre ses velléités militaires: le 7 juin 1981 le gouvernement de Menahem Begin avait fait bombarder le centre de recherches nucléaires irakien de Tamouz, près de Bagdad (opération Babylone). La politique plus conciliante et plus pacifique des travaillistes de Shimon Perès était mise à mal, et l'opposition se montrait moins agressive envers l'actuel gouvernement. Cela d'autant plus que l'Intifada était en perte de vitesse, les palestiniens extrémistes ayant perdu des appuis précieux au sein même du monde arabe. Le Koweït (et pour cause . . . ) ou l'Arabie Saoudite, par exemple, ne pouvaient plus soutenir financièrement une agitation entretenue par l'OLP, seule alliée, avec la timide Jordanie, du maître de Bagdad.
La crise du Golfe avait aussi permis à Jérusalem d'améliorer ses rapports avec les puissances les plus influentes du monde. Les relations avec Washington , distendues pendant ces deux dernières années en raison de «l'évolution» de Yasser Arafat s'étaient réchauffées. De même le rapprochement avec l'URSS entrait dans une phase active: Moscou et Jérusalem ont décidé d'ouvrir des représentations consulaires dans les deux capitales. Bientôt, une liaison aérienne sans escale sera mise en service entre Moscou et l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv: le mouvement d'émigration des juifs d'URSS s'en trouvera facilité. Le mois dernier 21 000 nouveaux émigrants sont arrivés en Terre promise: un record!
Cet apaisement est donc remis en cause. L'attention s'est détournée de Saddam Hussein pour se porter vers Israël. Quels seront les prolongements exacts de la tension créée par les violences du 8 octobre? Ils sont difficiles à mesurer, à l'heure où nous écrivons ces lignes. En tout cas, guidé par l'expérience et la prudence, le gouvernement Israélien avait commencé, avant le 8 octobre, la distribution des moyens de protection: chaque civil devrait avoir reçu à la fin de ce mois une boîte contenant un masque à gaz, une seringue et un antidote contre les gaz paralysants et une poudre de décontamination.
Sur le plan économique, aussi, la tension dans la région a des conséquences néfastes: beaucoup de touristes ont annulé leur voyage en Israël. On peut d'autant plus le regretter que ce secteur se redressait après avoir été touché par l'Intifada: les sept premiers mois de l'année avaient vu le tourisme progresser de 14% par rapport à la même période de 1989.
Plus que jamais, le Peuple élu de Dieu a besoin de soutien. Il a soif de trouver, sur le plan spirituel, des solutions aux problèmes qu'il affronte. Les Juifs, de plus en plus, sont ouverts à l'annonce de l'Evangile. Les chrétiens doivent participer à ce mouvement, en priant pour que les juifs messianiques soient attentifs à ce que Dieu attend d'eux pour leurs frères.
Michel Béghin (à Jérusalem Victor Smadja)
AVENEMENT Octobre 1990 No 19 / P 8