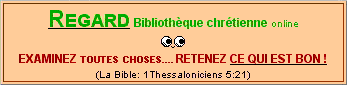
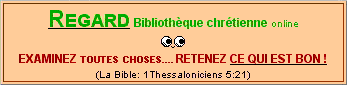
Les implantations juives sont au coeur d'une éventuelle conférence de paix. Avant ou pendant celle-ci.
Les implantations dans les territoires sont un des plus grands obstacles à la paix» déclara en mai dernier le Secrétaire d'Etat américain James Baker.
«Qu'Israël stoppe sa politique d'implantation et nous mettons fin à l'embargo arabe contre les compagnies et les sociétés commerçant avec Israël» proposent tour à tour l'Egypte, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Jordanie, adoptant ainsi l'idée, avancée par les Américains au Sommet des sept nations industrialisées à Londres, de lier le gel des implantations juives à la cessation de 46 années de boycottage économique arabe contre Israël.
«Quelle excellente idée!» clament en choeur les médias internationaux. Pourquoi les Israéliens et leur gouvernement s'entêtent-ils dans une politique colonialiste désuète et ne saisissent-ils pas la perche qui leur est tendue? Et la gauche israélienne d'emboîter le pas: dans une lettre adressée le 21 juillet à Itzhak Shamir, Yossi Sarid, du parti Ratss, et Amnon Rubinstein, du parti Shinouï, écrivent: «Ce serait regrettable que quelques misérables roulottes fassent échouer cette occasion historique de parvenir à la paix».
Quelques misérables roulottes, implantations, colonialisme, obstacle à la paix, fin de l'embargo arabe: devant la confusion des notions, essayons de remettre un peu d'ordre dans les idées. Jusque vers 1850, ce qui était alors la Palestine turque était une province pauvre, arriérée, oubliée du monde et fort peu peuplée avec quelques petites villes: Hébron, Jérusalem, Yaffa, Naplouse, Haïfa, Safed, Tibériade, un certain nombre de villages, et de grandes régions désertiques ou marécageuses. Des récits de voyages, des esquisses, des cartes, nous dépeignent un pays privé de ses habitants. Combien y en avait-il alors?
A défaut de statistiques exactes, on en estime le nombre entre 100 mille et 200 mille. Des photos aériennes prises par les Allemands, alors alliés des Turcs, durant la première guerre mondiale, nous montrent un pays quasiment vide, dépourvu d'une grande partie des villages et des villes qui le couvrent aujourd'hui. A partir du milieu du siècle dernier, suite à toute une série de circonstances, la région sort lentement de son sommeil et plusieurs groupes ethniques viennent la coloniser et la développer:
- des musulmans marocains viennent s'établir, entre autres villes, à Jérusalem, près du Mur des Lamentations,
- des Bosniens et des Macédoniens musulmans, fuyant la reconquête «chrétienne» des Balkans, s'installent à différents endroits du pays.
- des Caucasiens musulmans et des musulmans de l'est de la Caspienne, fuyant l'expansion de l'empire russe, créent plusieurs villages en Galilée (les Tcherkess).
- des chrétiens évangéliques allemands (les Templiers) bâtissent de nouveaux quartiers à Jérusalem et à Haïfa.
- et puis, bien sûr, plusieurs vagues d'immigration juive bien modestes encore, viennent consolider la population juive des villes ou sont à l'origine de nouvelles localités et de nouveaux villages. De nouvelles places de travail se créent, ce qui, de nouveau, attire de la main-d'oeuvre arabe des pays avoisinants. Des noms de famille arabes, tels que AI-masri («l'Egyptien») nous indiquent leur origine géographique. Dans les années 1880 arrive un groupe important de Juifs yéménites; ces derniers fonderont notamment le village de Silouane (Siloé, sur le flanc sud-ouest du Mont des Oliviers). Vers les années 20 de ce siècle, à la suite d'émeutes arabes anti-juives, ces Juifs yéménites abandonnent le village de Silouane - dès lors occupé par des Arabes - et vont habiter d'autres quartiers de Jérusalem.
Avec la fin de la première guerre mondiale et l'instauration du mandat britannique, le processus de colonisation et de développement s'accélère: des Juifs en grand nombre - mais aussi des Arabes de Syrie, du Liban, d'Irak, d'Egypte - viennent s'établir en Palestine; les villes s'étendent, de nombreuses localités nouvelles apparaissent également du côté arabe. En fait, il n'y a pas un «côté arabe» et un «côté juif»: les populations sont mêlées, villages arabes et villages juifs se côtoyant; la plupart des villes sont mixtes. Une série d'émeutes et de pogromes chassent les Juifs de certaines villes (Hébron, par exemple) ou de certains quartiers, qui deviennent alors purement arabes - tandis que des Arabes continuent de vivre dans des quartiers juifs, et cela jusqu'à aujourd'hui. Le racisme et la terreur sont à sens unique: on ne trouvera plus désormais de population juive dispersée parmi une population arabe, tandis que le contraire (des Arabes parmi des Juifs) se voit à Jérusalem, à Ramleh, à Lod, à Tel-Aviv, à Haïfa, à Akko, etc... La déclaration Balfour promettait aux juifs un foyer en Palestine, laquelle en 1917 couvrait, en plus d'Israël, tout le territoire de la Jordanie actuelle (alors inexistante politiquement), une partie du Sinaï et le sud de la Syrie et du Liban; ces deux dernières parties furent données à la France, tandis que tous les territoires situés à l'est du Jourdain furent détachés de la Palestine pour constituer le royaume de Transjordanie (premier partage de la Palestine, 1922). Désormais seul un tiers de la Palestine originelle était attribué aux Juifs, le Jourdain et la Mer Morte constituant la frontière orientale du foyer national juif.
Après la catastrophe de la seconde guerre mondiale et les émeutes qui suivirent, un nouveau partage de la Palestine eut lieu en novembre 1947, qui mena à la guerre d'indépendance et aux accords d'armistice de Rhodes en 1949. Les lignes de démarcation alors établies étaient des lignes de cessez-le-feu, et non des frontières Internationalement reconnues. En fait, les nations arabes refusèrent de reconnaître ou d'accepter l'idée même de l'existence de l'Etat d'Israël. La guerre des Six jours, en juin 1967, redonna aux Juifs l'accès à tout le territoire de la «petite» Palestine de 1922, de la Méditerranée au Jourdain. Arrêtons-nous un instant:
Les implantations juives en «Cisjordanie», pour parler le langage des médias occidentaux, ont-elles été la cause de la guerre des Six jours? Ou celle de l'embargo arabe depuis 1948? Le ridicule de la question tient lieu de réponse. Dans un article précédent est décrit le refus arabe systématique de faire la paix avec Israël. Ce que l'Occident appelle la Cisjordanie, ou la «West-Bank», constitue, pour les Juifs, la Judée et la Samarie; et le pays compris entre la Méditerranée et le Jourdain ne forme qu'un tiers du foyer national promis au peuple juif en 1917.
Devant le refus opiniâtre de ses voisins d'envisager la paix, Israël fit en Judée, en Samarie, dans la bande de Gaza et dans le Golan, ce que les Arabes et les Druzes avaient fait avant eux et continuent de faire jusqu'à ce jour: ils développèrent les villes existantes et implantèrent des localités nouvelles, défrichèrent et cultivèrent des régions jusqu'alors désertiques.
A noter qu'aucun Arabe ni aucun Bédouin n'a été dépossédé de ses terres par cette activité colonisatrice. Dans une entière liberté, les Arabes ont fait de même et un nombre non négligeable d'entre eux sont même venus s'installer dans des quartiers juifs (comme Neveh Ya'akov à Jérusalem ou Natsrate Ilite à Nazareth). Les chancelleries occidentales ont-elles alors émis une protestation? Les musulmans ont pratiquement conquis le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem et y constituent la majorité de la population. L'ONU les a-t-elle condamnés pour autant? Mais que quelques caravanes d'Israéliens viennent se parquer sur une colline déserte, ou que quelques Juifs viennent habiter dans le quartier chrétien de Jérusalem, et c'est le scandale international.
Une double morale et une mauvaise foi évidente régissent les relations entre Etats. Pourquoi une attitude aussi systématiquement anti-juive continue-t-elle d'inspirer l'âme du monde occidental, dans sa réflexion, dans ses médias, dans sa politique? Pour être irrationnel dans son essence, l'antisémitisme n'en est que plus coriace dans sa réalité tout à la fois fuyante et impérieuse.
La lutte arabe, persévérante et intelligente - apparemment convaincante pour beaucoup - contre toute politique juive de peuplement et de développement d'une partie de sa terre, semble bien devoir être comprise comme un élément parmi d'autres d'une lutte globale menée contre la présence même du peuple juif en terre d'Israël. Le but demeure le même pour les nations arabes - et même peut-être pour l'Egypte également - mais les moyens varient. Le moment n'est pas venu de détruire Israël manu militari, les nations arabes n'en ayant pas la possibilité d'autre part l'obstination de l'administration Bush-Baker à vouloir résoudre les problèmes de la région par un retrait israélien plus ou moins total des «territoires» ne peut être qu'appréciée dans les capitales arabes. La Jordanie, l'Arabie saoudite et la Syrie n'ont rien à craindre d'un «processus de paix», l'Egypte a déjà prouvé qu'elle avait tout gagné, sans pour autant avoir de relations normales avec Israël (aucun touriste égyptien ne vient visiter Israël; les rapports commerciaux entre les deux pays sont réduits au strict minimum; les forces égyptiennes, armées jusqu'aux dents, restent sur le pied de guerre). Le perdant sera de toute façon Israël - en territoires, en sécurité - dans le cas d'un «traité de paix» toujours bien fragile dans le contexte du Proche-Orient.
La Syrie de Hafez El Assad, qui a pratiquement annexé le Liban, est en train d'acquérir l'équipement le plus sophistiqué de l'arsenal soviétique, avec l'argent saoudien et koweïtien. La commande comprend: 300 tanks T-74, nouveaux venus au Moyen-Orient; 50 Mig 29, parmi les meilleurs avions de combat soviétiques; les missiles sol-air les plus récents SA- 11, SA- 13 et SA16 avec leurs systèmes d'alerte, de commande et de contrôle. D'autre part la Syrie projette d'acheter en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Roumanie 300 à 500 tanks T-72.
Avec de telles informations, les Juifs ont quelque peine à croire que la construction de maisons en Judée, en Samarie et à Gaza constitue la principale menace à la paix au Proche-Orient.
De Jérusalem, Henri-Léon Vaucher
AVENEMENT Août 1991 No 29 / P 11