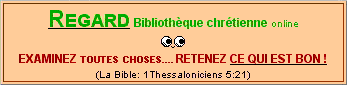
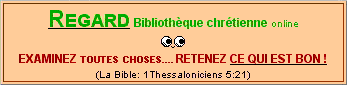
TANDIS QUE SE PRÉPARE DIFFICILEMENT - LA CONFÉRENCE DE PAIX AU PROCHE-ORIENT, LES ISRAÉLIENS ONT DE PLUS EN PLUS L'IMPRESSION QUE L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE SORT DE SON ROLE D'ARBITRE ET PENCHE EN FAVEUR DE LA CAUSE ARABE. DEPUIS LA CRÉATION DE L'ETAT HÉBREU, EN 1948, LES RELATIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET ISRAEL SONT PASSIONNELLES, PARFOIS MARQUÉES PAR DE GRAVES MOMENTS DE TENSION.
On ne peut pas parler de « grand amour» pour qualifier les relations qui se sont établies entre l'administration présidentielle américaine et le gouvernement israélien depuis 43 ans, depuis que l'Etat d'Israël existe; elles n'ont jamais connu de lune de miel, quoiqu'en dise la propagande arabe. Ces relations étaient fondées sur une certaine vision des deux Etats, le géant outre Atlantique et le minuscule Etat juif: chacun pensait avoir intérêt à cultiver de bons rapports avec l'autre. Et il est évident que l'opinion du «géant» pesait beaucoup plus dans la balance que les arguments du bébé-Etat, aussi justes et aussi solides soient-ils. Mais dans le cadre de ce mariage de raison, où le petit s'adaptait au grand, s'est tissé, à tous les niveaux, tout un réseau de relations et d'échanges, Israël jouissant de la générosité réfléchie de son patron et s'efforçant de réduire au minimum les frictions avec lui, tout en conservant un maximum de liberté d'action.
Mariage de raison, les relations Etats-Unis/Israël n'ont pas exclu l'apparition, avec le temps, de «sentiments» d'appréciation réciproque; les Américains ont salué en Israël la seule démocratie du Proche-Orient, société dynamique, pluraliste et libérale, ouverte au progrès tel qu'il est compris aux USA; quant aux Israéliens, et surtout aux jeunes Israéliens, dont l'engouement pour l'américanisme va parfois jusqu'à l'abandon de leur âme juive, ils ont vu dans le mode de vie américain une possibilité d'évasion, un moyen de fuir, mentalement et émotionnellement, la stagnation, la violence, le caractère primitif, le bigotisme, voire le fanatisme du Proche-Orient qui les entoure. Pour beaucoup de «sabras» (Israéliens de souche), les films américains, le pop, le rock, le rap et tout un comportement propre à la jeunesse américaine ont pris la place de la tradition des pères - et malheureusement aussi, bien souvent, de la culture européenne.
Les rapports Etats-Unis/Israël ont connu de grosses secousses et traversé des crises sérieuses, et cela dès avant la naissance de l'Etat juif. En mai 1948, les principaux conseillers du président Truman, au département d'état et à l'état-major général, ont exercé de très fortes pressions sur David Ben Gourion pour que l'Etat d'Israël ne soit pas proclamé après la proclamation, les Etats-Unis ont cependant été un des tout premiers états à reconnaître Israël. Lors de la guerre du Sinaï, en octobre 1956, le président Eisenhower, en des termes que ne laissaient entrevoir aucune cordialité, s'est joint aux Soviétiques pour ordonner aux Israéliens de retirer leurs troupes du Sinaï. Il y eut encore d'autres passes difficiles: la nouvelle évaluation de la politique extérieure américaine faite par le président Ford en 1975, le débat autour de la vente d'avions d'observation à l'Arabie Saoudite en 1981, la guerre au Liban - et j'en passe. Mais ces conflits n'ont jamais mis en cause l'aide financière américaine, ni la vente d'armements sophistiqués à Israël; et sur le plan de la politique internationale, les Etats-Unis ont persévéré dans leur soutien à Israël, s'opposant à maintes résolutions anti-israéliennes à l'ONU, refusant de reconnaître l'OLP ou de négocier avec elle - et ceci, pendant de nombreuses années. Alors que tant de nations lui tournaient le dos, ou même rompaient leurs relations diplomatiques avec lui, Israël s'était habitué à voir dans les Etats-Unis un allié et un ami fidèle qui ne ferait jamais défaut.
Or, depuis quelques années, et plus encore de puis quelques mois, rien ne va plus, semble-t-il, dans les relations américano-israéliennes. La détérioration a commencé sous l'administration Reagan-Schulz: ceux-ci ont exigé d'Israël l'interruption du développement de son avion de combat, le Lavi (projet pourtant lancé en collaboration avec les Etats-Unis et avec leur financement), puis ils ont pris contact avec l'OLP, entamant des négociations avec cette organisation et lavant, sur la scène diplomatique, son leader, Yasser Arafat, d'une réputation de terroriste international.
La dégradation de la confiance entre les deux pays s'est dramatiquement accélérée sous le tandem Bush-Baker. Dès le début de la nouvelle administration américaine, la pression diplomatique sur Israël s'est renforcée: il fallait contraindre l'Etat hébreu à modifier radicalement la conception de sa sécurité par rapport à la valeur stratégique des territoires. Et cela bien que ses voisins arabes n'aient pas explicitement proclamé la fin de l'état de guerre entre eux et «l'ennemi sioniste» - mis à part l'Egypte, dont une partie de la presse continue pourtant de nommer Israël: «al-adou», c'est-à-dire «l'ennemi», omettant généreusement le terme «sioniste»! Alors que les Etats arabes qui s'étaient alliés aux Américains pendant la crise du Golfe, étaient libéralement gratifiés d'une remise de leur dette, Israël, en récompense pour sa bonne conduite (recevoir les coups sans les rendre), était prié, en mars dernier, de reporter à septembre sa demande de garanties pour un prêt de dix milliards de dollars; ce qui fut fait. La suite est connue: le président Bush a remporté la victoire sur les membres du Congrès et la demande israélienne ne sera pas examinée avant l'année prochaine. Qui plus est, George Bush a expressément promis qu'il ne promettrait rien dans quatre mois...
Rappelons qu'il n'est pas question d'une demande de subside, ni même d'une demande de prêt de dix milliards de dollars. Rappelons également qu'Israël a toujours remboursé ses dettes envers l'étranger, capital et intérêts; non, il s'agit d'une demande de garantie de quelques centaines de millions de dollars, qui seront finalement remboursés et n'auront rien coûté aux contribuables américains. Officiellement, du côté américain, il n'est pas question de pression ni de chantage, mais uniquement du désir de ne pas irriter les Arabes par des prêts finançant l'absorption des centaines de milliers d'immigrants juifs en Israël. Parallèlement, George Bush et James Baker livrent un combat acharné contre la politique d'implantation du gouvernement de Yitzak Shamir, n'épargnant pas la future localité de Tsour Ygal, pourtant projetée à l'intérieur de «la ligne verte», à côté de Kfar Saba, à 18 km de la côte méditerranéenne. Les Israéliens s'inquiètent de cet acharnement des Américains à vouloir imposer leur politique à l'Etat hébreu, politique qui finalement porte atteinte à l'intégration de l'immigration.
S'exprimant lors d' une réunion du cabinet, avant la venue de M. Baker, le ministre de la santé, Ehud Holmert, osa dire: «nous avons affaire à un politicien cynique. . . Nous n'avons rien à perdre. Il n'est pas possible de fuir la bataille que Bush nous a imposée. . . Il a choisi de concentrer ses attaques justement sur l'alyah (l'immigration). S'il s'agissait des implantations, on aurait encore pu discuter; mais l'alyah? On nous a dit qu'il n'est pas possible de gagner cette bataille, et que même s'il était possible, nous aurions alors un président hostile. Eh bien, c'est ce que nous avons déjà. Quoi que nous fassions, il est hostile».
Et Shamir, fâché, de poursuivre: «Vous comprenez ce que cela veut dire? Par "gel des implantations", il ne vise plus seulement la création de nouvelles localités en Judée et en Samarie, mais le développement même de localités existantes. Il n'y a pas de fin à cela. Et après ça, ils (Bush et Baker) prétendent qu'il n'y a pas de "linkage" (lien entre garanties financières et immigration). Ce n'est pas seulement un "linkage", mais c'est un "linkage à la puissance 2"».
Expliquant, devant les caméras de télévision, le combat qu'il mène contre l'examen actuel de la demande israélienne, M. Bush a déclaré, irrité, qu'il luttait seul contre un lobby de mille membres... Un tel manque de tact, avec son relent d'antisémitisme, n'a pas échappé aux Israéliens. Reharam Zeevi, ministre sans portefeuille du parti de droite Molédète (patrie), a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. «Le président Bush est un quasi anti-sémite et un anti-israélien». D'autres ministres ont cependant souligné qu'il était important de ne pas jeter d'huile sur le feu et de ne pas envenimer davantage les relations avec les Etats-Unis. On a aussi fait remarquer qu'un gouvernement antisémite n'agirait pas à l'égard d'Israël comme agit le président Bush: il a lutté pour que les Juifs d'Ethiopie puissent venir en Israël, pour que les portes de la Russie restent ouvertes à l'émigration juive. et pour que soit annulée la fameuse déclaration 3379 de l'ONU assimilant le sionisme à une forme de racisme.
Le sujet de crainte est ailleurs. Il se peut qu'avec les meilleures intentions du monde, ainsi qu'avec une bonne mesure de mauvaise foi, le gouvernement du président Bush, dans son zèle à vouloir à tout prix instaurer la «pax americana» dans la région, soit sur le point de commettre une série de terribles erreurs d'estimation, avec les conséquences pratiques qui en découleraient pour Israël. Ce ne serait pas la première fois, au vingtième siècle, que les Etats-Unis se fourvoieraient en matière de politique étrangère et prendraient, par naïveté et par présomption, des décisions qui livreraient des peuples entre les mains de conquérants cruels et précipiteraient des régions entières dans la guerre. Il y a là, hélas!, matière à plusieurs articles...
Israël est, et demeure, menacé dans son existence. L'expérience des accords de Camp-David a montré qu'un traité de paix avec une nation du Proche-Orient a une valeur relative, qui peut rapidement tendre vers zéro si le partenaire du traité cesse de voir son intérêt dans la paix. Israël aura toujours besoin, pour sa sécurité, d'une profondeur stratégique. Le vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Benyamin Netanyanu, s'exprime ainsi: «l'objet de la controverse entre nous et le gouvernement de Washington n'est pas notre droit à avoir un Etat... mais la profondeur et les dimensions de l'Etat juif. Nous visons à avoir une largeur minimum de 70 km, tandis que les Etats-Unis veulent que nous nous contentions d'une largeur de 10 km seulement».
De Jérusalem, Henri-Léon Vaucher
AVENEMENT Octobre 1991 No 32 / P 14