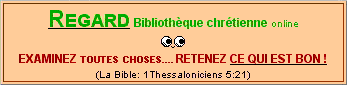
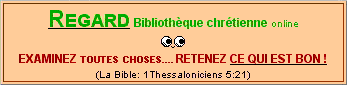
Yitzhak Rabin: l'Europe devrait contribuer à accroître l'indépendance économique des Palestiniens
«J'ai été trop optimiste», a reconnu Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, qui, lors de son accession au pouvoir, avait espéré conclure dans les douze mois suivants un traité de paix avec au moins un des interlocuteurs arabes. Dans une interview accordée au magazine «DIE WELT», Y. Rabin explique qu'en matière de politique de paix, il a réalisé des compromis que le précédent gouvernement n'aurait même pas accepté d'envisager. Il n'a toutefois pas obtenu la réponse à ses attentes. «C'est pourquoi le processus dure plus longtemps, mais je ne crois pas que les négociations de paix puissent être retardées davantage». Depuis son élection voici presque un an, ce social-démocrate de 70 ans est sous les feux de l'actualité puisqu'il est entré en fonction comme l'homme de la paix et des concessions. Mais Y. Rabin a également décrété l'extradition de 400 musulmans radicaux et l'état d'urgence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
«Ce qui m'a décidé à isoler les 'territoires', c'est l'inquiétude pour la sécurité personnelle des Israéliens; après deux mois de fermeture, l'atmosphère s'est peu à peu détendue en Israël.» Israël dépendait jusqu'à un certain point des travailleurs palestiniens; d'autre part, les salaires des 120.000 Palestiniens travaillant en Israël représentaient un tiers du produit national brut. Par conséquent, Israël a décidé d'investir l'équivalent de 70 millions de dollars en travaux publics dans les «territoires». «Le temps est venu», explique le chef du gouvernement, «que les Européens, l'ONU, les Etats-Unis et les pays arabes aident les Palestiniens à accroître leur indépendance économique vis-à-vis des emplois qu'ils occupent en Israël. » Le fait que cette prise de position permette par ailleurs de poser la première pierre d'une indépendance politique est «une autre histoire». Traditionnellement, Israël se montre méfiant à l'encontre des Européens, et il a souhaité les maintenir à l'écart du processus des négociations. Les choses ont-elles changé? Y. Rabin précise que les pays européens ont été invités à participer aux négociations multilatérales. Ils devaient faire comprendre aux Etats arabes et musulmans ainsi qu'à Israël à quel point la paix pourrait contribuer au développement économique de la région. «Si la CEE octroyait chaque année un soutien de 70 millions de dollars aux Palestiniens - pour l'infrastructure, l'éducation, la santé, des projets économiques communs -, nous serions comblés.» Mais les Européens devraient également montrer clairement, signale Y. Rabin, qu'ils n'acceptent pas le boycott arabe qui équivaut à une sorte de guerre contre Israël. Dès les accords de Camp David, puis avant la Conférence de paix de Madrid, Israël a accepté de partager le contrôle avec les Palestiniens: «Les Palestiniens régleront eux-mêmes leurs affaires courantes, et nous serons responsables des Israéliens demeurant dans les 'Territoires' ainsi que de la sécurité générale.» En outre, Israël entendait confier aux Palestiniens l'administration de certaines parties du pays durant la phase de transition. Le gouvernement du Likoud a refusé d'accorder cette «autonomie territoriale», par opposition à une «autonomie des personnes». «Il ne s'agit pas ici de limites territoriales - cette question relève de la solution définitive.» Sur le plateau du GoIan, Israël serait disposé à retirer ses forces armées derrière des frontières sûres et reconnues. «Mais nous ne négocierons pas l'ampleur du retrait avant de connaître la définition syrienne de la paix: s'agira-t-il d'une paix impliquant des frontières ouvertes aux personnes et aux biens, avec des relations diplomatiques fondées sur des ambassades?», demande Y. Rabin. Si un traité de paix est signé, il «tiendra solidement sur ses jambes et ne dépendra pas des résultats obtenus avec les autres interlocuteurs arabes.»
Le mandat de Rabin
La reprise des pourparlers de paix à Washington en juin ainsi que des indices de progrès dans les négociations avec les Jordaniens, les Palestiniens et surtout les Syriens suscitent une tension croissante parmi la population d'Israël. La principale question que se pose chacun concerne le prix de la paix. Que devra donner Israël à Damas en échange d'un traité de paix? Des territoires? Le retrait du plateau du GoIan? Ou - comme le pensent certains -, la paix en échange de la paix, sans renoncer à un seul millimètre de la terre d'Israël? Selon toute vraisemblance, le gouvernement israélien a d'ores et déjà fixé le principe. Les porte-parole gouvernementaux ont fait savoir plus d'une fois qu'Israël serait disposé à se retirer du GoIan et que «l'ampleur du retrait serait proportionnelle à l'ampleur de la paix». A la suite de ces déclarations, les adversaires d'un retrait - habitants des hauteurs du GoIan, de Judée, de Samarie et de la bande de Gaza - ont entamé en juin une action de protestation extra-parlementaire destinée à remettre en question la légitimité du gouvernement et son droit de renoncer au GoIan. Ces activités ont atteint leur point d'orgue lors d'une grande manifestation organisée cinq jours durant devant les bâtiments de la Knesset. Les manifestants ont dressé un camp de tentes et tenu d'innombrables meetings et manifestations sous le slogan «Rabin, tu n'as pas de mandat». Pour fonder leur point de vue, ils ont repassé sans cesse un extrait du discours prononcé par Y. Rabin en période électorale, et dans lequel il se déclarait explicitement adversaire de tout retrait du plateau du GoIan. D'après eux, ce discours explique qu'une grande partie de la population du GoIan ait voté pour Rabin lors des dernières élections. Son actuelle volonté de renoncer au GoIan serait donc une trahison en bonne et due forme. Par ailleurs, les manifestants ont exprimé le point de vue selon lequel un gouvernement dont la majorité s'appuierait sur le soutien des représentants non-juifs siégeant à la Knesset n'aurait, d'un point de vue strictement moral, aucun droit de renoncer à des parties de la terre d'Israël.
Les manifestations et les paroles prononcées au cours de celles-ci ont fortement irrité le Premier ministre et son parti. Dans un accès de rage, Y. Rabin a qualifié les manifestants de « girouettes» et fait comprendre qu'ils pouvaient bien tourner et protester jusqu'à en avoir le vertige. Mais au-delà de la colère et des déclarations blessantes, il semble bien que le gouvernement se préoccupe réellement de la possibilité d'une résistance sérieuse à toute décision de retrait. On sait notamment que le gouvernement aurait demandé au service d'information de la sécurité intérieure de le tenir au courant des activités des milieux d'opposition dans les territoires occupés. Cette nouvelle a soulevé des protestations extrêmement véhémentes parmi les colons, qui prétendent que le gouvernement n'a aucun droit d'utiliser les forces de sécurité à des fins politiques. Cette confrontation n'en est d'ailleurs qu'à ses débuts. Tous les observateurs politiques s'accordent à dire que plus le processus de paix avancera, plus Israël deviendra le théâtre de luttes acharnées entre la gauche et la droite, entre les adversaires et les partisans du retrait. Mais entre-temps, les Palestiniens ont toutefois aidé l'opinion israélienne à former un front uni. Au cours du dixième tour des négociations de paix, les délégués palestiniens ont commencé à mettre sur la table des revendications relatives à une scission de Jérusalem. Cette déclaration a suscité un accord unanime en Israël: Jérusalem ne sera pas scindée. Jamais. (DW)
Nouvelles d'Israël 08 / 1993