|
|
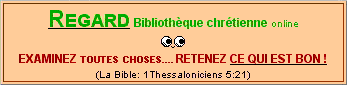 Après
le spectacle
Après
le spectacle
La conférence de paix
entre dans sa deuxième phase:
Israéliens et Arabes entament des
discussions bilatérales
Ce qu'aucun chef d'Etat ni
aucune autre instance internationale n'a
réussi à faire, James Baker l'a
réalisé en public et en direct dans
la capitale espagnole: rassembler autour d'une
même table une délégation
israélienne et 3 délégations
arabes (Syrie, Liban et Jordanie-Palestine) dans la
langue desquelles le vocable même
d'Israël est tabou, imprononçable. On
connaît une partie des tours de passe-passe
qui ont introduit les participants
récalcitrants dans la «cage de la
paix», selon les termes d'un diplomate arabe:
promesses contradictoires, démenties,
réaffirmées, contredites, parfois
tout simplement violées, le tout
accompagné de quelques torsions de bras
mesurées mais fermes. Il a bien fallu se
rendre à Madrid. Avec quelques poignets
endoloris.
Les Syriens ont dû
s'asseoir en compagnie de l'ennemi sioniste, sans
avoir obtenu d'abord l'assurance que le Golan leur
serait rendu. Les Libanais ont dû faire de
même, sans que l'évacuation des
troupes israéliennes du sud de leur pays
leur ait été promise. Les
Palestiniens ont dû siéger dans le
cadre d'une délégation commune
jordano-palestinienne, contraints de taire leur
identification avec l'OLP et de renoncer, pour un
temps, à réclamer un État
indépendant. Quant aux israéliens,
ils ont dû s'asseoir en face de Syriens et de
Libanais qui refusaient de leur tendre la main et
de les regarder, en face d'une
délégation palestinienne dont chaque
membre avait été choisi avec le
consentement de la centrale de l'OLP à
Tunis. Ils ont dû endurer les discours
virulents des représentants syriens et
palestiniens. Contrairement aux assurances
données, ils ont été mis
devant un fait accompli pénible: la
délégation palestinienne a tenu son
propre discours, indépendamment de la
délégation jordanienne. Et pour
consolider la cage - ou le piège ? - de la
paix, Américains et Soviétiques ont
rappelé à Israël, en termes
divers, le contenu des Résolutions 242 et
338 du Conseil de sécurité de l'ONU:
abandon des territoires en échange de la
paix.
Les allocutions des
délégations arabes ont
déçu les moins optimistes par leur
manque d'ouverture et leur dureté: le
réquisitoire syrien fut en particulier
difficilement supportable. Le premier ministre
Shamir, fatigué et mélancolique, a
résumé ainsi ses sentiments, le
deuxième soir de la Conférence,
à la télévision
israélienne: «on nous avait bien dit
que ce ne serait pas un jardin de roses... mais
aujourd'hui ce n'était qu'un champ de
ronces». Quant à l'intervention
clownesque, le dernier jour de la première
phase de la conférence, du ministre syrien
des Affaires étrangères, Farouk El
Charah, brandissant une vieille photographie de
Shamir «terroriste recherché par les
Anglais», elle dépassa tout ce que l'on
pouvait imaginer comme provocation.
Mais, diront les optimistes,
le simple fait qu'Arabes et Israéliens se
soient assis autour de la même table, d'abord
dans le cadre d'une conférence d'ouverture
puis dans celui, plus restreint et plus intime, de
négociations bilatérales sans
présence de tiers, n'est-il pas
révolutionnaire? Il est vrai que l'on
croyait rêver en voyant
délégués arabes et
israéliens à la même table,
dans la même pièce. Et bien des
politiciens israéliens se sont
félicités de voir s'effriter le tabou
arabe du non-dialogue avec Israël. Le mortier
américain a pressé dans une
même masse médiatique des
éléments jusqu'alors
irréductibles. Et, ajouteront les optimistes
à propos des Arabes, ne sommes-nous pas au
Proche-Orient, où un long marchandage
décide du prix final? Les
déclarations dures et rigides des
délégués arabes ne
constituent-elles pas que des positions de
départ, augurant de longues
tractations?
Il est vrai que nous sommes
au Proche-Orient et que, dans les souks des villes,
un acheteur patient peut faire baisser le prix d'un
objet de 60 à 25 dollars. Mais le
marchandage a ses limites: on ne peut faire
descendre un prix beaucoup plus bas que 40% de la
proposition initiale; inversement, un acheteur
sérieux ne peut proposer comme prix initial
une somme ridiculement basse. J'ai vu de mes yeux
des touristes éconduits dans les
échoppes des bazars pour n'avoir pas saisi
les règles du jeu du marchandage levantin.
Et quand les Syriens demandent d'abord la
restitution intégrale du Golan et la
démilitarisation d'une partie de la
Galilée, avant même d'envisager les
pourparlers de paix, tout habitant de la
région comprend qu'ils ne sont pas
sérieux. Cette impression a
été confirmée le dimanche 3
novembre, avec toutes les opérations de
diversion de la délégation syrienne
et l'entretien nocturne qu'elle n'a pu
éviter avec la délégation
israélienne. Eliyahou Ben Elissar, un des
représentants israéliens, à
Madrid, déclara le lendemain, à la
radio Kol Israël: «il est évident
que les Syriens ne veulent pas la paix: ils ont
été forcés de venir à
cette conférence et ils cherchent tous les
prétextes possibles pour en sortir et pour
faire éclater les négociations
directes».
La délégation
jordano-palestinienne, en revanche, a surpris les
Israéliens par son désir d'arriver
à un accord avec eux, même au risque
de déplaire aux Syriens. Il y a eu, certes,
les déclarations dures des discours
officiels, exprimant les exigences bien connues:
retrait israélien total de la bande de Gaza,
de la Samarie et de la Judée, y compris de
Jérusalem-est, démantèlement
des implantations, instauration d'une autonomie
régionale aboutissant, après une
période donnée, à la
création d'un État palestinien. Mais,
dans la pratique, la délégation
jordano-palestinienne a observé les
règles du jeu et s'en est tenue à
vouloir négocier seulement les
modalités d'une autonomie palestinienne dans
les territoires. Quant à la Jordanie
proprement dite, elle se contente de demander
à Israël de déterminer avec elle
le contour d'une frontière plus
précise dans la zone désertique de
l'Arava.
On a souligné que les
premières négociations directes se
sont déroulées dans une
atmosphère détendue, où les
plaisanteries et l'humour n'étaient pas
exclus. Que s'est-il passé avec les
Palestiniens? Ces pires ennemis d'hier, ces
supporters de Saddam Hussein et du coup d'Etat
avorté d'août en URSS ont-ils subi une
brusque mutation génétique? Il
convient de rappeler ici quelques
éléments qui échappent souvent
aux observateurs étrangers, dont la
pensée est souvent manichéenne: les
opprimés (palestiniens) s'opposant aux
oppresseurs (israéliens).
Il y a un contact quotidien
à bien des niveaux entre Arabes et Juifs.
Beaucoup d'Israéliens parlent l'arabe et
plus de Palestiniens encore parlent
l'hébreu. Malgré «la guerre des
pierres», les interventions de l'armée
israélienne dans les territoires et la
méfiance réciproque, les deux
populations ont des champs d'activité
communs et la vie «normale» continue. Les
«Palestiniens», à savoir les
Arabes des territoires contestés et leurs
frères dispersés à
l'étranger, sont ceux qui ont le plus
souffert de l'intifada, des grèves
incessantes, de la baisse dramatique du tourisme et
des tueries commises par les militants des groupes
terroristes divers. A cela s'est ajoutée la
guerre du Golfe, catastrophique avec l'exil
forcé de centaines de milliers de
Palestiniens du Koweït et la chute du dinar
jordanien.
La politique
israélienne d'implantation dans les
territoires, et la vague d'immigrants juifs de
Russie ont amené les dirigeants palestiniens
à conclure que le temps ne travaillait pas
forcément pour eux. La disparition de l'URSS
comme patronne automatique des mouvements
révolutionnaires a également
contribué à orienter les attitudes
vers la recherche d'un «modus vivendi»
avec Israël.
Les Israéliens se
réjouissent, évidemment, de tout
signe d'espoir perceptible dans l'attitude des
dirigeants palestiniens et jordaniens. Dans
l'ensemble, cependant, le doute demeure. La
conférence de Madrid, avec toute sa
solennité, ses poignées de mains, les
sourires palestino-israéliens, n'a pas
changé d'un millimètre les
données du contentieux: à qui
appartiennent (ou à qui doivent revenir) la
Judée, la Samarie, la bande de Gaza,
Jérusalem? Quel bâtiment doit se
trouver sur la place du Temple et pour quel culte?
Le culte d'Allah dans les deux mosquées
existantes, ou le service du Dieu d'Israël
dans un Temple reconstruit? Les musulmans sont
convaincus que la Terre sainte tout entière
fait partie du domaine de l'Islam et que seul
l'Islam doit y régner. Les Juifs qui ne
renient pas leur foi sont tout aussi convaincus que
Dieu leur a donné, par promesse, toute la
terre d'Israël et que Jérusalem est la
ville du Grand Roi, du Messie.
De Jérusalem,
Henri-Léon Vaucher
AVÈNEMENT Décembre
1991 No 35 / P 7
©
L'Avènement - Tous droits
réservés pour tous
pays
|
|