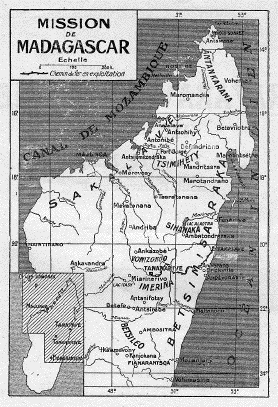RAFARAVAVY
MARIE
(1808-1848)
Une
Martyre
Malgache sous Ranavalona 1re,
Préface
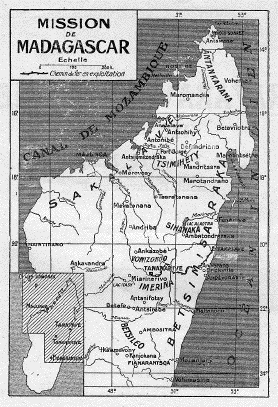
La mode est, depuis deux ans, aux biographies
romancées, et l'on pourrait, à
certains égards, faire rentrer dans ce genre
littéraire le nouveau volume que nous donne
aujourd'hui la plume féconde du Missionnaire
Gustave Mondain. N'a-t-il pas essayé de
dresser, toute vivante, son héroïne
devant nos yeux, dans le détail
extraordinairement dramatique de sa vie ?
Toutefois une biographie romancée est
généralement une oeuvre, où
l'art et même l'imagination ont autant de
place que le souci scrupuleux de l'exactitude
historique. Tel n'est pas le cas pour Rafaravavy
Marie. Ici, nul artifice, nulle recherche de
style ; une seule préoccupation, celle
de la stricte vérité. Pour la
dégager et nous la présenter, en
quelque sorte, toute nue, l'auteur à mis
à profit toute la documentation
écrite ou orale, qui s'est trouvée
à sa portée. Habitant Madagascar
depuis trente-deux ans, intimement
mêlé à l'élite
intellectuelle et morale des indigènes, il
était mieux placé que qui que ce soit
pour nous retracer fidèlement cette
histoire.
Et quelle histoire
Il y a juste un siècle, alors que le
christianisme évangélique venait
d'être apporté depuis huit ou neuf ans
au peuple hova, par les admirables missionnaires de
Londres, une jeune femme malgache, une jeune
mère de vingt ans,
Rafaravavy, de race noble, assujettie jusque
là à toutes les absurdes
superstitions de son peuple, est gagnée
à l'Évangile. Elle devient de toute
son âme, et dans toute la force du terme, une
chrétienne. C'est l'heure où la reine
sanglante, Ranavalona Ire, vient de monter sur le
trône et s'apprête à
déchaîner, contre ses sujets
chrétiens, une persécution violente
qui durera plus de trente ans. Les missionnaires
anglais sont chassés, le culte
chrétien interdit. Dans ces circonstances
tragiques, Rafaravavy déploie vue constance,
une fermeté, et aussi une prudence
extraordinaires chez une femme de son âge, de
son sexe et de sa race ; mais surtout une
douceur exquise, une pureté de coeur
vraiment cristalline. Menacée de mort,
emprisonnée, miraculeusement
délivrée, réfugiée plus
tard, au péril de sa vie, dans an village du
Vonizongo, à l'ouest de Tananarive, elle
revient secrètement à la capitale, en
descend, avec quelques autres chrétiens, par
la route de l'est, jusqu'à la mer, courant
toutes sortes de dangers, risquant tantôt de
périr de froid, de faim, de fatigue,
tantôt d'être reprise par la police de
la Reine. Elle finit par atteindre Tamatave, s'y
embarque sur un bateau anglais, gagne l'île
Maurice ; puis, de là, l'Afrique du Sud
et l'Angleterre. Elle y séjourne trois ans,
loin de tous les siens, revient à Maurice, y
passe encore six années et meurt enfin,
phtisique, à quarante ans, n'ayant Jamais
revu ni son pays, ni son mari, ni sa fille unique,
mais soutenue jusqu'au bout par sa foi.
Véritablement « c'est ici
la persévérance des saints
qui gardent les
commandements de
Dieu et la foi en Jésus. »
(Apoc. XIV : 12).
Nous n'avons pas l'habitude, nous,
chrétiens protestants, de béatifier
les héros et les héroïnes de
notre histoire religieuse. Nous, ne dressons pas le
catalogue de nos saints et nous laissons à
Dieu le soin d'inscrire leurs noms au livre de vie.
Mais nous avons, nous aussi, nos saints et nos
saintes et nous prétendons qu'ils ne sont
nullement inférieurs, en beauté
morale, aux plus incontestables de ceux dont aime
à se nourrir la piété de nos
frères catholiques. Or l'histoire des
persécutions de Madagascar abonde en
personnalités religieuses de premier
ordre : Rafaravavy Marie n'est pas la seule
dont on ait conservé le souvenir.
M. Mondain lui-même en a
mentionné un certain nombre dans les deux
grands ouvrages historiques
(1)
qu'il a
consacrés au christianisme malgache.
Souhaitons qu'il puisse nous raconte en
détail une ou deux autres de ces
merveilleuses histoires.
Les Malgaches ont entouré de leur
pieuse vénération ceux de leurs
compatriotes qui ont souffert de la grande
persécution, mais ont en le privilège
d'y survivre. Quand j'étais moi-même
à Madagascar (1902-1904), j'ai vu plusieurs
fois, dans de grandes
cérémonies : religieuses, devant
des assemblées imposantes, un vieillard ou
une femme âgée, la chevelure
toute blanche, les jambes
tremblantes, soutenus sous les bras par de
respectueux anciens de l'Eglise, s'avancer vers
l'estrade qui occupe le fond du temple, en monter
les degrés, et être ainsi
présentés à la foule comme une
sorte de relique vivante d'un passé
glorieux. Aujourd'hui, tous ces témoins de
la persécution, tous ces vieux martyrs des
deux sexes ont disparu, mais ils vivent dans la
mémoire de leurs coreligionnaires. Et pour
nous, protestants français, il est juste que
nous associions leur souvenir à celui de nos
propres martyrs, de toits ces hommes, de toutes ces
femmes, qui, en France ou dans les vallées
vaudoises du Piémont, du XVIe au XVIIIe
siècles, ont été, eux aussi,
« lapidés, torturés,
persécutés, maltraités, eux
dont le monde n'était pas digne, et à
la foi desquels il a été rendu
témoignage... »
(Hébr. XI : 37-39).
Dans le siècle infiniment plus facile
où nous avons le privilège de vivre,
ayons du moins assez de courage, de zèle et
de désintéressement pour ne pas nous
refuser aux sacrifices, en argent et en vies
humaines, que réclame de nous la Mission de
Madagascar. Il s'agit d'aider fraternellement les
descendants spirituels de ces admirables martyrs,
à maintenir leurs positions, et à
conquérir à la foi
évangélique, les vastes
régions de leur île encore
plongées dans la nuit du paganisme.
Jean
BIANQUIS.
Introduction
Ce qui a caractérisé, en grande
partie, le règne de Ranavalona Ire
(1828-1861), c'est la méfiance et
l'hostilité manifestées par cette
reine contre tout ce qui était
européen. Il lui semblait que son devoir de
protectrice de son peuple entraînait pour
elle l'obligation de lutter contre toutes les
influences étrangères, de quelque
nature qu'elles fussent.
Or, l'activité européenne
s'exerçait sous deux formes
différentes. D'une part, l'activité
commerciale, et, de l'autre, l'activité
religieuse de quelques missionnaires assez
récemment arrivés dans
l'île.
Ranavalona sentit que son peuple ne
pouvait vivre complètement
isolé : par nécessité,
elle laissa donc les commerçants à
peu près en paix ; d'ailleurs, ils
étaient protégés par leurs
consuls respectifs. Mais elle se tourna contre les
représentants de l'idée
chrétienne, avec d'autant plus d'ardeur
qu'elle y était poussée par les
gardiens d'idoles.
Au surplus, voulant se heurter le moins
possible aux autorités européennes,
elle fit habilement la discrimination entre les
missionnaires blancs et les adeptes malgaches des
nouvelles idées. C'est contre ces derniers
qu'elle exhala sa fureur et promulgua des
édits de persécution des plus
rigoureux.
Voici, d'ailleurs, ce qu'elle fit
écrire aux missionnaires, le 26
février 1835, au moment même où
elle se préparait à faire sentir
à ses sujets, devenus chrétiens, tout
le poids de sa fureur :
À tous les
Européens, Anglais ou Français,
En reconnaissance du bien que vous avez fait
à mon pays, en enseignant la sagesse et la
connaissance, je vous exprime tous mes
remerciements. J'ai pu être témoin de
ce que vous avez été pour Radama, mon
prédécesseur, et, depuis mon
avènement, vous avez continué
à rechercher le bien de mes sujets.
Aussi je vous déclare que vous pouvez
suivre toutes vos coutumes. N'ayez aucune crainte,
car je n'ai nullement l'intention de modifier vos
habitudes...
... Mais si je vois quelques-uns de mes
sujets vouloir changer le moins du monde les
règles établies par les douze grands
rois, mes ancêtres, je n'y saurai
consentir ; car je ne permettrai pas que les
hommes viennent changer quoique ce soit à ce
que j'ai reçu de mes ancêtres, dont
j'ai accepté, sans honte et sans crainte,
toutes les idées. Il vous est loisible
d'enseigner à mon peuple la science et la
sagesse ; mais quant à ce qui est de
toucher aux coutumes des ancêtres, c'est un
vain travail, et je m'y opposerai
entièrement.
Aussi, en ce qui concerne la religion, soit
le dimanche, soit la semaine, les baptêmes et
les réunions, j'interdis à mes sujets
d'y prendre part, vous laissant libres, vous,
Européens, de faire ce que vous
voudrez...
Signé : RANAVALONAMANJAKA.
Devant cette attitude de la Reine, force fut aux
missionnaires de se retirer, leur présence
ne faisant qu'exciter le courroux des
représentants des idées
païennes.
Mais ils laissaient derrière eux
un certain nombre d'adeptes qui passèrent
bientôt par les circonstances les plus
critiques. Plusieurs payèrent de leur vie
leur attachement aux doctrines chrétiennes,
d'autres errèrent pendant des années
dans les déserts et les endroits les plus
retirés, sans cesse à la veille
d'être appréhendés et conduits
au supplice.
Un tout petit nombre parvint à
s'enfuir hors de Madagascar,
préférant encore l'exil à la
mort certaine.
C'est l'histoire tragique d'une femme,
ayant fait partie de ce groupe de fugitifs, que
nous avons essayé de retracer dans les pages
qui suivent. Non seulement cette histoire
présente l'intérêt le plus vif
à cause des péripéties
dramatiques par lesquelles l'héroïne a
dû passer, mais elle permet encore de
pénétrer un peu plus dans la vie et
les moeurs des gens de l'époque.
Nous avons eu à notre
disposition, comme documents, d'abord deux volumes
très importants, l'un dû à la
plume de M. le pasteur Rabary, qui a écrit
en malgache une émouvante histoire de la
persécution sous Ranavalonamanjaka, l'autre
écrit par deux témoins oculaires, les
missionnaires Freeman et D. Johns
(2),
et
parti à Londres en 1840.
Outre les détails puisés à ces
deux sources, nous avons pu recueillir quelques
données en nous adressant à la
mémoire de certains membres de la famille de
celle dont nous voulions retracer la vie. Enfin,
pour le cadre même de notre histoire, nous
nous sommes appuyés sur nos études
précédentes, concernant les moeurs et
l'ethnographie malgaches. Grâce à ces
lumières diverses, nous croyons
présenter au public une peinture qui serre
la réalité d'aussi près que
possible.
|