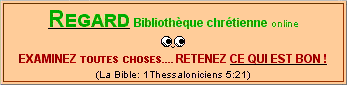
A quatre lieues environ à l'est de Schaffhouse, non loin de l'endroit où les flots du Rhin se précipitent limpides hors du lac de Constance, se trouve l'antique petite cité schaffhousoise de Stein am Rhein. Un pont la relie aux villages thurgoviens de Wagenhausen et de Burg. De là, par un chemin gravissant d'abord une colline, traversant ensuite des champs et des prés, dépassant quelques fermes isolées, on arrive enfin à un assez vaste domaine, que ses plantations prospères entourées de forêts font ressembler à un florissant jardin de Dieu.
Voilà Iben.
On y jouit d'une vue splendide. Monts et vallons, hameaux et manoirs s'entremêlent sous vos yeux émerveillés, jusqu'au miroir étincelant du lac. Dans la forêt ombreuse de la propriété même, au fond d'une grotte naturelle, jaillit une source, bientôt ruisseau riant qui arrose en se jouant la campagne fleurie, court dans la vallée, et passe à côté de la vieille « Papiermühle », qui d'ailleurs n'a plus d'une papeterie que le nom.
Ch.-Aug. Rappard avait un jour, en voyage, passé par là, et, frappé de la beauté unique de l'endroit, il avait résolu d'en faire un jour quelque chose. Ce jour était venu. Il y avait là pour ses fils un beau et vaste terrain encore presque en friche qui allait mettre à réquisition tout ce qu'ils avaient d'énergie et de savoir-faire, et leur fournir l'occasion d'appliquer toutes les connaissances acquises dans la maison paternelle.
Le domaine fut donc acheté, et, au printemps 1856, les parents vinrent eux-mêmes y installer leurs quatre aînés, deux fils et deux filles. Henri venait seulement d'achever sa dix-huitième année, son frère sa dix-septième ; leurs soeurs avaient dix-neuf et seize ans. C'était, on peut le dire, une jeune famille; mais les braves enfants se mirent vaillamment à la tâche qui leur était imposée. L'ancien propriétaire resta encore un certain temps sur place ; on trouva des domestiques capables, hommes et femmes, et les fidèles amis Michod, qui avaient accompagné la famille depuis son départ de Giez, vinrent habiter la « Papiermühle ». L'isolement n'était pas tout à fait le désert. Et surtout les communications avec la maison paternelle n'étaient pas rompues. Le samedi soir, à tour de rôle, un fils et une fille s'acheminaient en voiture vers le Löwenstein, pour y passer le dimanche en famille.
Dès le premier jour à Iben, les quatre jeunes gens eurent leur culte de famille. Etant l'aîné des fils, Henri en prit la direction, s'exerçant ainsi tout jeune à remplir un devoir qu'il considéra toujours comme des plus importants. Les domestiques prenaient aussi part à ce culte.
Les livres étaient rares à Iben; on n'y lisait guère que la Bible. Seuls, quelques volumes poétiques de Schiller avaient, on ne sait comment, trouvé le chemin de cette solitude, et, quand les soeurs portaient à leurs frères aux champs leurs « quatre heures », il leur arrivait de s'asseoir sur le foin fraîchement fauché, de tirer un livre de leur poche, et de leur lire une ballade ou quelque autre poème.
Cet amour des vers provoqua cependant une fois un incident plus sérieux. Les deux aînés avaient rapporté d'un petit voyage les Chansons de Béranger, pour en faire cadeau à leur jeune soeur L., qui avait un goût spécial pour la poésie. Mais en examinant de plus près le volume, ils y rencontrèrent des expressions décidément peu convenables. Henri exposa donc non sans chagrin à sa soeur L. qu'on aurait bien aimé lui faire un plaisir, mais qu'on ne pouvait ni lire ni garder un pareil livre ; et, en dépit de sa riche reliure et de la déception de la chère soeurette, le volume fut livré aux flammes....
Dieu fit reposer sa bénédiction sur la culture du sol. Un drainage intelligent et d'autres installations bien comprises mirent en valeur les champs, et les moissons s'accrurent d'année en année. La maison, de belles dimensions, était du style chalet suisse, ornée de galeries de bois ajouré. Un superbe noyer, tout proche du bâtiment, donnait à l'ensemble un charme particulier.
Iben devint aussi un séjour favori pour les autres membres de la famille, qui aimaient à venir y jouir d'un peu de fraîcheur. Même la grand'mère de Rham se plaisait à y séjourner; et toujours on la remerciait de sa douce présence.
L'année 1859 marqua dans les annales de la famille. Après vingt-cinq années de travail ininterrompu et richement béni aux Indes, le missionnaire Hebich était rentré en Europe et dirigeait des réunions de réveil dans un bon nombre de villes de l'Allemagne du Sud et de la Suisse, produisant partout une impression profonde et obtenant beaucoup de conversions. Lorsqu'il vint à Schaffhouse, le père Rappard se tint d'abord à l'écart, selon sa constante habitude, qui chez lui était affaire de principe et de conviction.
Cependant, lorsqu'une de ses filles lui eut raconté ce qu'étaient ces réunions, il prit confiance et y assista aussi avec les siens.
Les allocutions de Hebich étaient vraiment esprit et vie, et sa proclamation de la grâce trouva dans la famille Rappard un terrain bien préparé.
Le père Rappard lui-même retira de ces réunions une bénédiction signalée et inattendue. Il comprit le danger qu'il y a à se tenir à l'écart de l'Eglise de Christ, et c'est à l'influence de Hebich qu'on peut attribuer le fait que dès la fin de cette année-là il se mit à fréquenter de nouveau avec les siens les cultes publics du dimanche et à se rapprocher des autres enfants de Dieu. Toute la famille a gardé un souvenir ineffaçable de cette matinée de Noël 1859, où, au son des cloches, le père, la mère et les aînés des enfants gravirent ensemble la colline du temple pour aller entendre la prédication du pasteur Burckhardt, un vieil ami de Tubingue.
Dès ce moment ceux d'Iben assistèrent régulièrement de leur côté au service divin dans le petit temple de Burg.
Hebich vint aussi fréquemment plus tard en visite à Iben. Voici ce qu'en racontait un jour un ami:
Rien de plus intéressant que d'entendre discuter ces deux hommes vénérables, Rappard et Hebich, dont la manière de voir était si divergente sur plusieurs points de doctrine, en particulier en matière ecclésiastique. Hebich, au culte du matin, qu'il présidait, pouvait parler deux ou trois heures sur l'Evangile de Jean et l'Epitre aux Romains, dont il expliquait chapitre après chapitre. C'est que visiblement il se sentait si parfaitement à l'aise au milieu de son petit cercle d'auditeurs qu'il donnait libre cours à sa parole. Ses propos parfois tranchants et sa riche expérience de missionnaire et d'évangéliste projetaient sur les enseignements divins des clartés inattendues et singulièrement précieuses.
Plus les pensées qu'il exprimait dans ces méditations étaient élevées ou profondes, plus était frappant le contraste de sa joyeuse humeur dans la conversation ordinaire. Aux promenades de l'après-midi, il plaisantait si gaîment avec les filles de M. Rappard qu'il me sembla même une fois dépasser la mesure. Qu'arriva-t-il alors ? Au culte du soir, Hebich dit qu'il se sentait obligé de faire ses excuses de ce qu'il avait ce jour-là laissé la bride sur le cou à son vieil homme, et qu'il en avait grand chagrin. Effectivement de vraies larmes coulaient de ses yeux et, dans sa prière, il s'humilia fort devant son Dieu et son Sauveur. Il avait de la sorte pleinement reconquis le respect et la confiance de chacun.
Ainsi se trouva encore enrichie cette belle vie de famille. Tous retirèrent bénédiction et profit des relations fraternelles qui se nouèrent avec d'autres membres de la grande famille de Dieu sur la terre.
Et maintenant vint pour Henri l'heure solennelle qui allait donner à sa vie une direction toute nouvelle. Précédemment déjà il avait manifesté le désir d'étudier la théologie, mais comme il semblait poussé plutôt par l'ambition de savoir que par une vraie vocation pour le ministère, son père n'avait pu accéder à ce désir, surtout en considération du courant d'incrédulité qui régnait dans les universités et qu'il n'avait lui-même que trop bien connu dans sa jeunesse. Henri s'était soumis, sachant bien que son père n'agissait pas par caprice, mais par conviction. Peu à peu il avait pris goût à son travail, jouissant de la réussite qui couronnait ses efforts, unis à ceux de son frère Charles.
Vint l'automne 1860. Tandis qu'il ensemençait les beaux sillons d'Iben, il se sentit comme saisi avec une puissance irrésistible par cette pensée : « C'est la semence impérissable de la Parole divine que tu dois semer dans le coeur des hommes. » C'était « comme un feu dévorant dans ses os », et il ne put que reconnaître en toute humilité dans cette volonté souveraine qui s'imposait à lui l'appel du Maître de la moisson.
Son père le comprit aussi, et autant il s'opposait à ce qu'on ne vit dans le ministère pastoral qu'une situation, autant il éprouvait de joie à discerner chez un jeune homme une véritable et divine vocation. Il fit aussitôt les démarches nécessaires et se décida à s'installer avec toute la famille à Iben, de façon qu'Henri fût dégagé de toute attache. Ce qui le confirma dans cette résolution, ce fut le fait que sa fille aînée A. s'offrit aussi avec bonheur pour le service de Christ et entra à Saint-Loup.
Mais avant le départ de ces deux enfants, il y en eut encore un autre, bien solennel celui-là, mais bienheureux aussi, celui de la vénérable grand'mère, rappelée auprès de son Seigneur. Elle fut atteinte d'une grave pneumonie, et l'on comprit bientôt que c'était la fin. Les enfants d'Iben purent venir à temps pour entourer avec les autres le lit de mort de cette noble mère en Israël. Ses dernières paroles restèrent pour toujours gravées dans leurs coeurs : « je vous le dis, en face de la mort la foi est une réalité. » Et un peu plus tard encore : «Je vais voir Celui en qui j'ai cru. Tenons les regards fixés sur la croix. »
C'est ainsi qu'elle s'endormit. C'était la veille de Noël 1860
Après sérieuse enquête, M. Rappard avait choisi, pour la préparation de son fils, l'institution de Sainte-Chrischona près Bâle, dite la Pilgermission (Mission des pèlerins); elle lui paraissait en effet répondre mieux que toute autre, et cela à plus d'un égard, à ses principes et à ses vues. L'entrée devait avoir lieu en automne 1861.
Au printemps de la même année, les parents allèrent rendre visite à une famille amie en Danemark. Ils invitèrent Henri à être de la partie, et il les accompagna en effet jusqu'à Berlin, L'agitation de la grande cité n'eut pas d'attrait pour lui; il soupirait après quelque chose de plus fortifiant. Au lieu de poursuivre jusqu'à Copenhague, il demanda et obtint facilement la permission d'aller à Neukirchen, chercher conseils et encouragements auprès de son cher oncle Bräm, avant d'entrer à Chrischona. Ce furent pour lui des semaines bénies.
Il en fut de même des mois d'été qui suivirent et que diverses circonstances l'obligèrent à passer seul avec sa soeur L. à Iben. Ils étaient encore tous deux sous l'impression des souvenirs du départ triomphant de leur bien-aimée grand'mère, et ce fut une digne conclusion des cinq belles années vécues par eux dans la solitude, sur la montagne.
Pour n'être pas trop incomplet, il nous faut encore citer, avant de clore ce chapitre, les noms de quelques amis d'enfance, dont l'amitié ne fut pas sans influence sur le caractère d'Henri Rappard. Nous avons déjà mentionne le pasteur Burckhardt et sa chère famille; joignons-leur les deux familles toutes voisines des van Vloten, à la Rabenfluh, et des Moser, de Charlottenfels. Henri Rappard et Franz van Vloten s'étaient étroitement liés, et pendant soixante années cette fidèle amitié est restée vivace, fortifiée qu'elle était par une vraie communion spirituelle. jusqu'à la fin, dans ses voyages d'inspection dans la Suisse orientale, Henri s'arrangeait de façon à passer une nuit, si possible, ou au moins quelques heures, à la Rabenfluh, chez « son ami ». A la suite des réunions de Hebich et des bénédictions reçues en commun, on entretint aussi des relations cordiales avec d'autres chrétiens de la ville. Il y eut, dès lors, à Iben comme au Löwenstein, des études bibliques régulières, auxquelles le père Rappard fournissait l'apport de sa riche culture biblique, et qui furent en bénédiction à beaucoup.
Nous trouvons dans une lettre d'une des plus anciennes amies de ce temps-là, une des filles du pasteur Burckhardt, un portrait si vivant que nous ne pouvons résister au plaisir de le reproduire.
Je le revois, lui, non pas l'inspecteur de Sainte-Chrischona, mais le jeune Henri Rappard du Löwenstein et d'Iben, le type du jeune homme noble et chevaleresque, mettant comme pas un, toute son énergie à se soumettre à l'autorité paternelle, sans rien céder toutefois de sa vaillance et de son quant à soi. C'était toujours avec admiration que mes parents parlaient de lui, alors qu'il s'arrêtait à notre porte avec sa voiture en allant chercher quelqu'un pour le Löwenstein, et qu'on le voyait si modeste et si serviable, sous ses apparences de prince déguisé.
Et à Iben, comme alors déjà il incarnait positivement l'idéal rêvé par son père, à la fois patriarche et sacrificateur, campagnard et gentilhomme, tel qu'on a pu le voir sa vie durant, avec sa personnalité si remarquable. Tel aussi il revivra, non seulement dans le souvenir de ceux qui l'ont connu, mais aussi dans l'histoire de l'évangélisation, partout où il a porté, de la façon qui lui était propre, la bonne nouvelle du salut.
Enfin, en octobre 1861, Henri dit adieu à la maison paternelle pour aller achever à Sainte-Chrischona la préparation commencée déjà par toute l'éducation qu'il avait reçue.
Précédent:2. Au Löwenstein
Suivant:1. A Sainte-Chrischona