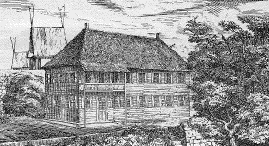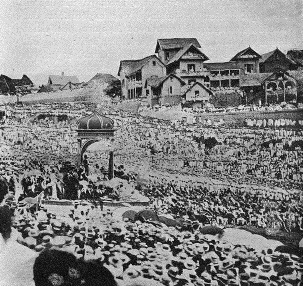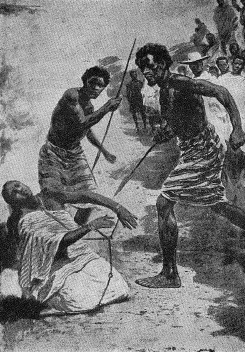RAFARAVAVY
MARIE
(1808-1848)
Une
Martyre Malgache sous Ranavalona
1re,
CHAPITRE IV
Premières épreuves
Au bout d'un an environ, Rafaravavy se sentit
assez forte pour s'ouvrir à son mari de ses
nouvelles croyances. Il n'en fut qu'à demi
étonné, car il avait fini par se
douter de la chose. Il aimait beaucoup sa femme et
subissait son ascendant. Évidemment il
essaya de lui montrer les dangers qu'elle courait,
d'autant plus que, depuis quelque temps,
d'inquiétantes rumeurs se
répandaient, qui indiquaient une
recrudescence du culte des fétiches et
faisaient prévoir de graves mesures contre
tous ceux qui oseraient s'en écarter. Mais
il se sentit vite incapable de répondre aux
arguments de sa femme et se renferma dans
l'attitude fataliste, et en apparence
indifférente, qui est le refuge habituel du
malgache appréhendant des difficultés
sérieuses.
C'est seulement le 29 mai 1831 que le
missionnaire Griffiths put baptiser les premiers
chrétiens qu'une longue période
d'enseignement et d'épreuve avait
désignés pour ce pas décisif.
Rafaravavy ne fut pas de
ceux-là. Il y avait trop peu de temps
qu'elle s'était déclarée en
faveur du christianisme. Elle dut attendre quelques
mois. Mais elle se distingua vite par son
zèle et son ardeur. Aussi
abrégea-t-on un peu pour elle et
quelques-uns de ses compagnons le délai
imposé à la plupart des candidats au
baptême.
Quand ce jour arriva, son émotion
fut intense. Aux sentiments ordinaires en une
semblable circonstance, s'ajoutaient ceux que
faisaient naître chez elle et chez tous ses
compagnons les bruits de plus en plus précis
répandus contre les chrétiens et
l'annonce des premières mesures prises par
le gouvernement de la Reine.
On venait d'apprendre que le
gouvernement avait enjoint au missionnaire
Griffiths de quitter l'île, sous le
prétexte que la période de dix ans
accordée par Radama venait d'expirer. De
fait il obtint de rester un peu plus longtemps. Un
autre agent de la Mission de Londres, M. Atkinson,
dut s'en retourner après à peine un
an de présence.
Plus grave encore fut l'ordre
donné à tous les, officiers oui
soldats de s'abstenir de toute pratique religieuse
européenne, et, quelques semaines
après, dans les derniers jours de
l'année 1831, l'interdiction complète
aux missionnaires d'administrer le baptême
à quelque malgache que ce fût.
La persécution n'avait pas encore
vraiment éclaté. Mais c'en
était les prodromes non
équivoques.
Dès le lendemain de son
baptême, Rafaravavy se rendit compte qu'elle
aurait à subir les plus
douloureuses
épreuves ; encore ne
prévoyait-elle pas tout ce qui allait lui
arriver : si elle avait pu le savoir d'avance,
petit être n'aurait-elle pas eu le courage
d'affronter ce qui l'attendait.
Le jour de son baptême elle avait
pris le nom de la mère du Christ, Marie. On
aurait pu lui appliquer en partie les paroles que
l'évangile de Luc met dans la bouche du
vieillard Siméon, s'adressant à la
mère de Jésus : « Une
épée te transpercera
l'âme ».
Pendant les années 1831 à
1835, la prédication de l'Évangile
continua, en dépit des édits royaux
qui interdisaient les cérémonies du
baptême et de la sainte Cène. Mais le
prosélytisme devenait de plus en plus
difficile.
D'autre part, des espions se glissaient
dans les auditoires et rapportaient à la
Reine ce qu'ils avaient entendu ou ce qu'ils
prétendaient avoir entendu. Car ils
transformaient les paroles
prononcées.
Un missionnaire à l'oeuvre
à cette époque, M. Freeman, en donne
des exemples caractéristiques.
« Au commencement de 1835,
dit-il, un indigène s'adressant à un
petit groupe de chrétiens de la capitale,
déclara que Dieu punirait au dernier jour
les ouvriers d'iniquité et
récompenseraient ceux qui l'auraient
aimé et servi.
« On présenta ces
paroles à la Reine comme une menace contre
elle. Elle ordonna d'envoyer des espions à
la réunion suivante. Le prédicateur y
parla de la résurrection :
« Tous les hommes ressusciteront, dit-il,
et Dieu seul les jugera. »
« On fit alors un compte-rendu
à la souveraine, prétendant que
l'orateur aurait déclaré que seuls
les sujets de la Reine seraient l'objet des
jugements de Dieu.
« C'est faux, s'écria
la Reine, j'ai le droit de juger mon peuple.
D'ailleurs comment ces radoteurs savent-ils que
Dieu ressuscite les morts ? Je n'ai jamais
entendu dire chose pareille. Et, si cela
était, j'en aurais été la
première
informée. »
Rafaravavy fut témoin d'un autre
incident qui eut mi grand retentissement dans la
capitale.
Un jeune homme de la caste des
Andriamboninolona
(1), nommé
Andriantsoa, s'était joint aux
chrétiens de la ville. Il chercha à
répandre les idées nouvelles dans son
village où le fétiche tribal portait
le nom de Ratsisimba « celui qui ne peut
souffrir aucun dommage ». Le jour
spécialement consacré à
l'idole était le samedi et personne ne
devait travailler ce jour-là. Andriantsoa se
mit un certain samedi en devoir de travailler ses
rizières.
Tout un groupe de gens voulut s'y
opposer. D'où vive discussion sur l'idole.
Andriatsoa, tout en se moquant de la superstition
des gens, finit par cesser son travail devant la
colère croissante de ses
interlocuteurs.
Mais alors on le força, pour
revenir au village, à passer par tous les
détours des digues séparant les
rizières pour n'avoir pas à traverser
une de ces rizières :
car mettre le pied dans une rizière, le
samedi, irritait, parait-il, l'idole. Il en fut
fort ennuyé et, en rentrant chez lui,
raconta l'affaire à un ami, non sans lancer
quelques sarcasmes un peu vifs contre les
imbéciles qui faisaient tant d'histoire d'un
bout de bois qu'on pourrait souiller
d'excréments de chien sans qu'il puisse
même protester.
 Rizières
en gradins dans le Betsiléo
Rizières
en gradins dans le Betsiléo
Une esclave rapporta le propos aux gens qui
coururent raconter l'affaire à
Razakandrianaina, un des officiers de la Reine
ayant le rang de onzième honneur, et qui
était aussi de la caste des
Andrianiboninolona. Ce dernier fut d'autant plus
zélé à poursuivre l'affaire
qu'il s'y trouvait intéressé. Peu de
temps auparavant, il avait cherché à
se faire donner un terrain appartenant à
Andriantsoa. Ce dernier n'avait pas accepté.
D'autre part, une de ses six femmes,
dont trois étaient soeurs, avait
été amenée par Andriantsoa
à assister à une réunion
chrétienne et avait appris à lire, ce
qui avait irrité au-delà de toute
expression son époux et avait
été la cause de son divorce
immédiat.
Razakandrianaina formula donc devant les
juges une accusation formelle contre
Andriantsoa : « Il changeait toutes
les coutumes sacrées des ancêtres,
méprisait les fétiches, amenait par
cela la grêle sur les, rizières, ne
respectait aucun fady, ne jurait pas, reprochait
aux gens de ne pas assez respecter les femmes,
travaillait le samedi, priant sans cesse sans
jamais faire allusion aux dieux nationaux, et
faisait des réunions la
nuit. »
Le juge hésitait à
condamner le jeune chrétien. Il fit
toutefois demander l'avis de la Reine, ajoutant que
Ratsisimba (le fétiche d'Ambohitromby)
consulté aurait déclaré
qu'à moins de la condamnation à mort
de l'insulteur, on ne pourrait sauver la
récolte de riz.
La Reine ordonna de soumettre
l'accusé au jugement ordalique du tangena.
Ce qui fut exécuté sur le
champ.
À la grande surprise de tous, le
jugement se montra favorable à
l'accusé qui, durant quelques jours, alla,
suivant l'usage en pareille circonstance, se
reposer dans un village de la campagne.
Le jour où il revint à la
capitale, ses amis étaient si heureux de sa
délivrance qu'ils commirent
l'imprudence de lui faire
cortège et de lui ménager une sorte
de triomphe.
La Reine en fut avertie et
profondément irritée. Elle crut y
voir une sorte de défi à son
égard.
Razakandrianaina fut encore plus
touché que sa souveraine. C'était
pour lui un véritable soufflet, en
même temps que la ruine de ses espoirs
touchant la terre qu'il avait déjà
escomptée comme sienne. Il chercha sa
revanche.
Après s'être
déguisé, il se glissa dans une
réunion tenue le soir par un esclave devenu
chrétien, et où, s'appuyant sur un
passage du livre de Josué, l'orateur
poussait ses auditeurs à abandonner les
idoles pour servir Jéhovah et
Jésus-Christ. C'en fut assez pour
Razakandrianaina qui partit accuser les
chrétiens de servir les ancêtres des
Blancs (il faisait de Jéhovah leur premier
roi, et de Jésus-Christ le second).
Pendant les derniers mois de 1834 et les
deux premiers, de 1835 la situation des
chrétiens ne fit qu'empirer. Les uns
après les autres, les missionnaires
recevaient l'ordre de partir. Quelques-uns
seulement étaient parvenus à demeurer
en invoquant les bienfaits qu'ils apportaient au
peuple par l'enseignement des arts manuels.
Malgré cela, les réunions
continuaient ainsi que nous l'avons vu. Parfois
même, malgré l'interdiction
de la Reine, on arrivait
secrètement à baptiser de nouveaux
convertis, et à distribuer la
Cène.
L'impression de la Bible continuait,
ainsi que celle de la traduction malgache du
Voyage du Pèlerin.
Rafaravavy Marie se distinguait parmi
tous ses compagnons par son zèle de plus en
plus ardent.
Elle ne cessait d'aller visiter les uns
et les autres, les encourageant, les
réconfortant par son assurance et ses
exhortations toujours appropriées aux
circonstances.
Son époux l'avait quittée
et était retourné dans son village.
Il avait fini par s'effrayer du danger que sa femme
lui faisait courir à lui-même. Il en
avait même parlé à son
beau-père Andrianjaza, qui avait
été très ennuyé de la
chose et était allé visiter sa fille
en ville, afin de lui interdire de suivre les
coutumes européennes.
Rafaravavy avait été
très émue de cette visite et du
pénible entretien qui l'avait
marquée. Elle essaya de montrer à son
père la Vérité, sans
succès d'ailleurs. Elle le rassura pourtant
en partie en lui garantissant que la plupart des
accusations portées contre les
chrétiens étaient fausses, et qu'ils
étaient tous décidés à
être de bons et fidèles sujets de la
Reine.
Ranavalona avait reçu avec une
sorte de rage les accusations
véhémentes de Razakandrianaina, que
celui-ci avait d'ailleurs su rendre dramatiques,
faisant mine de vouloir se tuer devant sa
souveraine, tant, disait-il, étaient grandes
sa douleur et son épouvante de voir les
dieux ancestraux bafoués.
Et ce fut très peu de temps
après qu'elle décida de mettre
entièrement fin aux prédications des
missionnaires et aux pratiques chrétiennes
qui lui apparaissaient comme une insulte à
sa personne, aux fétiches royaux et à
la nation entière.
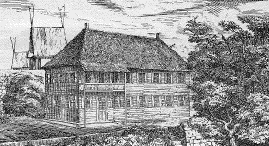 Une des
premières maisons où
l'Évangile à été
prêché à Tananarive
Une des
premières maisons où
l'Évangile à été
prêché à Tananarive
Le 22 février 1835, elle ordonna aux
femmes et jeunes filles qui avaient appris à
coudre avec les dames missionnaires, et avaient
été plus ou moins
réquisitionnées pour le service du
palais, de se réunir. C'était un
dimanche, et elle savait que ce jour-là
elles cessaient d'habitude leur travail pour aller
assister aux réunions chrétiennes.
Passant près d'elles dans la journée,
elle leur lança en guise de moquerie cette
phrase : « Vous devriez demander la
permission aux Européens de coudre pour
moi ».
Ce même dimanche, la petite
chapelle d'Ambatonakanga était
bondée, et Rafaravavy s'y trouvait. Un des
anciens juges royaux apprit que sa fille, amie de
Rafaravavy, y était aussi, bien qu'il le lui
eût rigoureusement interdit le matin
même. Ne la voyant pas à la maison
vers onze heures, il s'en alla, avec deux ou trois
de ses secrétaires, vers la chapelle, et
chercha à la découvrir. Il y avait
une telle foule qu'il ne la reconnut pas. Il fut
absolument surpris du nombre des assistants, et ou
l'entendit dire a l'un de ses compagnons :
« C'est bien la dernière fois
qu'on verra ce spectacle. » On le savait
en général bien informé, et
les craintes des chrétiens
redoublèrent.
Le mardi suivant, ou sut qu'un ordre
secret avait été donné de
fournir a la Reine la liste des maisons où
des réunions cultuelles s'étaient
tenues, ainsi que celle des baptisés
connus.
Le mercredi, Rafaravavy apprit par ses
parents que les principaux chefs de chaque
district, et, en particulier ceux d'Avaradrano,
région de laquelle dépendait sa
tribu, avaient été appelés
à la capitale pour donner leur avis sur les
mesures propres à arrêter la
propagande chrétienne.
Elle sut aussi que la majorité
des délégués des districts
avaient plutôt parlé en faveur des
chrétiens. Cela ne l'étonna pas outre
mesure. Elle avait senti depuis un certain temps
qu'un revirement avait commencé à se
produire dans les opinions des gens, au moins de
cette partie du peuple qui savait encore
réfléchir. Elle avait
été étonnée même
de la facilité relative
avec laquelle sa propre famille, pourtant si
attachée aux coutumes païennes, avait
en fait accepté sa nouvelle situation.
Évidemment on la lui reprochait encore. Ses
parents s'en attristaient et en concevaient une
appréhension non déguisée.
Mais ce n'était plus l'indignation ni la
terreur des premiers temps. L'exemple de la vie
renouvelée, de la droiture, du
dévouement des disciples du Christ semblait
commencer à porter quelques fruits
indirects. Un des officiers du palais,
Rainingitabe, avait osé dire ouvertement
à la Reine, devant ses collègues
rassemblés, que ses meilleurs aides
étaient les sectateurs du nouveau culte.
« Je n'ai jamais rencontré,
déclara-t-il, de gens aussi honnêtes
et aussi zélés qu'eux. À
quelque lieu que vous les envoyiez, de jour ou de
nuit, ils y vont ; quoiqu'on leur confie comme
travail, ils le font vite et
bien. »
De fait la Reine fut un instant
ébranlée. Mais ses conseillers
intimes étaient trop zélés
pour les fétiches et trop
intéressés à leur
conservation ; ils triomphèrent de ce
moment d'hésitation.
Dès le jeudi, les missionnaires
assemblés dans la maison de M. Griffiths
reçurent une lettre de la Reine leur
interdisant tout acte de prosélytisme, et
annonçant sa résolution
irrévocable de ne souffrir aucun changement
de la part de ses sujets, en ce qui concernait les
coutumes religieuses ancestrales.
Beaucoup de chrétiens.
assistaient à la lecture, du message royal.
Il se peut que Rafaravavy ait été du
nombre.
L'émotion chez tous était
à son comble. On se sentait à la
veille de tragiques événements.
Beaucoup de visages reflétaient l'agitation
du coeur ; des fronts se creusaient de rides
et des figures se cendraient. Rafaravavy, elle, se
recueillait. Elle essayait, autant qu'il
était en elle, de se rendre compte de ses
sentiments et de la force de sa foi. Ce premier
examen de conscience la rassura en partie.
Toutefois, elle crut utile de chercher
du secours auprès d'autres, plus
avancés dans la connaissance des choses
religieuses.
Avec quelques amis, elle
pénétra chez un missionnaire, lui
demandant conseil et consolation. Et il y eut ce
jour-là, dans la chambre du missionnaire,
une bien émouvante réunion, où
ce petit groupe de chrétiens se sentit
soudain uni par ces liens tout nouveaux et si
puissants du danger commun.
Le serviteur de Dieu put, à
l'issue de l'entretien, donner à chacun un
livre destiné à aider son possesseur
à rester ferme au milieu des tribulations
qui l'attendaient.
Ce même jour, un grand nombre de
gens de la campagne commencèrent à
arriver en ville, appelés déjà
pour assister au grand discours public qui devait
avoir lieu incessamment. La foule s'augmenta le
lendemain d'autres délégués
des districts, et aussi d'un assez grand nombre de
Sakalava de la côte ouest venus juste
à ce moment prononcer leur serment
d'allégeance à la Reine.
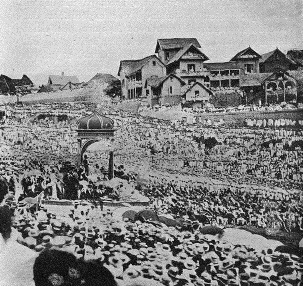 Proclamation
royale (place d'Andohalo)
Proclamation
royale (place d'Andohalo)
Ancienne
photographie prise au temps de Ranavalona II
(1868-1882)
Le samedi 28 février, des soldats de
toutes les régions vinrent
camper autour de la grande place d'Imahamasina. Le
dimanche, à la première heure, on
établit une longue ligne de soldats
armés, mais habillés en civil, tout
le long de la route conduisant
à la place, tandis que
d'autres troupes, revêtues d'uniformes neufs,
entouraient le trône préparé
pour Ranavalona.
Au moment où les Sakalava,
accompagnés des officiers qui avaient
commandé des expéditions dans
l'ouest, arrivèrent à l'entrée
de la place, les canons tonnèrent ait haut
de la ville et les soldats répondirent par
des décharges de mousqueterie, et par des
roulements et des battements de tambours aussi
bruyants que possible.
Le peuple rassemblé fit
à son tour retentir la place d'un formidable
concert d'acclamations, puis des soldats
dansèrent une danse guerrière.
Après quoi les Sakalava
prêtèrent serment. Puis le principal
juge se leva pour faire admirer à la foule
quelques-uns des fusils que des artisans malgaches
avaient réussi à fabriquer pour
remplacer ceux que jusque-là le Gouvernement
malgache payait trente piastres espagnoles aux
trafiquants. On fit partir quelques-uns de ces
fusils qui firent une décharge bruyante,
à la grande joie du peuple.
Et ce ne fut qu'après tout
cela que fut prononcé le grand discours sur
le respect dû aux idoles nationales, et sur
l'impossibilité pour la Reine de laisser
s'introduire dans le pays dont elle avait la charge
des coutumes nouvelles qui irriteraient les dieux.
On donnait un mois aux chrétiens pour se
dénoncer et implorer le pardon de
Ranavalona, à défaut de quoi ils
encourraient la peine de mort.
Après le discours royal,
chaque chef de région se
leva pour émettre son
avis. Le représentant du nord, que
Rafaravavy connaissait, Ramantavary, essaya de
défendre la cause des chrétiens,
montrant qu'ils n'avaient fait que suivre certains
encouragements donnés par Radama,
déclarant que désormais ils
suivraient la loi commune, et demandant que la
Reine se contentât du payement d'une piastre
et d'un boeuf par région en signe de
repentir et de soumission.
La foule approuva. Mais, le
lendemain, le peuple, fut de nouveau
rassemblé et informé que le
délai imparti aux chrétiens pour
s'accuser était réduit d'un mois
à une semaine.
On peut penser à quel
degré monta l'agitation de ces derniers. Il
y eut des faibles qui
préférèrent se dénoncer
et quitter leurs amis ; il y eut même
quelques personnages qui allèrent
jusqu'à accuser certains de leurs anciens
compagnons pour se faire bien voir et pour
éviter l'effet de la colère de la
Reine.
Le plus grand nombre, cependant,
resta ferme, quelques-uns se contentant de fuir
dans un lieu désert, d'autres attendant
simplement la manifestation de la volonté
divine.
De ces derniers fut Rafaravavy qui,
à l'issue de la proclamation royale,
était rentrée chez elle et avait
passé une grande partie de ses
journées - durant cette semaine fatale
où, d'après les ordres de la Reine,
elle aurait dû se dénoncer -, à
prier, à méditer et à se
fortifier spirituellement.
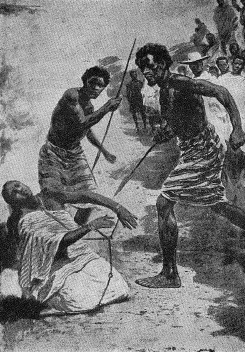 Rasalama, la
première martyre malgache percée de
lances
Rasalama, la
première martyre malgache percée de
lances
|