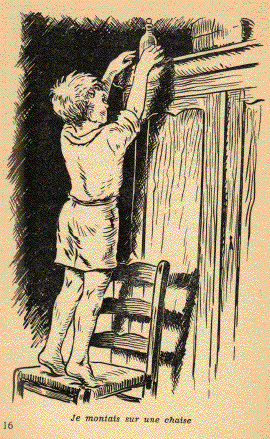La Grande Soif
CHAPITRE PREMIER
Orphelin! Existe-t-il mot plus triste?
Aujourd'hui que je suis parvenu au seuil de la
vieillesse, il me pèse encore sur le coeur.
Douloureux, je tressaille quand je vois une
mère qui caresse son enfant. Mille souvenirs
cruels me reviennent...
Je suis né à
Saint-Hélier, île de Jersey, le 23
novembre 1884, de parents français. Ma
mère, m'a-t-on dit, regagna la France alors
que je n'avais que quelques semaines. Comme
certaines personnes avaient intérêt
à ma disparition, on me cacha en divers
endroits, jusque dans une grosse meule de foin
où les dents d'une fourche me
blessèrent au pied. La cicatrice est encore
visible. Qui me sauva, qui me fit admettre aux
Enfants trouvés? Je l'ignore. De braves gens
qui m'adoptèrent plus ou moins, vinrent m'y
prendre.
Mon premier souvenir d'enfance me montre
un beau et grand vieillard, aux cheveux et aux
favoris blancs comme neige. Il me tient sur ses
genoux, il retire le dard de l'abeille qui m'a
piqué et me console doucement. Souvent,
parlant de moi à ma mère
nourricière, il dit: Pauvre petit !
Un hiver. Il fait très froid,
très froid. Mon protecteur ne quitte plus
son lit où je le vois un jour, pâle,
inerte, silencieux. Bientôt, donnant la main
à ma mère nourricière, je suis
son cercueil en pleurant. Car il fut bon pour moi,
cet homme.

Souvent, il me caressait les joues, il me disait
avec une voix bienveillante: Paul, ne touche pas
à ce couteau... Ne t'approche pas trop du
feu... Ne piétine pas les fleurs de la
plante-bande. » Autour de lui je gambadais en
riant. Et voici qu'il est mort, que je n'ose
m'approcher de son lit, que je trottine
derrière la longue caisse où on l'a
enfermé jusqu'au triste endroit qu'on
appelle le cimetière. Un trou noir
reçoit mon seul ami. je pleure..
Après, dans la maison perdue en
rase campagne, quelle tristesse ! Ma mère
nourricière demeurait des heures sans
parler, soucieuse. En cachette, elle essuyait des
larmes. Alors, car je l'aimais beaucoup, je
grimpais sur ses genoux, je nouais mes bras autour
de son cou, je l'embrassais, « Maman, pourquoi
pleures-tu ? - J'ai du chagrin, mais tu es trop
petit pour comprendre. » je l'embrassais
encore. Alors elle souriait un peu. «Tu
m'aimes, brave petit ? Je te le rends bien.
»
Bientôt un homme s'installa dans
la maison comme pensionnaire. Je lui offris mon
affection d'enfant. Ce qui est faible va tout
naturellement vers la force, ce qui est petit vers
ce qui est grand. Il me traitait gentiment. Je
jouais avec son chien une jolie bête noire et
frisée. Petit à petit, Léon Le
Gallois prit de l'autorité dans la maison et
devint le maître.
J'ai su plus tard que ce Le Gallois
avait été prêtre,
qu'après une lutte cruelle il quitta la
soutane et se maria. Peu après, sa femme
tomba gravement malade et mourut. Cette catastrophe
révolta Le Gallois. Pour oublier il se mit
à jouer, à boire, puis se ressaisit,
remonta la pente et se remaria. Le jeune couple
prit la direction d'un hôtel. Tout d'abord
les affaires marchèrent bien. jusqu'au
moment où Le Gallois, corrompu par de
mauvaises compagnies, chercha de nouveau dans
l'alcool l'oubli de ses soucis. Car sa femme,
minée par la tuberculose, déclinait
de jour en jour. Après trois ans de mariage,
elle s'éteignit. De désespoir, Le
Gallois but encore davantage. Constamment ivre, il
blasphémait, il accusait la
société. Bientôt ce fut le
désastre financier, la brouille avec les
beaux-parents... Plus d'argent, pas de travail. Un
magistrat eut pitié et employa le
dévoyé pour un temps, au greffe du
tribunal. De chute en chute Le Gallois, locataire
d'une mansarde, se loua pour couper le bois des
maisons bourgeoises, envoyant même pour ce
travail des ouvriers qui besognaient à sa
place pendant qu'il buvait.
C'est à ce moment que Le Gallois
s'installa dans la maison de ma mère
nourricière. Voilà l'homme qui allait
me servir de père !
J'avais grandi. je commençais
à aller au « pays » faire les
commissions de la maison. Un jour, Le Gallois
m'ordonne « Viens avec moi au café !
» Ma mère nourricière tient
tête à l'ivrogne qui la bouscule, la
gifle, me saisit par un bras et m'entraîne en
titubant. Il tombe, jure, se relève, se
remet en marche et pousse enfin la porte du
débit. Pour moi une grande moque (grande
tasse) de cidre. Pour lui un petit pot d'eau-de-vie
et un café. Des amis de bouteille s'asseyent
à notre table.. En riant on m'offre aussi un
café, puis un verre de calvados. Cette
boisson me parait un peu forte. Mais (j'avais
à peine six ans!) je veux faire l'homme et
avaler la drogue sans me douter, bien sûr,
que cette boisson serait la malédiction de
ma vie.
Les petits pots succèdent aux
petits pots. Il se fait tard.
- Allez, on rentre
Le « père » Léon
tient à peine debout. La tenancière
du caboulot, une brave femme, me dit avec
anxiété: « Pourras-tu, petit,
ramener ce diable d'homme à la maison ? Il
en a une cuite ! »
Je saisis la main de l'ivrogne. En
route! Après cinquante pas, patatras !
l'homme est par terre, sa casquette dans le
fossé. Un bec de gaz nous éclaire.
Passe un ouvrier. Il tente vainement de relever le
soûlard qui demeure vautré dans la
boue. Avertie par le bruit que nous faisions, la
tenancière sort de son caboulot et
s'approche. Alors elle fait une vraie
conférence que l'ouvrier écoute sans
mot dire :
- C'est-il pas honteux! Quand il boit,
il ne se connaît plus. Foi de
commerçante, j'aimerais mieux ne pas voir
ça. Ah ! la boisson ! Elle vous fauche le
gaillard le plus vigoureux, le plus intelligent.
Parce que, intelligent, il l'est, cet homme. Il
vous a un raisonnement de notaire, de juge. Il en
sait long. Il connaît le code, les lois. Ce
qu'il en dit est net, précis. Les comptes,
il vous les établit, et justes, en un rien
de temps. Et la politique, donc ! Parlementaires,
consuls, ministres, il déblaie tout cet
embrouillage, et toutes les lâchetés,
toutes les crapuleries. Quand il a bu, va te faire
lanlaire ! Un pourceau qui gigote, qui barbote dans
le ruisseau, dans le tout à
l'égout... Quand on sait ce qu'il a
été, cet homme ! Maintenant, pire
qu'une bête, oui, pire!...
Enfin, voici Léon debout. Je lui
reprends la main. Nous nous éloignons dans
la nuit. La tenancière du encore: «
Pauvre petit Paul pauvre enfant ! Il en a du
malheur! »
Nous zigzaguons dans un étroit
chemin bordé de haies. Le père
Léon juré comme un païen. Puis
il entonne soudain sa romance favorite :
Dans un bosquet tout rempli de
fraîcheur
J'aurais voulu la regarder sans cesse...
Brusquement, les paroles s'étranglent. Un
craquement, un rugissement et la
dégringolade.
- Lève-toi, père !
- Propre à rien! Tu ne peux pas
me soulever? Fainéant !
Abandonnant l'ivrogne, tremblant de peur
et de froid, je m'élance jusqu'à la
maison où ma mère nourricière
est assise devant un souper froid. À ma vue,
elle lève les bras au ciel et court à
ma suite, guidée par les ronflements du
poivrot profondément endormi. Rien à
faire pour le réveiller! De guerre lasse,
nous abandonnons la partie. Le froid se chargera,
les fumées de l'alcool
évaporées, de remettre le malheureux
sur pied.
Sitôt à la maison, ma
mère nourricière me demande: - Que
t'a-t-il donné à boire ?
- Du café, du cidre et de
l'eau-de-vie.
- Du café, du cidre, ça va
à peu près. Mais de l'eau-de-vie!
Dégoûtant! Stupide ! Tu as bien le
temps d'apprendre à boire cette
saleté ! Regarde l'état où est
ton père. Il y a de quoi mourir de honte
!
Au petit matin, Léon
apparaît, pâle comme un mort, les
cheveux emmêlés, sans casquette, sale,
puant la boue des fossés et
l'eau-de-vie.
Cette scène se renouvelle
souvent, le samedi soir, surtout après la
paye. Il arrive que la noce dure jusqu'au dimanche
à midi. Léon ne revient que pour
réclamer de l'argent, car il a tout
dépensé.
- De la galette et vivement, n. de D.
!
- Non, tu n'auras rien. Tu as assez bu
pour, une fois...
Alors des injures ignobles. L'ivrogne se
précipite. Je suis bousculé. Je tombe
à terre, le père Léon
par-dessus moi. Relevé, il saisit la
marmite, vide le pot-au-feu sur le plancher, jette
assiettes, cuillères, pain, tout ce qui lui
tombe sous la main à la tête de ma
mère nourricière qui empoigne la
louche et arrose son compagnon avec le reste de
bouillon gras, puis s'empare de la pelle à
feu et projette sur l'adversaire cendres, braises
du foyer, puis, armée de pincettes, frappe
à coups redoublés avant de fuir dans
le jardin. Déjà, le fou est
près d'elle. Il frappe, des deux poings, de
toute sa force. Un filet de sang ruisselle sur le
front de ma mère nourricière qui
s'effondre. La brute fouille dans les poches du
tablier de sa victime et en retire l'argent
convoité.
- Ah ! le voilà ce sacré
poignon !... Viens au café, Paul.
- Non !
je pleure.
- Qui est-ce qui commande? Pas les
gosses, pourtant! Viens ou je te casse les
reins!
Vaincu, je l'accompagne.
Trêve d'abominations ! jour
après jour ma sensibilité d'enfant
fut meurtrie. Cinquante années se sont
écoulés depuis lors ; j'ai
traversé des aventures inouïes, mais
jamais ces scènes ne s'effaceront de ma
mémoire. Hélas ! graduellement je
m'habituais, je m'endurcissais. Comment un enfant,
un gosse pourrait-il résister ? Petit
à petit, je prenais goût à
l'eau-de-vie qu'on m'offrait. Ce père
Léon, qui me faisait horreur à cause
de sa brutalité. exerçait pourtant
sur moi une influence sans cesse
grandissante.
- Au café, petit!
Et j'y allais.
Bientôt je pris l'habitude de
manquer l'école et d'aider le père
Léon dans son travail. Le bois qu'il avait
coupé, je le transportais dans une brouette,
je le jetais dans une cave par un soupirail.
Adroit, je gagnais quelque argent. je prenais ma
place parmi les adultes. Avec eux, je m'installais
au café. J'aimais l'alcool, maintenant. Une
« demoiselle » (tasse d'eau-de-vie) ne me
faisait pas reculer. Ça me
réchauffait, m'excitait. Et le père
Léon disait :
- Voyez Paul, il n'a pas peur de boire
carrément son petit pot. Il vous avale
ça comme un homme de trente ans. Ça
promet, des lurons de ce calibre!
Les ouvriers avançaient leur
verre:
- À ta santé, petit Paul
!
J'étais fier d'être au
centre de ce cercle. Et je dégustais la
boisson, lentement, je faisais claquer ma langue,
disant: « Ça fait du bien, c'est bon,
ça donne des forces ! »
Vraiment, j'émerveillais ces
buveurs. L'apprenti paraissait de taille à
dépasser ses maîtres. Je devais, en
effet, les dépasser et d'un bon bout! De
jour en jour j'aimais davantage l'eau-de-vie.
Boire, devenait une jouissance, une
nécessité, une passion, et je n'avais
pas huit ans!
Souvent, je rendais de petits services,
ici et là, et l'on me donnait deux sous.
L'argent gagné, je le cachais dans le
grenier, ayant mon idée. La première
fois que je me rendis dans un café et, y
demandais de l'eau-de-vie, on refusa de me
servir.
Que faire ? Je ne fus pas long à
trouver la solution. Nous avions à la maison
une bouteille spéciale pour l'eau-de-vie. La
débitante la connaissait bien. Alors, le
truc était simple.
Madame Letrône, pour le
père Léon!
Dissimulant la bouteille, je me
faufilais dans le grenier et versais l'eau-de-vie
dans un autre flacon soigneusement caché
derrière un tas de bois. Désormais,
j'eus toujours ma « réserve »
personnelle d'eau-de-vie. C'est dans ce grenier,
aussi, que je me mis à fumer la cigarette.
Confectionner la première fut toute une
affaire. J'étalai une feuille sur le
plancher, une pincée de tabac sur la feuille
et je cherchai à la rouler, mais elle creva.
La seconde, la troisième aussi. La
quatrième me remplit d'espoir. Mais quand je
passai ma langue sur le papier, il mollit et se
déchira. Enfin, tant bien que mal, j'aboutis
à peu près. L'ingénieur qui
mène à chef une grande invention
n'est pas plus fier que je ne le fus alors !
Triomphant; je sortis de sa cachette ma bouteille
d'eau-de-vie, j'allumai ma cigarette et buvant,
fumant, je me jugeai parvenu au faîte du
bonheur !
Vers ce temps-là, à force
de boire, le père Léon perdit une
grande partie de sa clientèle. À la
maison ce fut la misère: le matin, un peu de
pain sec, à midi, une soupe aux
légumes; le soir, encore de la soupe. Mes
habits, des haillons. Ma mère
nourricière se résigna à
mendier. je l'accompagnai, le lundi et le jeudi,
devant les portes cochères des maisons
bourgeoises. Le concierge entrebâillait la
porte et donnait à chacun un ou deux sous.
Au couvent des Ursulines on recevait un bon morceau
de pain de seigle. Ma mère
nourricière me disait parfois : « Va
vers ce monsieur... Vers cette dame. » Timide,
rougissant, je m'approchais. Peu à peu,
devenu physionomiste, j'appris les trucs du
métier. J'inventais des histoires pour
exciter la pitié. Grâce à mon
imagination je réussissais assez
bien.
Un soir, le père Léon me
dit:
- J'ai trop de peine tout seul. Tu vas
lâcher l'école.
Averti, mon instituteur mit le
directeur, M. Baron, au courant, Il me fit appeler
dans son bureau. Je le vois encore avec son regard
énergique et bon. Me tenant le menton entre
deux doigts, il me parla très paternellement
et promit de m'arracher à une maison
où je n'avais que de mauvais exemples sous
les yeux. J'étais tout triste en quittant M.
Baron, qui avait touché mon coeur. Puis
j'aimais l'école, les livres, je
désirais m'instruire... Mais autant en
emporte le vent. À ma nouvelle vie je
trouvai vite un grand attrait. J'étais mon
maître, d'abord, et la liberté a
toujours été pour moi le premier des
biens. Puis j'avais plus d'occasions de boire. Une
première rasade, au petit matin, avec le
père Léon, pour chasser le
brouillard, pour tuer le ver. Et dans le cours de
la journée, avec les ouvriers pour un oui,
pour un non, une tournée. À chaque
fois l'alcool me procurait un indicible
plaisir.
Fluet, je travaillais pourtant avec
courage, l'automne, surtout, quand on fabriquait le
cidre dont je buvais tant - du « gros »
cidre - que je rentrais chez ma mère
nourricière en état de
demi-ébriété. Elle me
regardait tristement.
Je ne grandissais pas. Et mon âme
était aussi chétive que mon corps.
Presque tous ceux que je fréquentais
étaient des alcooliques, des vicieux. Quels
propos ! Ce que j'ai entendu!
Le père Léon m'apprit
à ramasser sur les pavés des rues les
mégots jetés par les passants. je
gardais pour moi une partie de la récolte.
Et dans le grenier, seul, je fumais, je chiquais
ces abominables détritus... Ensuite, il me
fallait boire. La bouteille cachée
derrière une pile de bois ne me suffisait
plus. Quand je revenais du café avec la
bouteille de la maison, j'en buvais une ou deux
gorgées que le jet de la fontaine
remplaçait. Le père Léon se
plaignait souvent que la goutte n'était pas
assez forte, que madame Letrône la baptisait.
Je renchérissais.
- Oh ! cette femme est capable de tout.
Elle ne pense qu'à ses sous.
Bientôt, il me fallut boire la
nuit. Quand tout dormait, je me glissais
près de l'armoire, je montais sur une chaise
placée là en temps voulu,
débouchais doucement la bouteille,
l'inclinais sur une tasse. Quand mon index, tenu au
bord de la tasse, commençait à se
mouiller, je cessais de verser et buvais avec
volupté le liquide adoré.
Après, assommé, je dormais comme une
brute.
Des magistrats, à cette
époque, eurent pitié du père
Léon et lui confièrent des
écritures. Il travaillait, quand il n'avait
pas trop bu, tard dans la nuit, ce qui lui valut
une violente inflammation aux yeux. Le
médecin lui prescrivit des gouttes à
verser dans l'eau bouillie. Je le regardais se
bassiner les paupières. Une
après-midi, seul à la maison, je
voulus faire l'homme. M'étant emparé
de la petite fiole à étiquette rouge,
j'en versai quelques gouttes dans le creux d'une
main que j'appliquai sur mes paupières.
Instantanément, brûlure effroyable. Je
voyais rouge. Un brasier était en moi.
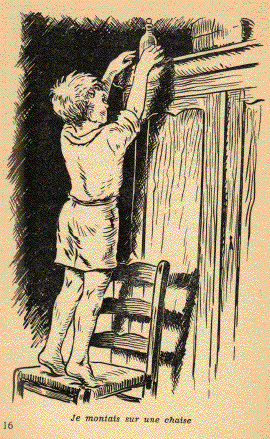
De douleur je criai, je me roulai par terre...
Un passant, attiré par mes hurlements,
accourut. Puis ma mère nourricière.
On me lava à l'eau fraîche. Vainement.
La torture augmentait. On me conduisit chez un
médecin qui m'envoya à
l'hôpital. Une voix apitoyée murmura:
« Les yeux sont perdus. » En effet,
j'étais aveugle!
|