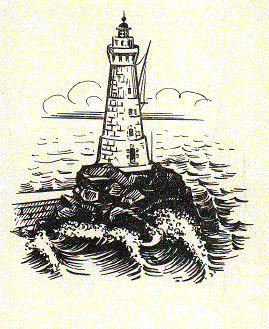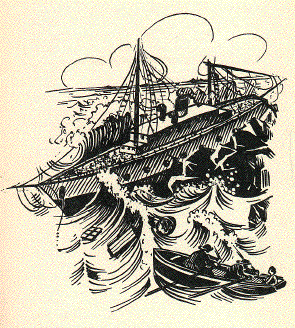LE PHARE SUR LE
ROC
CHAPITRE PREMIER
Mon étrange demeure
C'est dans un phare que je suis né, par
une nuit très orageuse. Les vagues se
jetaient avec fureur contre notre habitation, et le
vent soufflait en tempête. Si le phare
n'avait pas été bâti bien
fermement sur le roc, il aurait certainement
été balayé dans l'océan
avec tout ce qu'il contenait.
Mon grand-père m'a souvent
répété qu'il n'avait jamais vu
jusqu'alors un pareil ouragan, quoiqu'il
vécût sur cette île depuis plus
de quarante ans. Un grand nombre de bateaux furent
perdus corps et biens cette nuit-là. C'est
au moment où le vent était le plus
impétueux, et les vagues si fortes que leur
écume montait plus haut que les
fenêtres, c'est alors que moi, Alain
Fergusson, je vins au monde.
Je naquis dans une étrange
demeure. Le phare était bâti sur une
petite île, à six kilomètres de
la terre ferme. La mer qui nous
entourait de tous côtés était
quelquefois si bleue et si paisible qu'on ne
pouvait rien voir de plus beau, tandis que d'autres
fois elle était noire comme de l'encre et se
jetait en rugissant contre les rochers qui
entouraient notre Île.
On avait construit le phare sur un
immense rocher qui descendait à pic dans
l'océan du côté de la pleine
mer, et, chaque soir, dès qu'il
commençait à faire nuit, on allumait
ses grandes lampes qui jetaient au loin leur
brillante lumière.
Je me souviens combien, dès ma
tendre enfance, ces lampes faisaient mon
admiration. Je ne me lassais jamais de rester
à les regarder tandis qu'elles tournaient en
changeant de couleur. Il y avait d'abord la
lumière blanche, puis la bleue, puis la
rouge, puis la verte, et ensuite revenait la
blanche. Les vaisseaux connaissaient bien notre
phare et, par son moyen, ils pouvaient
éviter les rochers si dangereux de ces
parages.
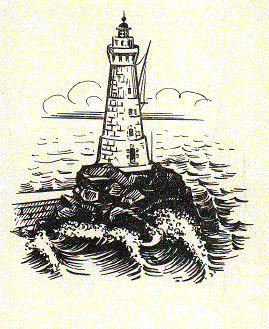
Mon grand-père, Samuel Fergusson,
était le gardien du phare. C'est lui qui
avait la responsabilité de veiller à
ce que les lampes fussent toujours en bon
état et allumées en temps voulu.
C'était un homme actif qui faisait bien son
ouvrage, et sa grande ambition était de
pouvoir rester à son poste
jusqu'au moment où je serais capable de le
remplacer.
À l'époque où
commence mon histoire j'avais douze ans et
j'étais grand et fort pour mon âge.
Mon grand-père était très fier
de moi et disait que je serais bientôt un
homme, et qu'alors il se hâterait de me faire
nommer à sa place. J'aimais
extrêmement mon étrange demeure et
n'aurais voulu l'échanger pour aucune autre.
Des gens qui n'y auraient pas été
habitués auraient sans doute pensé
que c'était un peu triste, car nous ne
voyions personne et ne pouvions nous rendre
à la côte qu'une fois tous les deux
mois ; mais j'étais très heureux
et persuadé qu'il n'y avait aucun lieu au
monde comparable à notre petite
île.
La maison dans laquelle j'habitais avec
mon grand-père attenait à la tour du
phare. Elle était petite, mais très
agréable. Toutes les fenêtres avaient
vue sur la mer, et lorsque nous les ouvrions, nous
recevions en abondance l'air pur et vivifiant du
large. Outre la nôtre, il n'y avait qu'une
seule maison sur l'île, celle de M. Miller,
le second gardien du phare. Elle était
séparée de la nôtre par une
cour que l'on avait entourée de hautes
murailles pour la protéger du vent.
Derrière cette cour se trouvaient deux
petits jardins. Celui des Miller
était abandonné et
rempli de mauvaises herbes, car M. Miller n'aimait
pas jardiner et sa femme avait bien assez à
faire ; ne devait-elle pas s'occuper de ses
six enfants ?
Notre jardin, au contraire, faisait
l'admiration de tous ceux qui visitaient
l'île. Mon grand-père y travaillait
dans tous ses moments de loisir et il m'avait
enseigné de bonne heure à lui aider.
Nous en étions tous deux très fiers
et le tenions toujours en parfait
état ; aussi, quoiqu'il fût si
près de la mer, il produisait les plus beaux
légumes, les fruits les plus savoureux et
toutes les variétés de fleurs assez
robustes pour supporter l'air de mer.
Au centre de l'île
s'étendait une prairie, dans laquelle nous
menions paître la vache et les deux
chèvres qui fournissaient le lait et le
beurre nécessaires à nos deux
familles. De l'autre côté on
retrouvait le rivage rocheux qui entourait
l'île, mais il y avait aussi une petite
jetée qui s'avançait dans la mer.
C'est là que je ne manquais pas de me rendre
tous les lundis matins, pour y attendre le bateau
à vapeur qui venait chaque semaine nous
apporter des provisions et le courrier.
C'était un grand événement
pour nous ; aussi mon grand-père, M. et
Mme Miller et leurs enfants, tous venaient me
rejoindre au moment où le
bateau abordait. Mon grand-père ne recevait
pas souvent des lettres, car il ne connaissait pas
beaucoup de gens. Il avait vécu sur cette
île isolée la plus grande partie de sa
vie, et tous ses parents étaient
morts ; excepté peut-être mon
père, et nous ne savions pas ce qu'il
était devenu. Je ne l'avais jamais connu,
car il était parti quelque temps avant ma
naissance. Mon grand-père me parlait souvent
de lui en me disant que c'était un robuste
et courageux marin. Il lui avait amené ma
mère et l'avait laissée à ses
soins, tandis qu'il allait faire un voyage de long
cours. Il avait ensuite quitté l'île
sur ce même petit bateau à vapeur qui
faisait notre service tous les lundis. Mon
grand-père était resté sur la
jetée aussi longtemps qu'on avait pu le
voir, et ma mère avait agité son
mouchoir dans sa direction tant qu'on avait vu une
fumée à l'horizon. Mon
grand-père m'a souvent raconté
combien elle était jeune et charmante
à la lumière de ce matin
d'été. Mon père avait promis
d'écrire bientôt, mais on ne
reçut jamais de ses nouvelles. Tous les
lundis matins, ma mère était la
première sur la jetée pour attendre
le bateau, et pendant trois ans elle fut chaque
fois désappointée !
Peu à peu son pas devint plus
lent, sa figure plus pâle et maigre, et
à la fin elle n'eut plus la force de se
rendre sur la jetée. Bientôt
après je fus laissé orphelin.
Dès lors, mon cher
grand-père devint père et mère
pour moi. Rien n'était difficile pour lui
quand il s'agissait de mon bien, et où qu'il
allât, quoi qu'il fit, j'étais
toujours à ses côtés.
Ce fut lui qui m'enseigna à lire
et à écrire, car je ne pouvais
naturellement pas aller à l'école. Il
me montra aussi comment il fallait nettoyer les
lampes et me faisait travailler au jardin. Notre
vie s'écoula ainsi d'une manière
très uniforme jusqu'à ce que j'eusse
atteint l'âge de douze ans. Parfois je me
surprenais à désirer qu'il
survînt quelque événement
inattendu, pour rompre la monotonie de notre vie
sur l'île.
Et enfin un changement se
produisit !
.
CHAPITRE Il
La lumière au large
Par une sombre soirée de novembre, nous
prenions tranquillement notre souper, mon
grand-père et moi. Nous avions
bêché le jardin toute la
matinée, mais l'après-midi le temps
était devenu très pluvieux et nous
avions dû rester en chambre.
Nous causions tranquillement, faisant
des plans pour nos occupations du lendemain,
lorsque la porte s'ouvrit brusquement et M. Miller
avança sa tête à
l'intérieur.
- Samuel, vite ! cria-t-il. Venez
voir !
Nous nous élançâmes
vers la porte et regardâmes dans la direction
qu'il indiquait. Là, vers le nord, nous
vîmes une lueur brillante qui éclaira
un moment le ciel orageux, puis s'éteignit
complètement.
- Qu'est-ce,
grand-père ?
Mais il ne me répondit pas.
- Il n'y a pas une minute à
perdre, Jem, dit-il à Miller ; vite, le
canot à l'eau !
- La mer est démontée, dit
celui-ci, en regardant les énormes vagues
qui se brisaient contre les rochers.
- N'importe, Jem. Nous devons faire
notre possible pour les sauver.
Les deux hommes descendirent en
hâte sur le rivage, et je les suivis.
- Qu'est-ce, grand-père ?
répétai-je.
- Un navire en détresse, me
dit-il. On fait toujours ainsi des signaux quand on
est en danger ; c'est pour appeler au
secours.
- Vas-tu y aller,
grand-père ?
- Certainement ! Nous irons, si
nous parvenons à lancer le canot. Es-tu
prêt, Jem ?
- Laisse-moi aller avec vous,
grand-père, suppliai-je ; je pourrai
peut-être vous aider.
- Bien, mon garçon. Nous allons
essayer de lancer le canot.
Il me semble encore voir cette
scène comme si c'était hier. Mon
grand-père et Miller faisant tous leurs
efforts pour ramer contre les vagues, tandis que,
cramponné au siège pour ne pas
être lancé à la mer, je faisais
mon possible pour tenir le gouvernail. Je vois
encore la pauvre Mme Miller nous
surveillant de la jetée, avec deux de ses
fillettes cramponnées à sa jupe. Je
crois entendre le fracas des vagues
s'élevant de plus en plus et menaçant
à chaque instant de nous engloutir. Je vois
surtout l'expression profondément
désappointée de mon grand-père
lorsque, après maints efforts infructueux,
il dut renoncer à son entreprise.
- C'est inutile, Jem, dit-il enfin avec
un soupir de découragement ; nous ne
pouvons, à nous seuls, lutter contre une
pareille mer !
Nous abordâmes donc, non sans
difficulté, et nous restâmes sur la
jetée, regardant constamment du
côté où la lueur nous
était apparue ; mais rien ne vint
percer les profondes
ténèbres.
Les lampes du phare, qui avaient
été allumées deux heures
auparavant, brillaient de tout leur éclat.
C'était au tour de Miller de veiller ;
il monta donc dans la tour, tandis que mon
grand-père et moi restions sur la
jetée.
- Ne pouvons-nous rien faire,
grand-père ? demandai-je.
- Je crains que non, me
répondit-il tristement. Impossible d'avancer
contre une telle mer ! Si elle se calme un
peu, nous essayerons de nouveau.
Mais la mer ne se calmait pas et,
pendant de longues heures, nous continuâmes
à faire les cent pas sur la
jetée.
Tout à coup une fusée,
partant évidemment de l'endroit où
nous avions précédemment vu la lueur,
parut dans les airs.
- Voilà de nouveau un
signal ! dit mon grand-père. Pauvres
gens ! Je me demande combien ils sont.
- Ne pouvons-nous donc rien faire ?
soupirai-je.
- Non, mon garçon. La mer est
trop forte pour nous. Quelle terrible
tempête ! Cela me rappelle le jour de ta
naissance.
Ainsi se passa la nuit. Nous
n'eûmes pas même l'idée d'aller
nous reposer, mais restâmes tout le temps
à nous promener, les yeux fixés sur
l'endroit où la lumière nous
était apparue. De temps en temps une
fusée partait ; puis nous ne
vîmes plus rien.
- Pauvres gens ! Ils ont
épuisé leurs fusées, dit mon
grand-père. Quelle terrible
affaire !
- Que leur est-il arrivé ?
demandai-je. Y a-t-il des rochers de ce
côté ?
-Oui, il y a les écueils
d'Ainslie ; c'est un coin dangereux, où
s'est produit déjà plus d'un
naufrage.
Lorsque le jour commença à
poindre, nos yeux exercés
distinguèrent les mats d'un vaisseau dans le
lointain.
- Le voilà ! dit mon
grand-père. C'est comme je le pensais, il
s'est jeté sur les rochers
d'Ainslie.
- Le vent n'est plus aussi fort,
n'est-ce pas ? demandai-je.
- Tu as raison, et la mer aussi est un
peu moins mauvaise. Appelle vite Jem.
Celui-ci se hâta de venir, portant
dans ses bras de gros rouleaux de cordes.
-C'est bien, Jem, lui dit mon
grand-père. Partons vite, je crois que cette
fois nous pourrons réussir.
Nous sautâmes dans le bateau et
tâchâmes de nous éloigner de la
jetée. Mais quelle lutte nous eûmes
à soutenir contre le vent et les
vagues !
- Courage, Jem ! criait mon
grand-père. Pense à tous ces pauvres
gens là-bas! Essayons encore !
Ils firent donc un nouvel effort et
parvinrent à s'éloigner un peu plus
de la jetée ; petit à petit,
mais très lentement, cette distance
augmenta. Les vagues étaient monstrueuses et
paraissaient à tous moments prêtes
à nous engloutir. Les deux
hommes auraient-ils la force de
lutter assez longtemps pour arriver jusqu'au
bateau ?
- Qu'est-ce que cela ?
m'écriai-je tout à coup, en voyant un
objet noirâtre qui montait et descendait avec
les vagues.
- C'est un bateau, sûrement !
dit mon grand-père. Regarde, Jem !
.
CHAPITRE IIl
Un sauvetage
Oui, c'était bien un bateau que j'avais
aperçu, mais il était sens dessus
dessous. Un moment après il passa si
près de nous que nous aurions presque pu le
toucher.
- Ils ont perdu leur bateau, dit mon
grand-père. Courage, Jem !
- Oh ! grand-père !
criai-je - car le vent était si fort qu'il
fallait crier pour se faire entendre - crois-tu que
ce bateau était plein de
monde ?
- Non, répondit-il, je pense
qu'il a été emporté au moment
où ils ont cherché à le mettre
à flot. Courage, Jem !
Car Miller, qui n'était pas
très fort, semblait
épuisé.
En nous approchant nous vîmes que
le vaisseau était très grand et que
beaucoup de gens allaient et venaient sur le pont,
d'un air agité.
Mon grand-père et Miller
redoublèrent d'efforts et, enfin, nous
arrivâmes tout près
du navire, tellement près que, si le bruit
de la tourmente n'avait pas été si
fort, nous aurions pu parler avec les
naufragés. Nous essayâmes à
plusieurs reprises de nous placer le long du
vaisseau, mais, chaque fois, les vagues nous
emportaient bien loin. Enfin les matelots nous
jetèrent un câble et, après
plusieurs essais infructueux, je réussis
à le saisir et à le passer à
mon grand-père qui l'attacha solidement
à notre bateau.
- Courage ! cria-t-il, courage,
Jem ! Nous pourrons maintenant en sauver
quelques-uns !
Oh ! comme mon coeur battait, en
voyant cette foule d'hommes et de femmes qui se
pressaient avec anxiété à
l'endroit où la corde était
fixée !
- Nous ne pouvons malheureusement pas
les prendre tous, dit mon grand-père en
soupirant ; il nous faudra. couper la corde,
dès que nous en aurons autant que le bateau
peut en porter.
Je frissonnai en pensant à ceux
que nous devrions laisser en
arrière.
Nous nous étions mis aussi
près que possible du navire, afin que les
naufragés pussent saisir un instant
d'accalmie, entre deux grosses vagues, pour sauter
dans notre bateau.
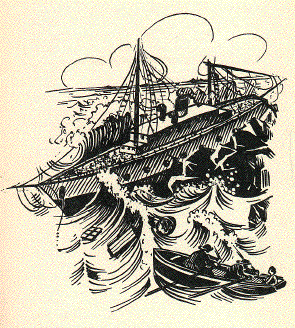
- Attention, Jem ! cria mon
grand-père, voici le premier !
Un homme se tenait près de la
corde, tenant dans les bras ce qui semblait
être un gros paquet. Il saisit un bon moment
pour le jeter. Mon grand-père le
reçut :
- C'est un enfant, Alain, me dit-il.
Mets-le près de toi et prends-en
soin.
Je le plaçai à mes pieds,
et mon grand-père cria :
- Maintenant ; à un
autre !
Dépêchez-vous !
Mais à ce moment Miller saisit
mon grand-père par le bras en criant
:
- Attention !
Une formidable vague, plus haute que
toutes celles que j'avais vues jusqu'alors,
s'avançait vers nous. Un instant de plus, et
elle nous aurait jetés avec violence contre
le navire et aurait brisé notre bateau. Sans
perdre une seconde, mon grand-père coupa le
câble d'un coup de hache, et nous
n'eûmes que le temps de nous laisser aller au
courant avant que la vague fondît sur
nous.
Nous entendîmes un fracas
épouvantable, comme un coup de tonnerre,
lorsque l'énorme vague se jeta contre le
rocher d'Ainslie. Je pouvais à peine
respirer, tant mon effroi était grand.
- Retournons vite en chercher
d'autres ! cria mon grand-père quand le
danger fut passé.
Nous regardâmes autour de nous,
mais le vaisseau n'était plus
là ! Il avait disparu, comme un
rêve quand on s'éveille. Cette
énorme vague avait achevé de le
briser et l'avait éparpillé en
milliers de fragments. On n'apercevait aucun
être vivant, mais l'océan était
couvert d'épaves.
Nous avions été
entraînés à plus d'un
kilomètre de distance, de sorte qu'il nous
fallut un bon moment, en ramant contre le vent et
les vagues, pour revenir sur le lieu du sinistre.
Quand, enfin, nous y arrivâmes, nous
étions trop tard pour sauver personne. Sans
doute la plupart avaient été
entraînés dans le tourbillon que le
navire avait fait en sombrant, et ceux qui
étaient montés à la surface
avaient disparu de nouveau avant que nous ayons pu
arriver.
Longtemps nous luttâmes contre les
vagues dans l'espoir de sauver encore quelqu'un,
mais trouvant enfin que c'était en pure
perte, nous fûmes obligés de retourner
vers notre île.
Tous avaient péri, excepté
l'enfant couché à mes pieds. Je
l'entendais pleurer, mais il était
attaché si fermement dans
une couverture que je ne pouvais
ni le voir ni le consoler.
Il fallut encore beaucoup de peine et de
courage pour retourner chez nous. C'était
moins dur que pour aller, car le vent était
pour nous, mais le danger était encore bien
grand. Je tenais les yeux fixés sur le
phare, dirigeant le bateau autant que possible en
droite ligne, et quel bonheur de voir la distance
diminuer ! Enfin j'aperçus la
jetée et Mme Miller qui nous
guettait.
- N'avez-vous sauvé
personne ? demanda-t-elle pendant que nous
sortions du bateau.
- Rien qu'un enfant, répondit
tristement mon grand-père. Rien qu'un petit
enfant ! Mais, enfin, nous avons fait tout ce
que nous avons pu...
Jem suivait mon grand-père, en
portant les rames sur son épaule. Je venais
le dernier, avec mon précieux fardeau dans
les bras. L'enfant ne pleurait plus, il
s'était sans doute endormi. Mme Miller
voulut me le prendre et défaire la
couverture, mais mon grand-père
dit :
- Pas encore, Marie, il faut d'abord
entrer ; il fait trop froid ici.
Nous traversâmes donc le champ, le
jardin et la cour. La couverture était
solidement attachée autour de l'enfant,
excepté dans le haut
où l'on avait laissé une ouverture
pour lui permettre de respirer, et je pouvais tout
juste apercevoir un petit nez et deux yeux
fermés. Une fois entrés dans notre
cuisine, Mme Miller, s'asseyant, prit l'enfant sur
ses genoux et enleva la couverture.
- Que Dieu la bénisse !
dit-elle d'une voix émue, c'est une petite
fille !
- Eh oui ! dit mon
grand-père ; et c'est une charmante
petite fille !
.
CHAPITRE IV
La petite Lily
Je n'ai jamais vu, j'en suis sûr, une plus
jolie petite fille. Ses cheveux étaient d'un
brun clair, ses joues roses et potelées, et
ses yeux du plus beau bleu.
Elle se réveilla, tandis que nous
étions tous à la regarder, et, ne
voyant autour d'elle que des figures
étrangères, elle se mit à
pleurer en appelant :
- Maman ! Maman !
- Pauvre chérie ! dit Mme
Miller, elle voudrait sa mère.
Et la brave femme se mit à
pleurer autant que l'enfant.
Mon grand-père lui prit alors
l'enfant et la posa sur mes genoux ; puis il
dit :
- Écoutez, Marie, ayez la
bonté de nous préparer à tous
quelque chose de chaud ; nous en avons bien
besoin ! La petite est glacée et
affamée, et nous ne sommes pas beaucoup
mieux !
Mme Miller s'essuya les yeux et eut
bientôt allumé un feu brillant. Puis
elle courut dans la maison voisine voir si ses
enfants étaient bien, et nous rapporta de la
viande froide.
Je m'assis devant le feu, avec la
fillette sur mes genoux. C'était une saine
et robuste enfant qui paraissait avoir de deux
à trois ans. Elle avait cessé de
pleurer et me regardait sans la moindre frayeur,
mais dès que quelqu'un d'autre approchait,
elle cachait sa figure contre mon
épaule.
Mme Miller apporta une tasse de lait et
du pain et me laissa la nourrir
moi-même.
La fillette avait l'air très
fatiguée et pouvait à peine tenir ses
yeux ouverts.
- Pauvre chérie ! dit mon
grand-père, je pense qu'on l'a
réveillée pour la porter sur le pont.
Voulez-vous la coucher, Marie ?
-Oui, je vais la mettre dans le lit de
notre Jenny ; elle y dormira très
bien.
Mais l'enfant se cramponna à moi
et cria si fort quand Mme Miller voulut l'emporter,
que mon grand-père dit :
- Non, laissez-la, puisqu'elle aime
mieux rester avec Alain.
Nous lui fîmes donc un petit lit
sur le canapé, et Mme Miller l'y coucha
après lui avoir fait sa toilette.
L'enfant paraissait avoir une
préférence pour moi ;
lorsqu'elle fut couchée elle me tendit sa
petite main en disant :
- Tenir la main de Lily.
Peu après elle s'endormit
paisiblement. Je restai encore longtemps assis
auprès d'elle en lui tenant la main, car je
craignais de la réveiller en faisant un
mouvement.
- Je me demande qui elle est, chuchota
Mme Miller en pliant les petits vêtements. Ce
sont de beaux habits ! C'est une enfant qui a
été bien soignée, cela se
voit. Tiens 1 voilà quelque chose
écrit à l'intérieur de son
petit manteau. Regarde si tu peux lire,
Alain.
Je déposai avec précaution
la petite main sur la couverture et, prenant le
vêtement, je m'approchai de la fenêtre
pour mieux voir.
- Oui, dis-je, c'est probablement son
nom. Il y a Villiers.
- Pauvre petite ! dit Mme Miller.
Penser que son père et sa mère sont
au fond de la mer ! Si c'était notre
Jenny !
Et elle se remit à pleurer, si
bien que, pour ne pas risquer de réveiller
l'enfant, elle prit le parti de retourner chez elle
et de se consoler en serrant sa petite Jenny dans
ses bras.
Mon grand-père, brisé de
fatigue par les efforts qu'il avait fournis, monta
s'étendre sur son lit ; mais moi je
restai auprès de la fillette, sentant que je
n'aurais pas le courage de la laisser seule un
instant.
« Comme elle dort
paisiblement ! » me disais-je,
« pauvre petite ! Elle ne se doute
pas du malheur qui est
arrivé ! »
J'étais à bout de forces,
n'ayant pas fermé l'oeil la nuit
précédente ; aussi quelques
minutes s'étaient à peine
écoulées que j'appuyais ma tête
contre le canapé et m'endormais
profondément.
Je fus réveillé quelques
heures plus tard parce qu'on tirait mes cheveux
tandis qu'une petite voix me criait dans les
oreilles :
- Lever Lily ! lever !
J'ouvris les yeux et vis la plus
charmante figure du monde qui me regardait en
souriant. Je courus chercher Mme Miller qui vint
habiller la petite fille.
C'était une belle
après-midi ; la tempête
s'était apaisée pendant notre sommeil
et le soleil brillait dans tout son éclat.
Je me hâtai de préparer le
dîner, tandis que Lily me regardait, courant
autour de moi, et ayant l'air tout à fait
heureuse et contente.
Mon grand-père dormait encore et
je ne voulus pas le réveiller. Mme Miller
apporta une bonne soupe qu'elle
avait faite pour la petite, et nous prîmes
notre repas ensemble. Je voulais la faire manger,
comme je l'avais fait le matin, mais elle
dit :
- Lily toute seule !
Et, s'emparant de la cuiller, elle
mangea si proprement que je ne pouvais me lasser de
la regarder, en oubliant presque mon propre
repas.
- Que Dieu la bénisse ! dit
Mme Miller.
- Dieu te bénisse, dit
l'enfant.
- Elle a certainement entendu sa
mère dire ces paroles, dit Mme
Miller.
Quand elle eut fini son dîner, la
fillette se laissa glisser en bas de sa chaise,
alla prendre son manteau qui était
resté sur le canapé, et se dirigea
vers la porte en disant :
- Promener, Lily veut promener.
- Conduis-la un peu dehors, Alain, me
dit Mme Miller.
Alors, au grand bonheur de la petite,
nous lui mîmes son manteau et son capuchon,
et je sortis avec elle.
Oh ! comme elle sauta et s'amusa
dans le jardin ! Je n'avais jamais vu une
enfant si gaie.
|