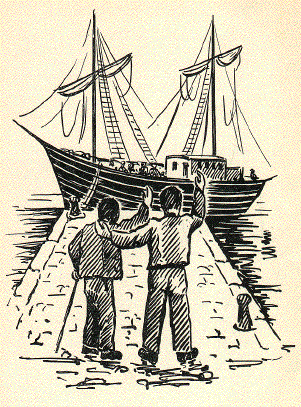LE PHARE SUR LE
ROC
CHAPITRE IX
Un changement au phare
Le temps nous parut long jusqu'à ce que
mon grand-père revînt ; alors il
dit simplement d'une voix basse :
- Vous pouvez l'apporter maintenant elle
sait tout.
Et la triste procession se mit en route,
pour se rendre chez les Miller. Mon
grand-père et moi nous suivions.
Je n'oublierai jamais cette
scène, ni mes impressions de ce
moment-là.
Mme Miller était
réellement malade ; le coup avait
été trop fort pour elle, et de plus
elle avait pris froid. Les hommes repartirent avec
le bateau chercher un médecin, et celui-ci
à son tour les renvoya encore une fois
chercher une infirmière.
Mon grand-père et moi
restâmes toute la nuit dans la maison des
Miller, car la garde-malade n'arriva qu'à
l'aube. Les six enfants dormaient paisiblement dans
leurs petits lits. J'allai une fois les regarder et
m'assurer que ma petite Lily
était bien couchée. On l'avait mise
dans le lit de Jenny, et les deux fillettes se
tenaient la main en dormant. Les larmes me vinrent
aux yeux en pensant que toutes deux étaient
orphelines et que ni l'une ni l'autre ne pouvait le
comprendre.
Quand la garde-malade arriva, mon
grand-père et moi retournâmes chez
nous Mais nous n'aurions pu dormir ; nous
allumâmes notre feu et nous assîmes
devant en silence.
Mon grand-père me dit
enfin :
- Alain, mon garçon, cela m'a
donné un coup ! Je crois que je n'ai
jamais été aussi bouleversé.
Cela aurait pu être moi, Alain, cela aurait
tout aussi bien pu être moi !
Je pris sa main et la serrai fortement,
sans rien dire.
-Oui, répéta-t-il, cela
aurait pu être moi ; et alors, où
serais-je maintenant ?
J'étais trop ému pour
parler, et il continua :
- Je me demande où est ce pauvre
Jem à présent ? J'y ai
pensé toute la nuit.
Alors je lui racontai ce que Miller
m'avait dit au moment de son départ.
- Sur le Roc ! A-t-il dit qu'il
était sur le Roc ? Je voudrais bien
pouvoir en dire autant, Alain.
- Ne pouvons-nous pas, aussi bien que
lui, être sur ce Roc,
grand-papa ?
- Je le voudrais bien, mon enfant. Je
commence à comprendre ce que cela signifie.
Le vieux monsieur m'a dit : « Vous
bâtissez sur le sable, et votre construction
ne résistera pas à
l'orage ». Ces paroles ont
résonné constamment à mes
oreilles pendant que nous étions assis cette
nuit chez Mme Miller. Mais... je ne sais pas, non,
je ne sais pas comment me mettre sur le
Roc...
Toute la semaine suivante la pauvre Mme
Miller fut entre la vie et la mort. Elle avait une
congestion pulmonaire et, au début, le
docteur laissait peu d'espoir ; mais enfin le
mieux prit le dessus, et il parla d'une
manière plus encourageante. Je passai tout
mon temps avec les pauvres enfants, faisant tout ce
que je pouvais pour les occuper paisiblement, afin
qu'ils ne fissent point de bruit qui pût
déranger leur mère.
Un seul jour nous fûmes absents,
mon grand-père et moi, pendant plusieurs
heures, car nous nous rendîmes à terre
pour accompagner à sa dernière
demeure le corps de notre ancien et cher compagnon.
Sa femme était encore trop mal ce
jour-là pour se rendre compte de ce qui se
passait.
Quand, au bout de plusieurs semaines, la
fièvre la quitta, elle était
très faible, et il devait se passer
longtemps encore avant qu'elle pût reprendre
ses occupations.
Cependant nous apprîmes qu'on
avait nommé un autre homme pour occuper le
poste de Jem Miller, et il fallut bientôt que
la pauvre famille se préparât à
partir.
Quel triste jour pour nous que celui de
leur départ ! Nous les
accompagnâmes jusqu'à la jetée
et les vîmes s'embarquer. Ils se rendaient
chez les parents de Mme Miller qui, heureusement,
pouvaient facilement les recevoir. Bien des larmes
coulèrent de part et d'autre au moment de la
séparation, car nous partagions depuis si
longtemps la même vie que nous étions
très attachés les uns aux
autres.
Après leur départ,
l'île nous parut très solitaire et
désolée. Si nous n'avions pas eu
notre petit Rayon de soleil, comme mon
grand-père l'appelait, je ne sais ce que
nous serions devenus. Chaque jour nous l'aimions
davantage et notre grande crainte était de
recevoir un lundi une lettre nous annonçant
qu'elle devait nous quitter.
- Ah ! mon garçon, me disait
souvent mon grand-père, combien peu nous
nous doutions le fameux jour de la tempête,
quel trésor renfermait
l'étrange petit paquet que nous rapportions
avec nous !
L'enfant grandissait ; l'air de mer
lui faisait beaucoup de bien et de jour en jour
elle devenait plus jolie et plus
intelligente.
Nous étions très curieux
de savoir qui avait été nommé
à la place de Jem Miller ; mais nous ne
parvînmes même pas à savoir son
nom. Le capitaine Sayers nous dit qu'il ne savait
rien de cette affaire ; et les messieurs qui
vinrent une ou deux fois afin de faire
réparer la maison pour le nouvel arrivant
furent très réservés à
son sujet, et paraissaient nous trouver trop
curieux lorsque nous leur posions des questions.
Pourtant notre bien-être dépendait
beaucoup de notre voisin, car mon grand-père
et lui étaient constamment ensemble, et nous
n'avions personne d'autre sur l'île à
qui parler.
Mon grand-père désirait
accueillir amicalement le successeur de Miller et
lui rendre agréable son séjour sur
l'île. Nous nous mîmes donc à
l'oeuvre dès le départ de Mme Miller,
pour bêcher le jardin inculte qui appartenait
à la maison voisine, et pour lui donner un
aspect aussi plaisant que possible.
- Je voudrais bien savoir de qui se
compose la famille, dis-je pendant que nous
travaillions dans le jardin.
- Peut-être l'homme sera-t-il
seul, dit mon grand-père. Lorsque je suis
arrivé ici moi-même, j'étais
jeune et pas encore marié. Mais nous saurons
bientôt tout ce qui le concerne, puisqu'il
doit arriver lundi prochain.
- C'est étonnant qu'il ne soit
pas venu une fois d'avance pour voir l'île et
sa maison. Je me demande ce qu'il en
pensera.
- Il se sentira sans doute un peu
étranger tout d'abord, dit mon
grand-père, mais nous l'accueillerons de
notre mieux. Tu lui prépareras un bon
déjeuner, Alain - et il faudra qu'il y ait
suffisamment à manger pour sa femme et ses
enfants, s'il en a - du café chaud, du pain,
du beurre, des saucisses grillées, et tout
ce que tu voudras. Ils seront heureux de se
réconforter après leur
traversée.
Nous fîmes donc tous nos
préparatifs, et attendîmes avec une
certaine anxiété l'arrivée de
notre nouveau compagnon.
.
CHAPITRE X
Notre nouveau voisin
Le lundi matin, nous allâmes, comme
à l'ordinaire, de bonne heure sur la
jetée, pour attendre le bateau à
vapeur.
Il nous tardait beaucoup de savoir ce
que seraient nos voisins. Nous avions
préparé chez nous le plus joli
déjeuner possible, pour quatre ou cinq
personnes, et j'avais cueilli dans notre jardin un
beau bouquet de dahlias pour égayer la
table.
Enfin le bateau apparut et nous
distinguâmes sur le pont un homme qui parlait
avec le capitaine ; nous pensâmes
aussitôt que c'était notre futur
compagnon.
- Je ne vois pas de femme, dit mon
grand-père.
- Ni d'enfant, ajoutai-je, en soulevant
Lily dans mes bras pour qu'elle pût voir le
bateau.
- Pouf, pouf ! pouf !
disait-elle en le voyant approcher ; puis elle
partait d'un joyeux éclat de rire.
Quand le bateau eut abordé, nous
nous approchâmes du capitaine et de
l'étranger.
- Voici votre nouveau compagnon, M.
Fergusson, dit le capitaine. Voulez-vous lui
montrer le chemin de sa maison, pendant que je fais
débarquer vos provisions ?
- Je vous souhaite la bienvenue sur
notre île ! dit mon grand-père en
serrant la main du nouveau venu.
C'était un homme grand, bien
bâti, au teint fortement
hâlé.
- Merci, dit l'homme tout en me
regardant avec persistance. Cela fait du bien
d'être ainsi reçu.
- Voici mon petit-fils Alain, dit mon
grand-père en posant sa main sur mon
épaule.
- Votre petit-fils, répéta
l'homme en continuant à me regarder d'une
manière étrange, votre petit-fils -
Vraiment !
- Venez maintenant, dit mon
grand-père, vous devez avoir besoin de vous
restaurer. Le café est tout prêt
à la maison, et vous serez le bienvenu, je
vous assure.
Nous avancions vers le phare, mais
l'homme ne paraissait pas très
disposé à parler. Il me sembla une
fois voir une larme dans ses yeux ; mais je
pensai que je me trompais, car qu'est-ce qui aurait
pu le faire pleurer ? Je me
doutais peu de tout ce qui remplissait son
coeur.
- À propos, dit mon
grand-père en se tournant tout à coup
vers lui, comment vous appelez-vous ? On ne
nous l'a pas dit.
L'homme ne répondit pas, et mon
grand-père, le regardant avec
étonnement, lui dit :
- N'avez-vous pas de nom ? ou
avez-vous quelque objection à ce qu'on le
sache ?
- Père ! dit l'homme en
saisissant la main de mon grand-père, ne
reconnais-tu pas ton propre fils ?
- David ! C'est mon David !
Alain ! regarde, Alain, c'est ton
père !
Brisé par l'émotion, mon
grand-père se mit à sangloter comme
un enfant, tandis que mon père le soutenait
fermement d'un bras et posait l'autre main sur mon
épaule.
- Je n'ai pas voulu qu'on vous le dise,
expliqua-t-il ; je leur ai fait promettre de
me laisser le faire moi-même. À mon
arrivée dans le pays j'ai appris que la
place était vacante et je l'ai
demandée aussitôt. Quand j'ai dit que
j'étais ton fils, père, on me l'a
accordée tout de suite.
- Mais où donc as-tu
été tout ce temps, David, et pourquoi
ne nous as-tu jamais écrit ?
- Oh, c'est une longue histoire, dit mon
père ; entrons d'abord, et je vous
raconterai tout.
Je commençai à servir le
déjeuner, tandis que mon père tenait
constamment les yeux sur moi.
- Comme il lui ressemble ! dit-il
d'une voix étouffée.
Je compris qu'il parlait de ma
mère.
- Alors tu as appris la mort de notre
chère Alice ? dit mon
grand-père.
- Oui. Par une étrange
coïncidence, sur le bateau qui me ramenait en
Europe il y avait un homme de par ici, qui m'a tout
raconté. Mon coeur s'est brisé quand
j'ai appris qu'elle était morte... Je
m'étais tant réjoui de la
retrouver !
Mon grand-père lui raconta alors
longuement tout ce qui concernait ma mère.
Combien elle l'avait attendu, et comment, lorsque
mois après mois s'étaient
écoulés sans qu'elle reçut des
nouvelles de lui, elle avait langui, était
devenue de plus en plus faible, et enfin
était morte de douleur...
Chaque fois qu'il s'arrêtait, mon
père lui demandait de continuer, de sorte
que ce ne fut que le soir, tandis que nous
veillions dans notre observatoire, que mon
père commença enfin à raconter
sa propre histoire.
Il avait fait naufrage sur les
côtes de la Chine. Le vaisseau sur lequel il
était avait été mis en
pièces, non loin du rivage qu'il n'avait pu
atteindre qu'avec trois de ses compagnons
seulement. Aussitôt qu'ils avaient pris pied
sur la rive, des Chinois les avaient
entourés avec des gestes menaçants,
les avaient fait prisonniers, et, pendant plusieurs
jours, les pauvres naufragés avaient pu
craindre d'être mis à mort, car, dans
ce temps-là, les Chinois ne pouvaient pas
souffrir que des étrangers abordent dans
leur pays. Enfin on les conduisit à une
grande distance à l'intérieur du
pays. C'est là que mon pauvre père
avait passé toutes ces années pendant
lesquelles nous le pensions mort ! Il ne fut
pourtant pas maltraité, et il enseigna
beaucoup de choses aux gens qui l'entouraient. Mais
il était surveillé si constamment, de
jour et de nuit, qu'il ne put jamais trouver la
moindre occasion de s'échapper.
Naturellement il n'y avait ni poste, ni chemin de
fer dans cet endroit éloigné, et il
était privé de tout rapport avec le
monde civilisé.
Ainsi se passèrent tristement
onze longues années. Tout à coup, un
jour, on dit aux prisonniers qu'ils allaient
être renvoyés à la côte
et embarqués sur un vaisseau en partance
pour l'Angleterre. On leur
expliqua qu'il y avait eu une
guerre et qu'une des conditions du traité de
paix avait été que les Chinois
devaient rendre tous les étrangers retenus
comme prisonniers.
- David, mon fils, dit mon
grand-père avant de se retirer pour la nuit,
c'est une vraie résurrection de te voir de
nouveau au milieu de nous !
.
CHAPITRE XI
Sur le Roc
Environ quinze jours après
l'arrivée de mon père, nous
eûmes la surprise d'avoir une nouvelle visite
du vieux M. Benson. Il venait nous dire que son
gendre avait reçu une lettre concernant la
petite fille qui avait été
sauvée lors du naufrage de la
Victoire.
Voilà ce qu'il me dit en me
trouvant sur la jetée, et, tout le long du
chemin, en revenant à la maison, je
brûlais de savoir ce que contenait la
lettre.
Lily courait à mon
côté, sa petite main dans la mienne,
et je ne pouvais supporter la pensée qu'elle
nous serait probablement bientôt
enlevée.
- Quoi ! c'est M. Benson ! dit
mon grand-père en se levant pour le
saluer.
- En personne, répondit-il ;
et vous devinez, sans doute, pourquoi je
viens.
- Pas pour prendre notre petit Rayon de
soleil, j'espère, dit mon grand-père
en prenant Lily dans ses bras.
Vous n'allez pas l'emmener ?
- Attendez un peu, dit le vieillard en
s'asseyant et en tirant une lettre de sa
poche ; attendez de voir ce qui est
écrit là, et vous me direz ensuite ce
que vous en pensez.
Et il se mit à lire ce qui
suit :
« Cher Monsieur,
Nous ne pouvons exprimer la joie que
nous a causé la nouvelle reçue il y a
une heure à peine. Nous avions appris la
perte de la Victoire, et nous pleurions notre
enfant chérie. Sa mère a
été brisée par la douleur, et
elle est tombée dangereusement malade quand
elle a appris ces tristes nouvelles.
Ai-je besoin de vous dire quels ont
été nos sentiments en apprenant tout
à coup que notre enfant était
vivante !
Nous prendrons le prochain vaisseau
partant pour l'Angleterre, afin de venir chercher
notre petite chérie. Nous serions partis au
lieu de cette lettre, si ma femme avait
été assez forte pour supporter la
traversée. Mille et mille remerciements aux
braves hommes qui ont sauvé notre
enfant ! J'espère pouvoir bientôt
les remercier moi-même. Mon
coeur est trop plein pour exprimer tout ce qu'il
sent !
Notre petite fille avait
été confiée à des amis
pour la traversée, car nous désirions
qu'elle pût quitter les Indes avant la saison
chaude, et je ne pouvais m'en aller que deux mois
plus tard. Voilà pourquoi le nom de Villiers
ne se trouvait pas sur la liste des
passagers.
En vous remerciant de tout coeur pour la
peine que vous avez prise pour nous faire savoir
que notre enfant était sauvée, je
vous envoie mes meilleures salutations.
- Edouard Villiers. »
- Eh bien, dit le vieillard en souriant,
quoiqu'une larme brillât dans ses yeux,
refuserez-vous de la rendre à ses
parents ?
- Que peut-on dire après
cela ? soupira mon grand-père. Pauvres
gens ! Comme ils paraissent
heureux !
- Lily, dis-je en prenant la petite
fille sur mes genoux, sais-tu qui va bientôt
venir te voir ? Ta maman va venir, elle va
venir voir sa petite Lily !
L'enfant me regarda avec
sérieux ; le nom de maman lui rappelait
d'anciens souvenirs. Elle resta un instant pensive,
puis répéta doucement :
- Maman vient voir sa petite Lily.
- Chère petite ! dit le
vieillard en caressant la tête
bouclée ; on dirait qu'elle comprend de
quoi il s'agit.
Alors je préparai du café
et, tandis que M. Benson en prenait une tasse, il
me demanda si j'avais lu le papier qu'il m'avait
fait passer par un matelot.
- Oui, répondit mon
grand-père, oui, nous l'avons lu.
Et il se mit à raconter la
conversation que nous avions eue à ce sujet
avec Jem Miller, et ce que celui-ci m'avait encore
dit le matin de sa mort.
- Maintenant, continua-t-il, je voudrais
que vous me disiez comment on peut être sur
le Roc, car je suis encore sur le sable, il n'y a
pas de doute ; et cela m'effraye, puisque vous
m'avez dit, la dernière fois que vous
êtes venu, que je ne résisterais pas
à l'orage.
- Ce serait, en effet, un grand malheur
d'être sur le sable quand arrivera le grand
ouragan.
- Oui, monsieur, je le sens. Souvent, la
nuit, je reste éveillé et j'y pense
quand j'entends au dehors le vent mugir et les
vagues se briser contre les rochers. Je pense alors
à ce Psaume que j'ai entendu lire dans ma
jeunesse où il est parlé de ceux qui
sont sur mer par la tempête, et dont
l'âme se fond de
détresse. Ah ! j'aurais terriblement
peur si le jour du jugement arrivait !
- Vous n'aurez aucune raison d'avoir
peur si vous êtes sur le Roc, dit notre vieil
ami. Tous ceux qui sont venus à Christ et
qui se reposent sur Lui, sont aussi parfaitement
à l'abri du jugement que vous-même
vous êtes en sûreté dans cette
maison lorsque la tempête fait rage au
dehors.
- Oui, je le comprends maintenant mais
je ne vois pas bien ce que vous entendez par
« être sur le
Roc ».
- Que feriez-vous, mon ami, si votre
demeure ici était construite sur le sable,
près du rivage, et si vous saviez que la
première tempête l'emporterait
inévitablement ?
- Ce que je ferais, monsieur ? Je
la démolirais entièrement et la
rebâtirais sur le rocher.
- C'est exactement cela ! dit M.
Benson. Eh bien, jusqu'à présent vous
avez fait reposer votre espérance de salut
sur vos bonnes oeuvres, vos bonnes intentions, sur
le sable enfin, n'est-ce pas ?
- Oui, c'est vrai.
- Maintenant il faut démolir tout
cela Dites-vous : « Je suis un homme
perdu si je reste comme je suis ; mon
espérance repose entièrement sur le
sable ». Et alors,
fondez votre espérance sur
quelque chose de meilleur, sur quelque chose qui
résistera à l'orage ; fondez-la
sur Christ. Il est le seul chemin pour aller au
ciel. Il est mort pour que vous, pauvre
pécheur, puissiez être sauvé.
Croyez que ce qu'Il a fait pour vous est votre seul
espoir de salut. Voilà ce que signifie
bâtir sur le roc.
- Oui, monsieur, je comprends
maintenant.
- Faites cela, cher ami, confiez-vous en
Jésus, et votre espérance sera
sûre et ferme. Alors, quand le dernier grand
ouragan viendra, il ne vous atteindra pas ;
vous serez dans une sécurité absolue,
comme vous êtes à l'abri dans ce phare
pendant que la tempête fait rage au
dehors ; vous n'aurez rien à craindre,
parce que vous serez sur le Roc immuable.
Je ne saurais répéter tout
ce qui fut dit encore ce matin-là, mais je
me souviens qu'avant de s'en aller, M. Benson
s'agenouilla avec nous et pria ardemment que chacun
de nous acceptât Christ comme son Sauveur et
fût ainsi en sûreté sur le
Roc.
Le même soir, lorsque mon
grand-père me donna son dernier baiser, il
me dit :
- Alain, mon garçon, je n'irai
pas me reposer ce soir avant de pouvoir dire, comme
notre brave Jem :
- Sur Christ, mon rocher, se fonde
- Mon espérance et ma foi.
Et je sais que mon grand-père tint sa
parole.
.
CHAPITRE XII
Le petit Rayon de soleil doit partir
Un lundi matin, le temps était si froid
et si pluvieux, que nous n'aurions pas voulu
laisser sortir notre petite Lily. Je restai donc
pour jouer à la balle avec elle, tandis que
mon père et mon grand-père allaient
attendre le bateau à vapeur.
Elle était si mignonne ce
matin-là ! Elle portait une robe bleue que
Mme Miller lui avait faite avant son départ
et un tablier blanc bien propre qui lui allait
à ravir.
Elle criait de joie en courant
après la balle, lorsque la porte s'ouvrit et
mon père entra
précipitamment.
- Alain ! me dit-il, ils sont
venus !
- Qui ?
- Les parents de Lily ! Ils
arrivent avec ton grand-père.
Il avait à peine fini de parler
qu'en effet ils entrèrent tous les trois. La
dame courut vers la petite fille, la saisit dans
ses bras et la tint serrée contre son coeur.
Puis elle s'assit, la tenant sur
ses genoux, la caressant, lui parlant tendrement,
et cherchant anxieusement à se rendre compte
si l'enfant se souvenait d'elle.
Au premier moment, Lily, fort
intimidée, baissait la tête et ne
voulait pas regarder sa mère. Mais ce ne fut
qu'un instant. Dès que sa maman lui parla,
elle reconnut évidemment sa voix, et, quand
Mme Villiers lui demanda, les larmes aux
yeux :
- Me reconnais-tu, Lily ? Sais-tu
qui je suis, ma chérie ?
L'enfant leva les yeux, sourit et
dit :
- Maman ! La maman de
Lily !
Et elle se mit à caresser
doucement, de sa petite main potelée, la
figure de sa mère. En voyant cela, je
n'osais plus regretter que la petite dût nous
quitter.
Nous passâmes une heureuse
journée. M. et Mme Villiers furent
très aimables avec nous et se
montrèrent extrêmement reconnaissants
de ce que nous avions fait pour leur petite fille.
Ils disaient qu'elle paraissait en bien meilleure
santé que lorsqu'elle avait quitté
les Indes. Mme Villiers ne pouvait quitter son
enfant des yeux ; elle la suivait partout, et
je n'oublierai jamais combien ses parents
paraissaient heureux.
Mais le jour le plus agréable
prend fin comme un autre, et, vers le soir, un
bateau arriva pour chercher les parents et leur
enfant.
- Ma chérie ! dit mon
grand-père en prenant la petite sur ses
genoux ; je n'ai jamais eu autant de peine
à me séparer de quelqu'un, non
jamais ! Je l'appelais mon petit
« Rayon de soleil »,
monsieur ! Vous me pardonnerez de vous dire
que je ne puis éprouver de sentiments
très amicaux pour vous, au moment où
vous me l'enlevez !
- Alors, que direz-vous, lorsque vous
saurez que j'ai grande envie de vous voler encore
davantage ? dit M. Villiers en
souriant.
- Me voler encore davantage ?
répéta mon grand-père.
- Oui, dit M. Villiers en posant la main
sur mon épaule. Je voudrais vous prendre
aussi votre petit-fils. Écoutez-moi.
N'est-ce pas bien dommage que ce garçon
perde son temps dans cette petite île, sans
acquérir aucune instruction ?
Laissez-le venir avec nous ; je le placerai
dans une bonne pension pendant trois ou quatre ans,
et ensuite il pourra choisir lui-même la
vocation qu'il préfère. Je sais que
c'est un grand sacrifice que je vous demande ;
mais, pour le bien de votre
enfant, ne voulez-vous pas y
consentir ?
- Vous êtes bien bon, monsieur,
répondit mon grand-père, mais... je
ne sais que vous dire. Ce serait sans doute une
bonne chose pour Alain ; mais il ne m'a jamais
quitté, et je pensais toujours qu'il
prendrait ma place ici quand je serai trop vieux
pour faire le travail.
- Oui, dit mon père ; mais,
à présent que je suis de retour,
c'est moi qui te remplacerai, père ;
et, si M. Villiers est assez bon pour se charger de
faire instruire Alain, nous devons être bien
reconnaissants qu'il ait trouvé un tel
ami.
- Tu as raison, David, mon
garçon, tu as raison. Nous ne devons pas
être égoïstes. Vous le laisserez
revenir quelquefois, n'est-ce pas,
monsieur ?
- Sans doute ! Il passera toutes
ses vacances ici, et vous fera le récit de
sa vie d'écolier. Et toi, Alain, qu'en
dis-tu ? Il y a une très bonne pension
dans la ville où nous allons habiter, de
sorte que tu serais près de nous, et tu
pourrais venir passer avec nous les
après-midi de congé, pour t'assurer
que cette petite fille n'oublie pas ce que tu lui
as enseigné. Qu'en dis-tu ?
Cette perspective me plaisait beaucoup,
et je balbutiai que j'étais bien
reconnaissant ; mon
père et mon grand-père
ajoutèrent qu'ils ne pourraient jamais
reconnaître tant de bonté.
- Comment donc ! s'écria M.
Villiers mais c'est moi qui serai toujours votre
débiteur. Je ne pourrai jamais faire pour
vous ce que vous avez fait pour moi, et encore au
péril de vos deux vies... je vous prie de me
donner l'adresse de la brave femme dont le mari
vous a accompagnés dans cette course si
dangereuse et qui vous a aidés
elle-même à soigner notre
chérie. Nous lui écrirons tout de
suite, car nous ne l'oublions pas dans notre
reconnaissance. C'est donc entendu, vous nous
donnez votre Alain ?
- Oui, monsieur, dit mon
grand-père, mais accordez-nous un mois de
répit ; ce serait trop soudain
maintenant.
- Très bien, c'est juste ce qu'il
faudra pour qu'il entre au Collège
après les vacances.
Ainsi, en disant adieu à Lily,
j'avais l'espoir de la revoir bientôt. Son
vrai nom était Elisabeth, mais pour moi elle
resta toujours Lily, ma petite Lily.
Je ne pourrais décrire mes
impressions pendant le mois qui suivit ces
événements. Une nouvelle vie
s'ouvrait devant moi, et cette
perspective occupait toutes mes
pensées.
Tous les soirs, réunis tous trois
dans notre observatoire, nous parlions ensemble de
mon avenir ; et, pendant la journée,
j'errais dans notre petite île, me demandant
ce que j'éprouverais quand il me faudrait la
quitter.
Depuis la visite de M. Benson, il
s'était opéré un grand
changement dans notre intérieur. La grande
Bible avait été descendue de
l'étagère, et elle était
journellement lue et étudiée. Le
dimanche n'était plus comme les autres
jours, car nous le sanctifiions de notre mieux dans
notre solitude.
Il était aisé de voir que
mon grand-père était un nouvel homme,
que les choses vieilles étaient
passées et que pour lui toutes choses
étaient faites nouvelles. Il m'était
plus cher que jamais et ce n'était pas sans
un serrement de coeur que je pensais à
m'éloigner de lui.
- Je ne t'aurais jamais quitté,
grand-père, lui dis-je un jour, si papa
n'était pas revenu.
- Non, mon garçon, je ne crois
pas que j'aurais pu me passer de toi ; mais
ton père est revenu au bon moment. N'est-ce
pas, David ?
Enfin le jour du départ arriva.
Mon père et mon grand-père
m'accompagnèrent jusqu'à la
jetée et me virent monter dans le
bateau.
Les dernières paroles que
m'adressa mon grand-père
furent :
- Alain, mon garçon, tiens-toi
sur le Roc ! Tiens-toi fermement sur le Roc, et ne
le lâche pas !
Et, grâces à Dieu, je n'ai
jamais oublié les paroles de mon
grand-père.
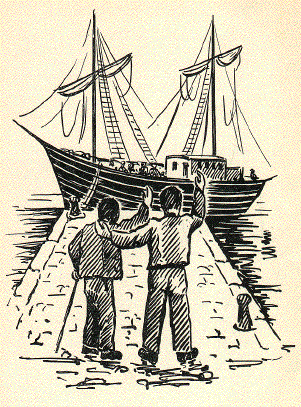
|