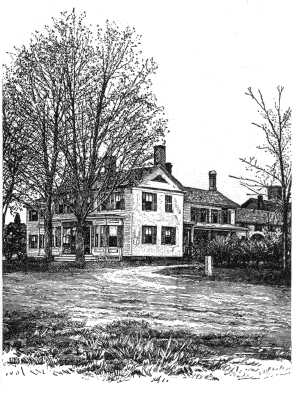MOODY
PÊCHEUR
D'HOMMES - MILITANT DES U. C. J. G.
CHAPITRE X
AVEC LES SIENS
Sa
mère
S'établir à Northfield,
à son premier retour d'Angleterre, avait
été pour Moody une joie très
grande. Lui qui, à seize ans, avait eu
hâte de quitter la maison pour voir du pays
et jouir de la liberté, était, en
fait, attaché par toutes les fibres de son
coeur au foyer natal. Il y retrouvait sa
mère, qui longtemps encore devait en
demeurer l'âme. À vrai dire, elle
n'avait autrefois guère compris son fils
dans sa décision d'abandonner les affaires
pour le service de Dieu, mais elle avait trop
prié pour n'être pas heureuse qu'il
eût obéi à l'appel d'En-Haut.
Ce n'est qu'en août 1876, et sans en avoir
annoncé l'intention, qu'elle vint assister
pour la première fois à un culte
présidé par lui. Lorsqu'il la vit se
lever et demander que l'on priât pour elle,
Moody, saisi, se tourna vers un fidèle ami
:
- Prie, toi, Jacobs, moi je ne le puis
pas!
Qui ne comprendrait l'émotion avec
laquelle il l'entendit ensuite proclamer
joyeusement sa foi ?
Dès ce jour, parvenue à la
liberté des enfants de Dieu, elle ne cessa
de progresser dans la vie spirituelle. À sa
constante sollicitude, Moody répondait par
une filiale et respectueuse tendresse. En voyage,
il ne se passait guère de jour qu'il ne
trouvât le temps de lui écrire ou de
lui envoyer quelques coupures de journaux, afin
qu'elle pût le suivre pas à pas. Elle
se réjouissait de sa droiture plus encore
que de sa réputation croissante.
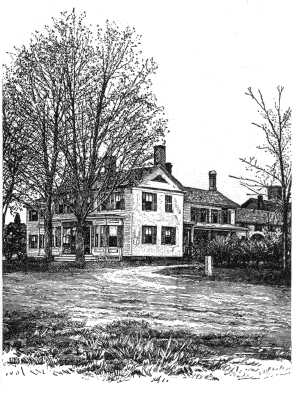 Maison familiale de Moody.
Maison familiale de Moody.
(d'après une gravure de 1886)
Attachée à la vieille maison de
famille que, sans lui enlever son cachet, Moody
avait faite plus confortable, l'aïeule,
admirablement conservée, entendait, à
quatre-vingt-six ans, tenir elle-même son
ménage ! «J'ai battu mon beurre tout
l'hiver, écrivait-elle. Ne me grondez
pas ! Un peu fatiguée, c'est vrai : mais
notre bon Père me donne Sa force jour
après jour»... Aussi les
élèves de Northfield et de
Mount-Hermon accouraient-ils volontiers vers Granny
(1) ,
séduits par son charme,
sa piété et le rayonnement de toute
sa personne.
Puis la fin s'annonça. D'une main
ferme encore, elle termina une dernière
lettre par ces mots : «je pense souvent
à la bonté que le Seigneur m'a
témoignée tout le long de ma vie. Il
m'a donné de si bons enfants !
».
À l'appui de cette affirmation, on
vit Moody interrompre une importante tournée
lorsque lui parvint l'alarmante nouvelle. il put
encore recueillir l'adieu de sa mère,
assister à sa fin paisible, et le jour des
obsèques lui rendre un suprême hommage
:
«Ce n'est point la coutume qu'un
fils prenne la parole en pareille circonstance,
mais je voudrais avoir la force de dire le grand
honneur que j'éprouve d'être le fils
d'une telle mère. Je ne puis assez la
bénir pour ce qu'elle a été.
Elle fut une femme très sage. En un sens,
elle a été plus sage que Salomon
puisqu'elle a su élever ses enfants. Elle en
a eu neuf, et tous ont aimé le foyer
familial. Elle a gagné leur coeur ; elle
pouvait faire d'eux ce qu'elle voulait. Loin
d'elle, ils soupiraient après le moment
où ils reviendraient s'établir
près du cher foyer. J'ai beaucoup
voyagé, J'ai vu beaucoup de mères ;
je n'en ai pas vu qui eût plus de tact. Ma
soeur aînée m'a dit, ces tout derniers
jours, quelque chose qui m'a brisé :
à savoir que, pendant la première
année qui suivit la mort de noire
père, ma mère pleurait chaque soir et
s'endormait exténuée de fatigue et de
tristesse. Or, devant ses enfants, elle se montrait
toujours gaie. Souvent, sous le poids de son
chagrin, elle se relevait la nuit et ma soeur
l'entendait invoquer Dieu. Mais avant de laisser
libre cours à sa tristesse, elle s'assurait
que nous étions endormis. jamais elle ne fit
de différence entre nous. Elle nous aimait
tous et d'un égal amour. Jamais elle ne
s'est plainte de nous. Et comme elle
appréciait la bonté qu'on lui avait
témoignée pendant ses années
de luttes ! Lorsque, rentrant à la maison,
il m'arrivait de dire sans bienveillance. «On
m'a fait ceci, on m'a fait cela ! » elle
m'arrêtait tout de suite :
- N'en dis pas davantage, Dwight ; cet
homme a été bon pour moi !
».
Maintes fois, prêchant sur la parabole
de l'enfant prodigue, Moody évoqua la
fidélité de l'amour maternel, image
infiniment touchante de l'amour du Dieu qui
pardonne. il en avait
trouvé un exemple éloquent dans sa
famille même. L'un de ses frères, en
effet, s'était éloigné de la
maison et devait en demeurer très longtemps
absent. jamais on ne prononçait son nom
devant la mère ; mais elle, toujours,
pensait à lui. «Bien des
années s'étaient
écoulées, ma mère avait
vieilli, ses cheveux étaient devenus blancs,
lorsqu'un après-midi d'été
apparut un homme au visage brûlé par
le soleil et couvert d'une barbe épaisse. Il
avait passé d'abord au cimetière.
Puis, arrivé devant la maison, il ouvrit le
portail, s'approcha d'une fenêtre, regarda
dans la chambre comme s'il craignait d'y voir des
étrangers. Enfin, il heurta à la
porte. Ce fut ma mère qui ouvrit.
Des années de luttes et de rudes
travaux avaient rendu l'homme
méconnaissable. Ma mère le pria
d'entrer. Lui, ne bougeait ni ne parlait, debout
dans l'altitude du repentir mais comme brisé
par le sentiment de son indignité. De
grosses larmes roulaient le long de ses joues... La
mère reconnut alors son fils perdu. Mais il
ne voulait pas franchir le seuil avant d'avoir
confessé son péché et entendu
des lèvres mêmes de celle qui, si
souvent et si longtemps avait prié pour lui,
la douce assurance du pardon.
Pensez-vous que cette mère ait
laissé son fils hors de la maison
jusqu'à ce qu'il eût achevé la
longue énumération de ses fautes,
qu'il eût accompli une série d'actes
de pénitence et redit je ne sais combien de
prières ? Non ! Rien de tout cela ! Elle
l'attira sur son coeur, le fit entrer sans
délai et eut, de ce retour, plus de joie que
ne lui en avaient causé tous les autres
enfants qui, eux, n'avaient pas quitté le
foyer.
Et c'est de la même manière
que Dieu pardonne aux prodigues qui reviennent
à Lui ! ».
Le
foyer familial
Le foyer, cadre où l'homme
apparaît sous son jour le plus vrai.
Dans la demeure aimée de Northfield
devaient grandir trois enfants : une fille, Emma,
et deux fils, William-Revell et Paul. La vie y
était paisible, intime. Rien ne vint
troubler ni, même un seul jour durant
près de quarante années, voiler
l'amour noble et pur qui avait rapproché
Dwight-L. Moody et Emma Revell aux heureux temps de
leurs fiançailles...
Compagne de vie s'associant pleinement à son
activité et le déchargeant de tout ce
qu'elle pouvait prendre sur elle des soucis du
ménage ou de la direction des écoles,
elle permit ainsi à Moody, entre ses
tournées ou pendant ses vacances, de jouir
pleinement de la vie de famille. C'est alors qu'il
aimait à se détendre, à jouer
avec les enfants, puis, lorsqu'ils grandirent,
à les suivre de près, à les
initier enfin à ses travaux. Lorsque fut
venu leur tour de fonder un foyer, il se plut
à pratiquer l'art d'être
grand-père. Ayant gardé son coeur
d'enfant, comment n'aurait-il pas aimé les
tout petits et su s'en faire aimer?
«Je l'ai vu un matin - raconte un
ami - rentrant en voiture dans la cour de sa maison
et ayant à ses côtés sa
petite-fille âgée de quatre ans ; elle
s'était endormie, appuyée contre lui.
Plutôt que de la réveiller, il fit
dételer doucement le cheval et resta dans la
voiture où bientôt lui aussi
s'assoupit ! ».
Enfin, les visites d'amis étaient
fréquentes, l'hospitalité de
Northfield, particulièrement au moment des
conférences d'été,
s'avérant inépuisable.
A cet heureux foyer, chaque journée
avait son programme. Debout de fort bonne heure
(avant six heures le plus souvent), Moody restait
d'abord seul avec son Dieu, lisant et
méditant Sa Parole ; il s'était fait
une règle de mettre à profit ses
vacances pour relire le Saint Livre chaque
année d'un bout à l'autre.
Après quoi, il faisait le tour des fermes et
rentrait pour un déjeuner familial où
l'on célébrait le culte quotidien. La
matinée était consacrée, soit
au courrier toujours considérable soit aux
écoles et aux conventions. De plus, tous les
jours, le chef présidait deux courts
services, l'un à neuf heures au
séminaire des jeunes filles, l'autre
à midi à l'Institut de Mount-Hermon :
il restait ainsi en contact journalier avec les
élèves, toujours prêt aux
entretiens personnels si on lui en exprimait le
désir. Un temps de repos suivait le repas de
midi : mais, bien souvent, il se transformait en
heure d'étude. Ensuite, promenade en
cabriolet: Moody conduisait lui-même,
entraînant volontiers sa femme ou ses enfants
à quelque excursion, à quelque visite
aux alentours. En général, la
soirée ne se prolongeait guère.
 Moody avec des
étudiants.
Moody avec des
étudiants.
Le régime était simple. On vivait
surtout des produits de la ferme et du jardin
où Moody aimait à travailler
lui-même et dont il savait
généreusement, au temps des
récoltes, faire
bénéficier
isolés, indigents et citadins. «Tout
homme, disait-il, doit avoir une marotte
quelconque pour se détendre
l'esprit». «Envoyez-moi donc une
lettre pleine de détails sur la
ferme», lisait-on parfois au milieu des
nouvelles qu'il donnait de ses voyages. Et,
d'autres fois, il écrivait : «J'ai
acheté vingt-cinq moutons et vingt-cinq
brebis pour l'école des garçons...
Nous avons donc maintenant huit vaches et nous
aurons bientôt soixante-quinze poules. Une
des dindes couve; j'aurai aussi des oies pour
mettre de l'animation dans le paysage ! Il nous
arrivera demain soir sept garçons, et nous
en attendons d'autres la semaine
prochaine». Le fragment fait tableau !
Mais ces élèves qui semblaient
l'intéresser à l'égal des
moutons ou des poules, Moody les suivait de
près ; il surveillait lui-même leur
logement et leur alimentation, partageait leurs
joies, prenait sa part de leurs chagrins, et
s'intéressait à eux avec une
paternelle sollicitude même lorsqu'ils
avaient quitté l'école.
L'hôte et
l'ami
Durant les conférences
d'étudiants et autres
«conventions» annuelles, son talent
consistait à diriger jusqu'aux moindres
détails, sans jamais se mettre en avant mais
en faisant appel à des orateurs du dehors,
notamment à ceux qui avaient l'habitude de
l'enseignement. Un jour, on insista pour qu'il se
fit entendre lui-même ; bon nombre de
délégués, lui disait-on,
étaient venus dans cet espoir. Non sans
difficulté, il accepta, mais convoqua son
monde... à six heures du matin, pour ne
prendre, disait-il, la place d'aucun autre !
L'assistance fut, ce matin-là, plus
nombreuse qu'à l'ordinaire !
Tous ceux qui l'ont vu chez lui, tous ceux
qui sont devenus ses amis, sont unanimes à
louer son charme. ils louent aussi son naturel, sa
bonhomie, son inaltérable entrain. Enfant,
il aimait à jouer de bons tours à ses
camarades d'école ou à inventer avec
eux des farces. Toute sa vie, il garda quelque
chose de cette malice, sans malveillance aucune.
Avec lui les rires éclataient et sonnaient
toujours francs.
Whittle, compagnon de la première
heure, raconte un séjour qu'il fit à
Northfield en compagnie de Sankey et de Bliss,
autre musicien de ses amis. Moody leur fit
parcourir tous les environs,
leur montra, dans la montagne, les lieux où,
adolescent, il allait garder les vaches et cueillir
des baies sauvages.
«Avec lui, nous allâmes
ensuite dîner chez son oncle Cyrus, de
l'autre côté de la vallée. Nous
traversions le fleuve en bac. Bliss et Sankey
chantaient ensemble divers cantiques, entre autres
ceux qui commencent ainsi : «Attendant le
pilote... » ou «Il est un pays de pures
délices... ». Moody aidait le passeur.
Nous eûmes le sentiment que la
traversée était
décidément bien lente. Après
le troisième ou quatrième cantique,
Sankey, portant ses regards sur Moody, constata
qu'il tenait le câble et ramait en sens
contraire du passeur, non seulement pour le plaisir
d'entendre chanter ses amis le plus longtemps
possible, mais aussi pour le bien du batelier :
c'était un de ses anciens compagnons
d'école et il priait pour sa conversion.
Moody s'amusa fort de la déception de
Sankey. Tous après avoir ri de bon coeur,
nous entonnâmes à l'unisson le
«Passons sur l'autre rive» et,
surveillant cette fois Moody du coin de l'oeil,
nous achevâmes la traversée...
».
Alors que, pour ses tournées de
conférences et ses voyages, il ne quittait
guère la tenue ecclésiastique qu'il
avait adoptée à Chicago dès
ses débuts de prédicateur, à
Northfield au contraire, il portait des
vêtements plus simples : un habit de velours
marron foncé, pantalon et gilet de teinte
jaunâtre, ce qui lui avait valu le surnom
familier de Bumblebee (gros bourdon). On le
voyait coiffé d'un chapeau
déformé par l'usage et les pluies et,
les jours de mauvais temps, chaussé de
bottes de caoutchouc, fendues par le haut parce
qu'il n'en avait trouvé nulle part d'assez
larges.
Fréquemment, au temps des
«Conventions» ou de la rentrée des
classes, il allait en voiture accueillir à
la gare quelque orateur ou quelque hôte.
Un jour, un voyageur, accompagné de
deux dames, l'aperçoit au milieu des autres
conducteurs attendant des clients et lui demande de
le conduire à l'hôtel. Moody essaie
d'expliquer qu'il est venu chercher des jeunes
filles. L'autre insiste :
- Ces jeunes filles ne sont pas les seules
à avoir besoin de vous. Menez-nous à
l'hôtel. Vite !
Moody, amusé, consent. Il entend le
monsieur expliquer aux dames que cet afflux de
voyageurs est dû à la rentrée
des cours des écoles qu'a fondées M.
Moody. Puis le dit monsieur
donne l'ordre au soi-disant cocher de les conduire
à l'hôtel le plus rapproché de
ces établissements qu'on appelle the
Northfields. On y arrive. Les étrangers
descendent de voiture, et Moody de tirer sur les
guides.
- Hé là ! hèle le
personnage, arrêtez donc ! je veux payer ma
course !
Peine perdue, Moody, faisant la sourde
oreille, touche du fouet et disparaît,
Stupéfait, l'étranger s'informe
:
- Quel est donc ce cocher qui ne veut pas
être payé'?
- Hé, c'est D. L.
- Quoi D. L.? Que voulez-vous dire?
- D. L. Moody, voyons !
... Le lendemain, l'étranger, confus
alla présenter des excuses à celui
que l'aventure avait cordialement diverti.
Avec ses
collègues
Comme bien on pense, ces dons
extérieurs, si remarquables fussent-ils, ne
suffisaient pas à justifier l'attrait
exercé par une telle personnalité. Ce
qui lui valait l'affection générale,
c'étaient sa piété, son
caractère viril, chevaleresque et modeste
à la fois, fort et doux tout ensemble, et
cette nature absolument
dépréoccupée de soi. Certes,
il pouvait comme tout homme se tromper, commettre
des impairs, mais jamais deux fois le même !
Il lui arrivait de céder à son
tempérament naturellement vif et même
emporté ; rien de plus touchant que de
l'entendre alors demander publiquement pardon pour
telle parole injuste, tel geste brusque qui lui
avaient échappé.
 Moody
présidant une réunion à
Northfield.
Moody
présidant une réunion à
Northfield.
Certain soir, ayant, sans raison, grondé
son fils cadet avec une
sévérité et une
vivacité inaccoutumées, on le vit
rejoindre l'enfant en pleurs, s'agenouiller
près de son petit lit, et, sanglotant lui
aussi, lui demander pardon pour son impatience et
sa rudesse. De tels aveux n'étaient pas
signe de faiblesse, mais plutôt de grandeur
d'âme ; ils procèdent de cette
maîtrise de soi qui impose le respect.
Qu'on en juge par d'autres exemples!
«Nous étions, raconte un
ami, réunis sous la tente, lors d'une
convention biblique à Northfield.
Adossé au mât central, Moody dirigeait
l'entretien. Tout à coup, il lança
comme une flèche la
question suivante :
- Frères, combien en est-il parmi
vous qui soient assez avancés dans la
grâce pour supporter qu'on les critique
?
Plusieurs mains se levèrent.
Comme un éclair, mais sans aigreur,
Moody se tourna vers un jeune ecclésiastique
:
- Alors, frère, lui dit-il, vous avez
parlé treize fois au cours de ces trois
journées, et peut-être avez-vous ainsi
empêché douze autres personnes tout
aussi qualifiées de prendre la
parole...
C'était la vérité : le
pasteur mis en cause s'était montré
importun et présomptueux. Moody jouait avec
lui franc jeu. L'interpellé avait
levé la main et s'était
déclaré prêt à accepter
un blâme. En fait, il le prit très
mal. Cherchant à se disculper, il ne put
qu'aggraver son cas. Là-dessus, un
Américain pur sang, donnant libre cours
à son indignation, apostropha Moody en
l'accusant de brusquerie. Moody rougit, laissa
passer l'orage ; puis, se cachant la figure dans
les mains, on l'entendit s'excuser :
- Frères, je reconnais la faute dont
on m'accuse. Mais moi, frères... je n'avais
pas levé la main ! ...
Une autre fois, dans une séance de
travailleurs chrétiens, Moody avait
présenté le haut idéal du
ministère et parlé de façon
mordante de ceux qui trahissent leur vocation
sacrée. Un jeune théologien protesta
:
- Mr. Moody, je ne vois pas de pasteur
ressemblant à celui que vous venez de
dépeindre.
Trop vivement, Moody rétorqua:
- Vous êtes encore très jeune :
vous en verrez beaucoup Restez à Rama
(2)
jusqu'à ce que votre barbe ait
poussé.
La réplique était injuste et
rude ; mais on ne pouvait, pour cela, suspendre la
séance qui se poursuivit. Chacun, cependant,
gardait l'impression que Moody n'avait pas
été fidèle à la
courtoisie et à l'amour qu'il
témoignait habituellement à ses
hôtes. Même emporté par sa
véhémence, il ne pouvait pas ne pas
s'en être rendu compte.
- Mes amis, s'écria-t-il tout
à coup, j'ai au début de celle
réunion, répondu d'une façon
insensée à un cher jeune pasteur je
demande à Dieu de me pardonner et je demande
pardon à mon frère...
Puis, allant droit à
l'offensé, il lui tendit la main.»
Pareille humilité ne
l'empêchait pas d'être terme et
d'imposer au besoin sa volonté lorsque le
salut des âmes, la dignité de
l'Évangile, l'honneur de Dieu étaient
en cause. C'est ainsi qu'un Jeune orateur
s'étant plaint avec vivacité que
Moody l'eût arrêté brusquement
alors qu'il prononçait une prière
(mais une prière interminable !) :
«- Vous dites que je vous ai
blessé, répartit Moody, J'en suis
désolé. Mais vous froissiez les
sentiments de centaines de personnes. J'aime mieux
blesser un seul homme que de le laisser en froisser
beaucoup d'autres !»
Les revivalistes sont souvent
accusés de donner dans l'excentricité
et d'ouvrir toutes grandes les portes à une
exaltation malsaine autant qu'à toute sorte
d'idées bizarres. Pareil reproche ne pouvait
être adressé à Moody. Sa
piété ardente, son zèle
dévorant ne l'aveuglaient aucunement et
n'étouffèrent jamais son robuste bon
sens. Il avait en horreur tout ce qui sonne faux,
le pathos, le sentimentalisme et la
mièvrerie et, tout aussi bien, le fanatisme
ou les «trucs» dont certains orateurs se
servent pour attirer l'attention et capter les
âmes.
Le
chef
Ce fut aussi un admirable
président. Une photographie prise an cours
d'une des conférences d'été le
montre, assis sur le bord de sa chaise,
appuyé sur l'accoudoir, suivant
attentivement la discussion. Il semble prêt
à intervenir, au besoin à sauter
à la tribune pour éviter que
l'entretien ne s'engage sur une fausse voie ou
n'aboutisse à une impasse. On dit qu'il ne
présidait pas, mais imprégnait la
séance de son esprit et l'on comprend que
les participants en aient gardé un souvenir
ineffaçable.
De ce bon sens sanctifié par
l'Esprit, qui a été l'une de ses
forces, voici encore un exemple remontant aux
débuts de son ministère.
Rentré chez lui après une
journée fort bien remplie, il demanda
à l'évangéliste, qui
était son hôte ce jour-là, de
bien vouloir faire le culte. L'excellent
chrétien commenta longuement une portion de
l'Écriture puis pria, très longuement
aussi. Après l'amen final, on vit Moody
rester à genoux. Sa femme, d'abord
émue de ce recueillement
prolongé, fut tout à coup envahie
d'un sentiment d'inquiétude à le voir
immobile à ce point, car elle se souvenait
que son père, Edwin Moody, avait
été enlevé par une mort
subite... Elle lui toucha l'épaule. À
ce moment, il tourna la tête vers elle mais,
à l'expression atone et candide de son
visage, on reconnut que le maître de
céans s'était tout simplement
endormi... Son visiteur crut devoir rappeler
sentencieusement le texte sacré :
«L'esprit est prompt, mais la chair est faible
» !
« - Pas du tout ! déclarait-il
plus tard en racontant l'incident : c'est lui qui
était à blâmer de parler si
longuement après une journée de rude
labeur. Je croyais alors manquer de
spiritualité J'étais tout simplement
insensé. Le Seigneur n'est pas un
Maître dur: Je me tuais en travaillant
follement, jour et nuit, sans même prendre le
temps de manger. J'ai appris depuis lors que, si je
veux bien servir mon Maître, je dois agir
avec bon sens et, depuis ce temps-là, je
fais mon culte le matin, alors que je suis tout
à fait réveillé».
Il arrivait parfois qu'il dût
faire acte d'autorité. Ses décisions
étaient alors acceptées par ses aides
et subordonnés, car ceux-ci les sentaient
inspirées par l'expérience. À
son fils qui cherchait un jour à le faire
revenir sur un point où leurs vues
divergeaient, il déclara fermement :
«- Mon fils, tant que j'aurai la
responsabilité de cette affaire, je veux
qu'elle se fasse comme je l'entends. Le moment
viendra où toi tu en seras responsable :
alors tu pourras agir comme tu le jugeras
bon.»
C'est ainsi qu'il fut amené
à prendre très nettement position
dans la question des guérisons par la foi.
En ce temps-là, quelques
élèves de l'institut biblique de
Chicago avaient adopté les vues de ceux qui
estiment que la foi dispense de recourir à
la science médicale. Le bruit se
répandit que c'était là une
conséquence de l'enseignement donné
à l'Institut. Sans même ouvrir une
enquête sur les faits qui étaient
à la base de ce bruit, Moody fit venir le
directeur général et les chefs des
divers services. Il leur dit qu'il avait eu vent
que telle et telle chose s'était
passée, qu'il croyait légitime
l'usage de remèdes prescrits par la science
médicale et déclara solennellement
qu'à son avis la prière de la foi
n'exclut nullement cet usage. Il déclara
qu'au surplus il ne voulait pas être
accusé de garder à l'Institut des
élèves qui en cas
de maladie refuseraient de consulter un
médecin. C'était net et clair.
Lorsqu'il eut terminé, frappant la table du
poing, il conclut ainsi :
«Si des gens enseignent qu'en cas de
maladie il ne faut pas appeler le docteur, qu'ils
sortent ! C'est tout».
Et il leva la séance.
Autocrate ? Oui, mais seulement en ce
sens qu'il savait au besoin accepter les
responsabilités et agir en
conséquence. Autrement, jamais il n'a voulu
faire oeuvre personnelle. Bien des actes ont mis en
évidence chez lui l'humilité
authentique du chrétien qui ne veut qu'une
chose comme son Maître, servir.
Faut-il insister encore sur son
désintéressement jamais Moody n'a
voulu accepter de traitement fixe. Il s'attendait
à Dieu pour son pain quotidien. Il connut
des heures de gène : elles ne purent abattre
sa confiance. Ses amis pourvurent au
nécessaire. Il n'acceptait que ce qui
était indispensable à son entretien
et ne se départit jamais de son idéal
de simplicité, autant pour les siens que
pour lui-même. Si quelqu'un tenait à
lui témoigner sa reconnaissance par un don,
immédiatement il en trouvait l'emploi et
faisait parvenir la somme à une Union
chrétienne de jeunes gens, un
collège, une institution de bien public. Il
confia à un conseil d'administration de
trois personnes la gérance des fonds
assurés par les éditions successives
du recueil de cantiques qu'il avait
édité jadis avec Sankey, fonds qui,
à la fin de septembre 1885,
déjà s'élevaient à
trois cent cinquante mille dollars (1.750.000
francs or). On chargea de la vérification
des comptes un homme de loi de grand renom, qui
d'ailleurs n'avait pas caché son
dédain pour ces campagnes
d'évangélisation et même avait
accusé Moody aussi bien que Sankey
d'être de vulgaires profiteurs. Après
avoir examiné les livres, il retira ses
accusations, reconnut la parfaite loyauté de
l'évangéliste et du chanteur. Puis il
déclara qu'après tout ils
étaient bien fous de laisser glisser entre
leurs doigts une telle fortune ! ...
Cette droiture, cet oubli de
soi-même, donnaient à toute la
personnalité du chef un rayonnement
extraordinaire. Il était de ceux qui,
partout où ils se présentent,
là même où ils ne font que
passer, assainissent l'atmosphère et devant
qui l'on ne peut éprouver de sentiments
mesquins. De tels êtres imposent le respect
même à des inconnus. Un
témoin autorisé a
raconté que, se trouvant un jour chez le
coiffeur, il eut le sentiment que l'homme qui
venait d'entrer et s'était installé
dans le fauteuil voisin du sien n'était pas
un client quelconque. Sans aucune
pédanterie, chaque parole qu'il
prononçait témoignait d'un
intérêt vivant pour l'employé
qui s'occupait de lui.
«Je compris très vile que
J'avais assisté à une réunion
d'évangélisation, mon voisin
n'étant autre que Moody. Intentionnellement,
je m'attardai dans ce salon de coiffure
après son départ et notai, sur les
employés qui étaient là,
l'effet singulier de son passage. Tous parlaient
à mi-voix. Ils ignoraient son nom, mais ils
savaient que quelque chose avait
élevé leurs pensées et,
lorsque je me relirai, ce fut comme si je sortais
d'un sanctuaire... ».
On appréciera la valeur de ce
témoignage lorsqu'on saura qu'il a pour
auteur le président Woodrow Wilson
lui-même.
|