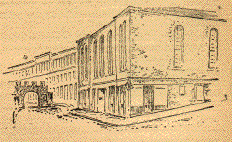REINE
BLANCHE EN PAYS NOIR
Vie de Mary
Slessor, missionnaire au
Calabar
PREMIÈRE PARTIE
En Écosse. - En famille et à
la fabrique.
1848-1876
CHAPITRE I

Mary Slessor, le second enfant d'une famille de
sept, naquit en décembre 1848, à
Aberdeen, en Écosse. Son père,
cordonnier de son métier, ne faisait pas de
gros bénéfices, en sorte que
l'économie la plus stricte était
obligatoire dans le ménage : pas
question d'y avoir une bonne d'enfants !
Dès ses plus jeunes années Mary aida
sa mère à s'occuper des petits. Pour
elle pas de poupées : les
bébés à habiller, à
endormir, à amuser, à faire promener,
en tenaient lieu ! Et ne sont-ce pas là
les meilleures poupées, ces petits
êtres chéris qui vous rendent du matin
au soir l'affection que vous leur
donnez ?
Mais pourquoi, allez-vous
peut-être demander, nous raconter l'histoire
de Mary Slessor plutôt que toute autre ?
Voici pourquoi : parce que Mary
Slessor fut un instrument dont
Dieu se servit pour accomplir une oeuvre immense.
Elle se laissa guider par lui, elle obéit
à sa voix, elle le suivit partout, et fut
son témoin fidèle là où
personne encore n'avait porté
l'Évangile de Jésus-Christ.
Son histoire vous intéressera, je
le sais, mais ce n'est pas seulement pour vous
intéresser que je l'ai traduite à
votre intention : c'est dans le ferme espoir
que vous ferez comme a fait Mary Slessor ;
qu'après avoir donné votre coeur au
Seigneur, vous lui consacrerez vos forces, votre
énergie, votre vie tout
entière ; en un mot, que vous serez un
instrument docile entre les mains de votre
Dieu.
Un des jeux favoris de Mary Slessor,
dans son enfance, était d'imaginer qu'elle
était maîtresse d'école,
qu'elle avait de petits écoliers devant
elle, et que ces écoliers étaient
nègres ! Idée
bizarre !
Mais voici ce qui l'expliquait. La
mère de Mary s'intéressait beaucoup
aux Missions en pays païen. L'Église
à laquelle elle appartenait avait
envoyé des missionnaires dans
différentes parties du monde, et, tout
récemment, avait entrepris une oeuvre
nouvelle sur la côte occidentale de
l'Afrique, dans une contrée appelée
Calabar, qui faisait partie de la Nigérie.
En Écosse, tout le monde parlait de ce
nouveau champ de travail, et pensait aux
missionnaires qui y couraient de grands dangers et
enduraient de grandes privations.
Mme Slessor, en revenant des
réunions missionnaires, réunissait
ses enfants autour d'elle, et leur racontait en
détail tout ce qu'elle venait
d'entendre ; elle leur
parlait de ce terrible pays et des coutumes si
cruelles de ses habitants ; elle leur disait,
entre autres choses, que ces peuplades sauvages
tuaient tous les enfants jumeaux et chassaient
leurs pauvres mamans dans la forêt.
Mary avait le coeur serré en
pensant à ces petits êtres, et elle y
pensait très souvent. C'est pour cette
raison qu'elle faisait d'eux ses écoliers
imaginaires. Elle rêvait d'aller un jour en
personne dans ce pays cruel et de sauver la vie des
petits jumeaux !
- Maman, disait-elle parfois, je serai
missionnaire ; j'irai donner des leçons
aux petits nègres, et je leur apprendrai
à se bien conduire.
- Toi, missionnaire !
répliquait Robert son frère
aîné, de ce ton supérieur que
tous nous connaissons si bien. Tu n'es qu'une
fille, et les filles ne sont pas missionnaires.
C'est moi qui serai missionnaire. Tu pourras venir
avec moi ; même t'asseoir à
côté de moi dans ma chaire, si tu es
bien sage.
Mme Slessor souriait de ces
discussions ; elle était heureuse de
penser que son Robert serait peut-être, un
jour, serviteur de Jésus dans les pays
païens. Il ne devait cependant pas en
être ainsi ; Dieu en avait
décidé autrement ; Robert mourut
jeune, et Mary devint ainsi l'aînée de
la famille.
Un nuage noir vint bientôt,
hélas ! s'abattre sur la famille. M.
Slessor s'adonna à la boisson, et ne tarda
pas à en devenir l'esclave. Il
dépensait au cabaret presque tout l'argent
qu'il gagnait ; sa femme et ses enfants
manquaient du nécessaire.
Dans l'espoir que si M. Slessor
s'éloignait des camarades qui
l'entraînaient il abandonnerait ses tristes
habitudes, la famille quitta Aberdeen, et alla
s'établir à Dundee, autre ville
d'Écosse. Là on loua une petite
maison avec un bout de jardin. Mais M. Slessor
continua à marcher dans la mauvaise voie
où il s'était engagé.
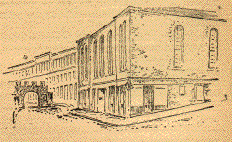
L'ÉGLISE DE DUNDEE
Mary avait maintenant huit ans. Elle aidait sa
mère de plus en plus efficacement ;
elle emmenait les petits faire de longues
promenades, leur faisait grimper des rues
escarpées d'où l'on apercevait de
loin la campagne, ou bien les conduisait au bord de
la rivière. Quelquefois Mme Slessor donnait
une pièce de douze sous qui permettait
à toute la bande de se payer un tour sur les
chevaux de bois.
Le dimanche, tout ce petit monde partait
en trottinant pour l'église, et assistait
d'abord au service, puis à l'école du
dimanche. Heureusement que la
maman avait eu soin de donner à chacun une
pastille de menthe à sucer lentement pendant
le sermon, pour que le temps parût moins
long !
En règle générale,
Mary était sage et patiente, mais cette
règle-là, comme toutes les autres,
avait des exceptions. Ainsi par exemple, la petite
fille se fâchait, tout rouge contre ses
frères, lorsque, pour la taquiner, ceux-ci
l'appelaient carotte, à cause de la couleur
de ses cheveux. Parfois aussi, elle faisait
exprès quelque sottise, tout comme en font
les enfants de son âge. Une ou deux fois
même, elle remplaça l'école du
dimanche par une promenade ; mais, à
son retour, la tristesse de Mme Slessor suffit
à la faire rentrer en
elle-même.
Le jour approchait cependant où
un grand changement allait se produire en elle, -
le plus grand changement qui puisse se produire en
tout être humain, et qui transforma sa
vie : elle donna son coeur au Seigneur
Jésus. Un soir, bien timidement, elle se
glissa auprès de sa mère, et, mettant
sa figure tout contre la sienne, lui raconta ce qui
s'était passé ; puis elle
ajouta : « J'essaierai, maman, de te
faire plaisir et de t'aider ». La joie de
Mme Slessor fut bien grande. Elle serra tendrement
sa fillette dans ses bras. Ah ! si seulement
le nuage noir se dissipait !
Mais, au contraire, il se faisait plus
épais. Il ne suffit pas, pour perdre des
habitudes mauvaises, d'aller d'une ville dans une
autre ; il faut que le coeur soit
changé. M. Slessor rapportait chez lui si
peu d'argent que sa femme fut obligée de
travailler au-dehors, pour que ses
enfants eussent leur pain quotidien.
Restée seule au logis avec ses
frères et soeurs, Mary devint plus que
jamais la petite maman. Elle se levait de bonne
heure, se couchait tard, était souvent bien
lasse ; mais quand, fatiguée, Mme
Slessor revenait de son travail, Mary la recevait
toujours avec un joyeux sourire de
bienvenue.
Les jours, les semaines, les mois se
passèrent sans amener d'amélioration
dans les habitudes du père de famille. Les
enfants grandissaient et les dépenses se
faisaient plus lourdes ; en sorte qu'à
son tour Mary dut gagner sa vie. Et pourtant, elle
n'avait que onze ans !
Elle fit ses débuts dans une
grande fabrique. Entourée de machines,
d'engrenages, de courroies tournoyant avec la
rapidité de l'éclair, elle en fut
d'abord un peu effrayée. Heureusement il
était de règle que les très
jeunes ouvrières ne travaillassent que le
matin ; l'après-midi elles suivaient
une école qui dépendait de la
fabrique ; et là, elles apprenaient
à lire, à écrire et à
compter. Mary aimait la lecture, mais
détestait cordialement les longues
additions : il lui semblait que les chiffres
dansaient devant elle ; et, quant aux
problèmes, elle n'y comprenait rien de
rien.
Mais, par contre, elle était fort
habile de ses doigts et sut vite très bien
tisser. Quelle joie ce fut pour elle de remettre
à sa mère son premier salaire !
Mme Slessor le reçut en pleurant et le mit
de côté, ne pouvant se décider
à le dépenser tout de suite.
À quatorze ans Mary tissait
à l'un des plus grands métiers et se
faisait déjà de bonnes
journées. Mais elle ne mangeait pas le pain
de la paresse : elle se levait à 5
heures du matin, dès que le sifflet de la
fabrique se faisait entendre, et devait être
devant son métier à 6 heures. La
journée ne finissait qu'à 6 heures du
soir ; mais, entre temps, elle avait deux
heures de liberté pour les repas. Le samedi
après-midi et le dimanche elle avait
congé, et en profitait pour donner un bon
coup de main chez elle. Sa tenue était des
plus simples ; non qu'elle fût
indifférente aux toilettes Soignées,
mais uniquement afin de mettre de côté
le plus possible pour le ménage.
Car, hélas ! mère et
fille avaient perdu tout espoir que M. Slessor leur
vînt en aide. Le fardeau qu'elles portaient
ensemble était bien lourd, la lutte qu'elles
livraient bien acharnée. Dans leur
détresse elles s'attachèrent l'une
à l'autre toujours plus
étroitement ; ensemble elles priaient,
demandant au Seigneur de leur donner secours, force
et courage. Le samedi soir, le père de
famille rentrait fort tard, et se conduisait de
telle façon que la pauvre Mary s'enfuyait
souvent de la maison et errait dans les rues
jusqu'à ce que son père fût
couché. Oh ! qu'alors elle se sentait
triste et misérable ! Comme elle
sanglotait ! En passant devant les cabarets
brillamment éclairés, elle se
demandait pourquoi il était permis de vendre
ces boissons, ruine de tant de vies.
Les tristes expériences par
lesquelles elle passait laissèrent leur
empreinte indélébile sur cette
âme en formation ; mais
Dieu permit que ces expériences mêmes
eussent des résultats bénis pour
Mary ; elle apprit à sympathiser avec
ceux qui sont dans la peine, à avoir
pitié de tous ceux qui souffrent. Et surtout
elle devint le champion des petits enfants et de
tous les êtres faibles ou opprimés. De
plus, et sans qu'elle s'en rendît compte
encore, ces expériences la
préparèrent pour la tâche qui
l'attendait. Comme certaines plantes des tropiques
qui n'exhalent leur parfum que dans
l'obscurité, Mary se développa
spirituellement dans la nuit de
l'épreuve ; elle apprit à
être brave, patiente, à penser
à autrui.
Grandir dans un milieu
privilégié, former son âme dans
des circonstances faciles, cela n'a pas toujours,
je dirai même, cela n'a pas souvent pour
résultat une vie utile à
soi-même et aux autres.
C'est bien plutôt l'opposé.
Combien d'hommes et de femmes, auxquels le monde
doit beaucoup, eurent une enfance et une jeunesse
ardues, durent lutter pied à pied contre des
circonstances adverses ! Lincoln, par exemple,
qui fut président de la République
des États-Unis et libéra des millions
d'esclaves, eut comme Mary Slessor une enfance et
une jeunesse bien difficiles ; mais son nom
est devenu un des plus célèbres de
l'histoire. Qu'aucun de vous, les jeunes, ne se
décourage parce qu'il est pauvre ou
isolé, ou que tout semble se liguer contre
lui ; que patiemment il - ou elle - lutte avec
persévérance contre les obstacles qui
obstruent son chemin. Peu à peu les choses
s'arrangeront, de meilleurs jours
viendront, le soleil percera les
ténèbres.
Enfin M. Slessor mourut. Qu'il est
douloureux, amèrement triste, d'avoir
à regarder comme une délivrance la
mort d'un père ou d'une mère !
Après le décès de son mari,
Mme Slessor quitta la fabrique et prit un petit
magasin. Le samedi après-midi et le samedi
soir, qui sont toujours des moments de presse en
Grande-Bretagne, où tous les magasins sont
fermés le dimanche, Mary aidait sa
mère dans la boutique.
Elle devenait jeune fille. Les beaux
rêves de son enfance remplissaient de plus en
plus son coeur et son esprit, et elle faisait de
son mieux pour que ces rêves, devinssent des
réalités. Ainsi, se rendant compte de
son manque d'instruction, elle se mit à lire
le plus possible ; et à mesure qu'elle
apprenait, elle avait soif d'en savoir davantage.
Dans son ardeur à s'instruire, elle lisait
en marchant pour aller au travail ; et, sans
savoir que Livingstone en avait fait autant dans sa
jeunesse, elle appuyait un livre ouvert sur le coin
de son métier et y jetait un coup d'oeil de
temps en temps. Ses compagnes d'atelier racontaient
qu'elle avait toujours un carnet dans sa poche, et
y écrivait ses pensées, ses
impressions, voire même des
poésies ! Toujours est-il que jamais
elle ne négligeait son travail.
Vous le voyez, Mary ne menait pas une
vie facile ; mais les quelques précieux
moments qui lui appartenaient, comme elle savait
les mettre à profit ! Les livres
qu'elle lisait n'étaient pas des histoires
amusantes ou des romans, et je me demande ce
qu'ils vous diraient, à
vous ! C'étaient le « Paradis
perdu », de Milton, les ouvrages de
l'historien anglais Carlyle, etc. Les lectures la
captivaient à tel point qu'elle les
continuait parfois jusque bien avant dans la nuit,
et tressaillait de surprise lorsque le sifflet de
la fabrique annonçait qu'il était
l'heure de se lever. En cela, vous ferez aussi bien
de ne pas l'imiter !
Mais, de tous les livres, celui que Mary
aimait le plus et connaissait le mieux,
c'était la Bible. Elle ne lisait pas la
Bible par devoir ou par habitude, comme le font
tant d'autres jeunes gens ou jeunes filles, elle la
lisait par amour pour cette précieuse Parole
de Dieu ; souvent elle en apprenait par coeur
de longs fragments. Elle faisait partie d'une
classe biblique, et elle était toujours si
prête à répondre aux questions
que posait le pasteur, que celui-ci finit par lui
dire en souriant : « Ne
répondez que lorsque je m'adresserai
à vous personnellement ». Ce qu'il
ne faisait que si personne d'autre n'avait pu
répondre. Alors, se tournant vers elle, il
disait : À vous
maintenant » ; et elle avait
toujours une bonne réponse toute
prête.
Elle ne se lassait pas de relire les
évangiles. surtout celui de saint Jean.
Quand elle réfléchissait à
tout ce qu'avait fait pour nous le Seigneur
Jésus, quand elle se disait qu'il avait
quitté le ciel pour venir sur la terre
arracher les hommes au péché et
à la mort, qu'il avait souffert, même
jusqu'à la mort de la croix, et qu'il
apportait paix, délivrance et lumière
à tous, il lui semblait que jamais elle ne
pourrait assez prouver à son Sauveur
son amour, sa reconnaissance, son
dévouement. « Jésus a rendu
les gens heureux, il les a rendus meilleurs, et il
dit que nous devons le suivre et agir comme il a
agi. Moi aussi je dois lutter contre tout ce qui
est mal, tout ce qui est laid, tout ce qui
trouble ». Ainsi pensait-elle. Jamais
elle ne se disait : « Je ne suis
qu'une fille, à quoi bon penser à
travailler pour le Seigneur ? » Au
contraire, elle savait très bien qu'elle
aussi avait sa place dans l'armée de ses
serviteurs. « Seigneur, disait-elle
humblement, je ferai selon mon pouvoir ce que tu me
donneras à faire ; mon coeur, mes
mains, mes pieds, mon être tout entier, sont
à ton service. »
|