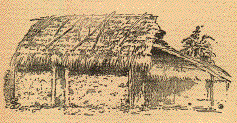REINE
BLANCHE EN PAYS NOIR
Vie de Mary
Slessor, missionnaire au
Calabar
TROISIÈME PARTIE
La Conquête de l'Okoyong
1881-1902.
CHAPITRE VI
Il ne faut pas s'étonner si des
peuplades sauvages, si nouvellement soumises au
protectorat de la Grande-Bretagne, oubliaient bien
vite les lois qui leur avaient été
imposées, pour continuer leur vie
accoutumée. Ma voyait bien ce qui en
était ; souvent elle menaçait
les indigènes de leur faire sentir le joug
du pouvoir dont elle était le
représentant de par son titre de consul.
Une fois, les terres d'une veuve avaient
été saisies. Elle demanda aux gens
s'ils préféraient que le cas
fût jugé par la loi de Dieu ou par le
consul accompagné d'un canon. Les
indigènes réfléchirent, puis
répondirent. « Iko
Abasi », (par la loi de Dieu).
Sur ce, Ma ouvrit sa Bible et lut
à haute voix :
« Voilà la loi de
Dieu », dit-elle. Et les terres furent
rendues à la veuve.
Puis un chef mourut, et un innocent fut
accusé d'avoir causé sa mort. Ma en
fut avertie ; mais une tempête faisait
rage et elle envoya le message suivant :
« Dès que la pluie aura
cessé, je viendrai voir de quoi il
s'agit ».
« C'est cela !
grognèrent les gens. Et, quand elle viendra,
elle ne nous permettra pas de donner le poison au
prisonnier. Cachons-le bien
vite ».
Et d'urgence ils
expédièrent cet homme au fin fond de
la forêt, hors de l'atteinte de Ma.
Lorsque celle-ci, fatiguée et
malade, apprit les faits, elle dit
simplement : « Très
bien ; cette fois-ci je n'irai pas à
leur recherche. Il faut absolument qu'ils
apprennent à obéir aux lois, et il
est temps que je leur donne une
leçon ».
Elle écrivit sur le champ au
consul de Duke Town, le priant d'envoyer quelqu'un
qui eût l'autorité nécessaire
pour imposer sa décision dans la
circonstance présente. Et, afin d'être
sûre que la lettre arriverait à
destination, elle la porta elle-même à
l'embarcadère et la remit à un homme
de confiance.
Mais en pays nègre tout se
sait ! Ce que Ma venait de
faire parvint sans retard à l'oreille des
perturbateurs, et ils sortirent de la forêt
en aussi grande hâte qu'ils s'y
étaient cachés. Ils se
précipitèrent à la maison
missionnaire.
- Où est Ma ?
demandèrent-ils à Janie. Nous avons
besoin de Ma.
- Ma a été chercher le
consul, répondit Janie, de fort mauvaise
humeur. J'espère qu'il viendra avec un gros
canon. Il en est temps. Vous êtes en train de
tuer Ma avec vos sottises.
Confus et sérieusement
alarmés, ces hommes se retirèrent.
Pour eux, « un gros canon »
signifiait leurs maisons et leurs récoltes
détruites, ruinées, des arrestations,
des emprisonnements. Dès que Ma fut de
retour, ils revinrent, et la supplièrent
d'obtenir du consul qu'il s'engageât d'avance
à ne pas venir avec l'idée de leur
faire la guerre.
« Entendu, répondit
Ma ; nous aurons un grand palabre et nous
discuterons sur toutes vos mauvaises
coutumes. »
Lorsqu'arriva l'envoyé officiel
du consul, accompagné de quelques soldats,
il fut bien amusé de trouver cette reine
« d'Okoyong » assise
nu-tête sur son toit pour y réparer
une brèche ! Ma descendit et
reçut ses visiteurs. Un grand palabre eut
lieu, et les chefs promirent solennellement de ne
tuer personne aux enterrements, et de laisser vivre
les jumeaux.
Mais Ma leva les épaules.
« Ils promettront tout ce que vous
voudrez, dit-elle au représentant de
l'autorité britannique ;
n'empêche qu'il me faudra les surveiller
comme du lait sur le feu. » Car
elle les connaissait à
fond ses amis les indigènes ! En effet,
ils ne tinrent pas leurs engagements, et Ma dut
demander que le consul vînt en personne, ce
qui fut fait. Sir Claude Macdonald parla aux chefs
avec bonté, mais aussi avec fermeté.
« Les lois sont faites pour votre bien,
dit-il, pour votre sûreté et pour
maintenir la paix ; mais si vous ne les
observez pas, vous serez punis. »
Acquiesçant à tout ce que
disait le consul, les chefs lui
déclarèrent :
« Monsieur, quand on nous dit quelque
chose une fois, nous n'y faisons pas
attention ; mais quand on nous le dit deux
fois, nous y obéissons ».
Ma aussi prit la parole. Elle parla des
bénédictions qui accompagneraient
l'obéissance aux lois, dépeignit les
jours de bonheur et de paix dont le pays jouirait,
- même après qu'elle aurait
disparu.
« Ma ! Ma !
interrompirent les chefs vivement émus, tu
ne peux nous quitter ! Tu es notre mère
et nous sommes tes enfants. Dieu ne te prendra pas
avant que nous ne puissions marcher tout
seuls ».
Cela se passait en 1896. Après
ces événements importants, la vie de
Ma se fit plus active et remplie que jamais. Elle
s'aperçut que petit à petit les
habitants d'Ekenge quittaient le village pour aller
s'établir plus avant dans le pays, et
bâtissaient de nouvelles huttes à un
endroit appelé Akpap. Elle décida de
les suivre.
La Mission promit de lui bâtir une
maison à Akpap ; mais construire une
maison prend du temps, surtout en Afrique où
personne n'est pressé !
En attendant l'accomplissement de cette
promesse, il fallait bien que Ma se logeât,
elle et sa nombreuse famille. Elle ne trouva de
disponible qu'un petit hangar, sorte
d'étable à deux compartiments comme
ces cabanes de bergers dans la montagne, qui sont
dépourvues de fenêtres et qui ont le
sol pour plancher. Mais Ma, comme de coutume, pensa
au Maître qu'elle servait, et qui, lui,
n'avait pas même un « lieu
où reposer sa tête » durant
sa vie terrestre ; elle ne se plaignit pas.
Elle arrangea ses caisses dans un des compartiments
de la hutte et elle et ses enfants
s'installèrent dans l'autre.
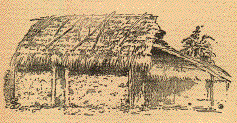
LA
MAISON DE MA À AKPAP
Le hangar, rendez-vous général des
rats, lézards, fourmis, cafards, et de tous
les insectes qui volent ou qui rampent, laissait
fort à désirer lorsqu'on
espérait dormir. Les rats se servaient de Ma
comme d'un tremplin pour gagner le toit où
ils se livraient à un jeu de cache-cache des
mieux réussis.
M. Ovens, arrivant à Akpap pour y
entreprendre la construction de
la maison missionnaire, voulut, pour se
rafraîchir, se laver la figure. Dans la
demi-obscurité de la hutte, il
aperçut une cuvette pleine d'eau et qui
contenait même ce qu'il prit pour une
éponge. Ravi, il saisit ladite
éponge ; la promena sur sa figure, et
découvrit... que son éponge
n'était ni plus ni moins qu'un rat
noyé !
De cette humble demeure, comme si
c'eût été un palais, Ma
continua à régner sur
l'Okoyong.
Hélas ! une maladie
étrange s'abattit sur les enfants de la
contrée ; quatre des tout petits de Ma
en furent atteints et y succombèrent. Puis
la petite vérole, ce terrible fléau,
frappa le pays et en décima les habitants.
Partout les huttes étaient remplies de
cadavres que personne n'osait ensevelir. Ma,
occupée de l'aurore à la nuit et
souvent de la nuit à l'aurore, vaccinait les
bien portants, soignait les malades et les
mourants. Au grand chagrin de Ma, Edem fut atteint
à son tour. Malgré tous ses
défauts, résultat inévitable
de son éducation païenne, il avait
toujours témoigné de la bonté
à Ma, et celle-ci lui en était
reconnaissante. Edem n'avait pas suivi ses sujets
à Akpap, et ce fut à Ekenge que Ma se
rendit pour le soigner. Elle le trouva absolument
seul, car tous l'avaient fui dès les
premiers symptômes de la maladie. Pendant de
longues heures elle lutta de son mieux contre le
mal. Vains efforts : Edem mourut vers le
milieu de la nuit. Alors, fatiguée comme
elle l'était par sa longue marche, son
manque de sommeil et tous ses travaux
récents, Ma sortit de la hutte, alla
chercher des planches, fit un cercueil dans lequel
elle plaça le cadavre,
puis elle creusa une fosse et y enterra le
chef.
Vous avez bien compris ? Cette
femme, seule dans la nuit, en pleine forêt,
fit un cercueil, creusa une tombe, ensevelit un
mort...
Lorsque le chef d'Ekenge entra dans
« le monde des esprits », il
n'y eut ni danses, ni orgies, ni meurtres autour de
son cercueil ; mais les étoiles
silencieuses brillaient au ciel, et une femme
blanche, solitaire et triste, priait près de
la tombe. L'aube naissante trouva Ma se
traînant péniblement à Akpap,
où elle arriva brisée et dut
s'aliter.
Elle ne se reposa pas longtemps !
Partout on l'appelait.
Cependant, après plusieurs
accès de fièvre, elle dut
reconnaître que l'énergie et la
volonté d'agir ne remplaçaient plus
pour elle les forces physiques
épuisées. Ses amis de la Mission lui
répétaient : « Si vous
ne prenez pas un congé immédiatement,
vous mourrez ». Elle ne désirait
pas mourir encore : elle voulait vivre et
travailler pour Jésus, son Maître et
son Sauveur. « Très bien,
répondit-elle donc ; si un congé
doit me rendre des forces, va pour le
congé ! Mais que faire de mes
petits ? »
Une dame missionnaire d'une autre
station offrit de se charger de deux des plus
jeunes et de quelques fillettes avec l'aide
d'lyé. Sur quoi Ma décida que Janie,
Mary, Alice et Maggie l'accompagneraient en
Écosse.
- Ma, protestèrent ses amis,
malade comme vous l'êtes, vous n'allez pas
voyager avec quatre petites
négrillonnes ? Impossible !
- Dieu peut faire que l'impossible
devienne possible, dit-elle simplement. Il prendra
soin de moi et des enfants.
Et elle expliquait :
« Janie est déjà grandette
et m'aide beaucoup ; Mary a cinq ans et se
tire d'affaire toute seule ; Alice a trois ans
et est une petite débrouillarde, et Maggie,
qui n'a que seize mois, se tient assise et s'amuse
d'un rien ». C'est ainsi que, comme
toujours, elle aplanissait des difficultés
qui pour tout autre eussent paru
insurmontables !
Restait la question des
vêtements.
-Avez-vous le nécessaire ?
demandait-on à Ma.
- Nous ne possédons que ce que
nous avons sur le dos ; les fourmis ont tout
abîmé pendant ma maladie. Mais
là encore le Seigneur pourvoira.
« Qu'il te soit fait selon ta
foi », dit Jésus. Lorsque Ma et
son quatuor arrivèrent à Duke Town,
elles y trouvèrent une caisse qui venait
d'arriver de Glasgow à l'adresse de Ma, et
qui contenait exactement tout ce dont les
voyageuses avaient besoin. En remerciant les
donateurs, Ma leur écrivit qu'elle
espérait qu'ils ne seraient pas vexés
de l'emploi qu'elle avait fait de leurs cadeaux,
car vraiment, leur dit-elle, tout sera
employé pour le service du Christ, comme si
les vêtements avaient été
distribués dans l'Okoyong.
On était alors en 1898. Le voyage
fut des plus faciles. La bonté de chacun
enveloppait Ma comme un chaud rayon de soleil.
À l'arrivée à Liverpool, elle
remit son porte-monnaie à un employé
du chemin de fer en le priant de
lui procurer les billets pour le train.
L'employé, vivement intéressé
comme tous les spectateurs par cette femme blanche
entourée de quatre petites négresses,
se hâta de prendre les billets et d'installer
confortablement les voyageuses dans le train pour
Edimbourg. À Edimbourg une vieille amie de
Ma l'attendait sur le quai, et emmena toute la
bande chez elle.
« Est-ce que Dieu n'est pas
bon pour nous ? » demandait souvent
Ma avec un joyeux sourire.
Naturellement tout le monde ouvrait de
grands yeux à l'apparition des petites
négresses, mais tout le monde les traitait
avec bonté, surtout ceux qui apprenaient
leur triste histoire Janie seule savait quelques
mots d'anglais, mais toutes ces fillettes
étaient intelligentes et eurent
bientôt fait de comprendre ce qui se disait
autour d'elles. Mary fut même envoyée
à l'école.
Après un séjour chez sa
vieille amie, Ma crut préférable de
louer une petite maison au bord de la mer et d'y
vivre comme en Afrique, Janie faisant la cuisine et
Ma se promenant partout nu-tête et pieds nus.
Mais vivre en Écosse comme on vit sous les
tropiques n'est pas chose si aisée que Ma se
l'imaginait, et on la trouvait souvent grelottant
auprès d'un grand feu ! Ce que voyant,
une autre amie de Ma imposa sa douce volonté
et emmena toute la maisonnée dans un joli
village en pleine campagne, où l'on passa
juillet et août.
Ma dut cependant quitter cette demeure
de paix pour aller parler à des
réunions missionnaires. Sa
réputation s'était
encore accrue depuis son précédent
séjour en Écosse et chacun
était impatient de voir et d'entendre cette
étonnante femme-pionnière qui vivait
seule au milieu des sauvages.
Mais Ma était restée
timide ; en particulier elle refusait
énergiquement de parler en public du moment
que le sexe fort était
représenté. Et si on se permettait de
faire son éloge, elle se sauvait tout
simplement ! Elle ne se mettait jamais en
scène : c'est de l'oeuvre qu'elle
parlait, et des besoins de cette oeuvre qu'elle
n'appelait jamais sienne.
On obtint qu'elle prît la parole
dans une grande assemblée à
Edimbourg. Comme de coutume, elle parla très
bien. Quelques étudiants en théologie
se glissèrent sans bruit sous une tribune
pour l'écouter ; elle ne sembla pas y
faire attention, mais tout à coup,
s'adressant à eux directement, elle leur
dit : « Il y a ici beaucoup
d'étudiants qui sont prêts à
servir Jésus ou qui se préparent
à le faire. D'ici peu, ils se mettront
à la recherche de belles églises et
de confortables presbytères, alors que
là-bas il y a des multitudes qui n'ont
jamais entendu parler de leur Sauveur. Pour l'amour
de Dieu ne veulent-ils pas venir là-bas
travailler en son nom ? »
Souvent elle parlait des bienfaits de la
prière. « Si vous vous sentez tout
à coup poussé à prier pour tel
ou tel missionnaire, disait-elle, faites-le tout de
suite, où que vous soyez. Peut-être
que celui ou celle pour qui vous priez est à
ce moment précis en grand danger. Une fois
que j'avais à faire à une foule
d'hommes armés réunis dans un enclos,
je sentis qu'une force
m'était donnée pour leur tenir
tête en réponse à la
prière de quelqu'un. »
À une autre réunion,
s'adressant aux jeunes, elle leur dit comment se
reconnaissent les gens bien élevés et
comme il faut : « Ce n'est pas,
dit-elle, parce qu'ils portent de beaux habits ou
possèdent de grandes richesses, mais c'est
parce qu'ils ont des manières affables et de
la considération pour les autres. Ce n'est
pas parce qu'ils donnent leur argent ou se privent
d'un peu de luxe pour hâter la venue du
Royaume de Dieu, mais c'est parce que, chaque jour
et de bon coeur, ils renoncent à
eux-mêmes en faveur des autres, de ceux qui
sont près et de ceux qui sont
loin ».
C'est avec les enfants qu'elle
était le plus à son aise ; et,
lorsqu'elle entourait avec eux la table à
thé, ou qu'elle s'asseyait par terre devant
le feu en bonne compagnie, elle se surpassait. Elle
leur racontait quelque terrible histoire qui les
faisait trembler, - histoire vraie de ce qui lui
était personnellement arrivé dans
l'Okoyong. « 0 Maman, demandaient ces
chéris lorsque leur mère les bordait
le soir dans leurs lits, comment miss Slessor
peut-elle vivre comme cela, toute seule avec ces
sauvages, et les bêtes féroces si
près ? »
« Ah ! répondait
la maman tout doucement, elle le fait parce qu'elle
aime Jésus et veut le servir. Je me demande
si toi tu aimerais ton Sauveur à ce
point-là ? »
Et les petits cerveaux des jolies
petites têtes enfoncées dans les doux
oreillers se le demandaient aussi...
Ma était également un
problème pour les grandes personnes, car on
voyait bien qu'elle était non seulement
timide, mais craintive. Ainsi jamais elle n'aurait
traversé un champ dans lequel passait une
vache ! Elle n'osait pas traverser une rue
seule, et n'arrêtait pas un omnibus en
marche : elle n'y montait que s'il
s'arrêtait par hasard pour un autre
voyageur ! Elle tremblait dans un petit bateau
ou dans une voiture qui allait vite. Qu'aurait-elle
donc éprouvé dans une auto faisant du
60 à l'heure !
Pourquoi donc les choses
l'effrayaient-elles à ce point ? Parce
que tout cela ne concernait qu'elle
personnellement. Lorsqu'il ne s'agissait pas
d'elle-même, que le danger était pour
les autres et qu'elle devait défendre et
protéger ceux-ci, alors elle s'oubliait
absolument, ne pensant qu'à ce qu'il y avait
à faire ; elle se montrait alors brave
et forte comme peu d'hommes le sont. Volontiers
elle se serait sacrifiée pour les autres au
service de Jésus.
Ma avait compté que son absence
durerait un an ; mais, lorsque vint l'hiver
d'Écosse avec son ciel gris, son froid
pénétrant et ses pluies
perpétuelles, elle et ses fillettes eurent
faim et soif du soleil et de la chaleur de
l'Afrique. Et puis, comme vous le devinez bien, Ma
pensait toujours à l'Okoyong et à
l'oeuvre qui l'y attendait. Aux amis qui
tâchaient de la décider à
rester en Écosse plus longtemps elle
répondait : « Si vous ne me
laissez pas partir, j'irai là-bas à
la nage. Pensez à tous ceux qui meurent sans
connaître Jésus ».
Elle et ses fillettes se remirent donc
en route et passèrent sur mer la Noël
de 1898. Quelle réception les attendait
à Akpap ! Quelle bienvenue elles
reçurent ! « Tout ira bien
maintenant puisque Ma est de
retour ! » disaient les
indigènes ! La souveraine de l'Okoyong
avait repris son sceptre.
Mais les trois années qui
suivirent furent les plus solitaires, les plus
arides que Ma eût encore connues. La Mission,
qui avait espéré lui envoyer une
aide, ne put le faire ; elle-même fut
empêchée d'aller une seule fois au
Calabar, et elle reçut fort peu de visites
des autres missionnaires. De plus, elle avait
à lutter sans trêve contre sa mauvaise
santé ; pour elle, pas un jour ne se
passait sans souffrance ; elle avait de
longues nuits d'insomnie, et de violents
accès de fièvre qui la laissaient
presque mourante. Représentez-vous ce que
cela devait être pour elle de n'avoir
personne d'autre pour la soigner que ses fillettes
noires. Pourtant, jamais elle ne se laissait aller
à la mélancolie. Son indomptable
énergie l'aidait à tenir tête
à la faiblesse envahissante ;
dès qu'elle le pouvait, elle faisait un
effort pour se remettre au travail en souriant et
d'un coeur vaillant.
Comme toujours, il s'agissait d'aller en
toute hâte arracher des jumeaux à la
mort, ou de s'occuper de petits orphelins, ou
encore de se rendre à quelque village pour y
lutter contre l'ivrognerie, sans parler du travail
sur la station même. La maison missionnaire
était maintenant bâtie, - rien de bien
confortable, vous pouvez m'en croire, - mais enfin
une maison « avec un
étage ». Grand
luxe, vous le voyez ! Le
bas de la maison servait d'école,
d'église et de lieu de réunion. Ma y
tenait le culte du dimanche et les classes
bibliques.
De plus, elle avait à
présider les séances du tribunal,
à assister aux palabres, à s'occuper
du dispensaire, à faire des
réparations, etc. etc. Elle était si
absorbée qu'il pouvait lui arriver d'oublier
à quel jour de la semaine on en
était. Une fois elle célébra
les services le lundi, croyant être au
dimanche, et une autre fois on la trouva
réparant son toit un dimanche alors que les
services avaient eu lieu la veille !
Ma tenait les rênes du
gouvernement d'une main à la fois ferme et
douce. Les années écoulées
l'avaient tant soit peu changée, en ce sens
qu'elle comprenait maintenant la
nécessité de se montrer parfois
sévère avec les indigènes, et
qu'elle leur parlait souvent comme un homme
n'aurait jamais osé le faire. Quiconque
comparaissait devant son tribunal pour avoir
maltraité une femme était
sévèrement puni ; et si un chef
se permettait d'être d'un autre avis que le
sien, ôtant une des pantoufles qui faisaient
partie de son costume
« officiel », elle en frappait
le rebelle sur son épaule nue !
Jamais elle n'avait peur de ces
gens ; de nuit et de jour elle circulait sans
armes parmi eux ; les portes de sa maison
n'étaient pas fermées à clef.
Un jour que la foule s'était saisie d'un
meurtrier et l'avait presque écartelé
avant de le lui amener, elle écouta
l'accusation, puis décida d'envoyer le
prisonnier au tribunal de Duke Town. Alors,
renvoyant ceux qui le gardaient, elle lui enleva
ses chaînes, le fit entrer
dans la maison missionnaire, s'assit, et parla
longuement et sérieusement à ce
meurtrier. L'homme, grand, violent, sombre,
n'aurait pas eu grand'peine à la renverser
d'un coup de poing et à se sauver dans la
forêt ; mais il écouta en silence
ce qu'elle lui disait et se laissa conduire dans
une chambre où elle l'enferma le reste de la
nuit.
Pendant les longues années
qu'elle passa dans l'Okoyong, on ne lui fit mal
qu'une seule fois et ce fut par accident :
elle voulut séparer de force deux
combattants et, dans la bagarre, le bâton de
l'un d'eux la frappa. Un cri d'horreur
retentit.
« Ma est blessée !
Notre Ma est
blessée ! »
Des deux camps on se rua sur le
malheureux homme qui tenait encore son bâton,
et on le mit dans un état pitoyable.
« Arrêtez-vous !
Arrêtez-vous ! criait Ma. Il n'avait pas
eu l'intention de me frapper. »
Usant de toute sa force, elle fit
reculer les agresseurs et arracha de leurs mains
l'homme presque mort.
Ainsi, une à une, les
années s'écoulèrent et l'aube
de 1900 se leva. « Un siècle
nouveau, dit Ma d'un air rêveur.
Qu'apportera-t-il ? Qu'il nous suffise de
savoir que la bonté du Seigneur ne nous fera
jamais défaut. »
Il y avait maintenant quinze ans que Ma
était arrivée dans l'Okoyong, et elle
n'avait pas perdu sa récompense. Non
seulement les vieilles coutumes païennes
avaient presque entièrement disparu
et le pays était en
pleine paix, mais le nombre des disciples de
Jésus augmentait de plus en plus.
En août 1903 l'Eglise fut
fondée, et sept jeunes chrétiens
reçurent le baptême en présence
d'une grande assemblée. Le lendemain, onze
des « enfants » de Ma furent
aussi baptisés, et ce même jour, -
splendide journée de dimanche, - les
chrétiens se réunirent pour la
première fois autour de la Table du
Seigneur.
Ma, profondément émue,
écouta les larmes aux yeux le chant, en
efik, du psaume CIII. Elle aussi pouvait
dire : « Mon âme, bénis
l'Éternel ».
« Rappelez-vous, dit-elle aux jeunes
chrétiens membres de la jeune Église,
que maintenant c'est à vous qu'on regardera
et non à moi, pour juger de ce qu'est la
puissance de l'Évangile. »
A elle seule, Ma avait mené
à bonne fin, dans l'Okoyong, le travail pour
lequel, au Calabar, il avait fallu le nombreux
personnel de la Mission. Mais jamais elle
n'acceptait qu'on lui en fît honneur ;
elle n'était, disait-elle, que l'instrument
dont le Seigneur se servait pour manifester son
pouvoir. Lui était le Roi de
l'Okoyong ; elle n'était que son humble
servante.
|