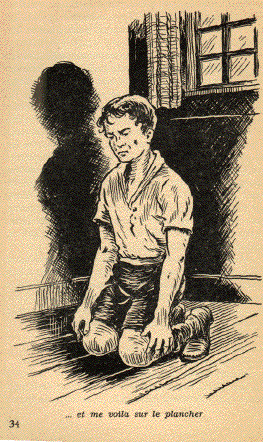La Grande Soif
CHAPITRE
TROISIÈME
La liberté! Le plus
beau mot d'une langue.
Revoici les rues que
j'ai si souvent arpentées, la
cathédrale et sa tour magnifique, la maison
où tout est à la même place: le
lit, la cheminée au centre d'un mur, le
buffet où j'avais dérobé la
fiole fatale, la vieille horloge, la table des
repas, les chaises, mais sans traces de boue depuis
que je ne suis plus là pour monter dessus
afin d'atteindre la bouteille
d'eau-de-vie.
Papa Léon,
heureux de me revoir, a pourtant l'air soucieux.
Pendant le repas, il se met à parler,
à parler.
Un vrai discours
!
- Gosse, j'en ai des
nouvelles à t'annoncer! L'inspecteur de
l'assistance publique a fait une enquête,
qu'il dit, cet homme-là ! Il paraît
qu'on t'élève de travers, qu'on te
pousse à la boisson. En v'la des mensonges!
Tu travailles avec moi, avec les ouvriers, et quand
tu as soif, tu fais comme tout le monde, tu bois un
coup. Au café, tu m'accompagnes gentiment.
On ne t'y donne que ce qui convient à ton
âge. Mais les bigots ! Les bigotes! Ah! les
mâtines, toujours prêtes à
remuer la langue, à mentir... Il y a plus,
il y a mieux : on te reveut à
l'école, chez M. Robert. Si ce n'est pas une
indignité d'obliger des parents nourriciers
à élever un orphelin et à s'en
priver en le fourrant dans une école ? On se
saigne aux quatre veines, on vit de privations.
Pour ce que l'assistance publique nous donne, pour
l'emporter, pas besoin d'une charrette! La
moitié des métayers, plus riches que
nous : des fermes, du gros bétail, des
poules, des oies, des canards, des oeufs tant et
plus, du beurre, des légumes, des tas de
trucs à vendre. Est-ce qu'ils envoient leurs
gosses à l'école ?
Dégoûtant, ça! Nous, on se tue
de travail, on achète tout. Moi, si tu vas
en classe, je reste seul à gagner. Et quoi?
trois francs la journée, l'hiver deux
cinquante. Quand le travail manque, on mange quand
même en se serrant la ceinture. L'instruction
? Du luxe. Pour les riches. À quoi ça
sert ? Quand on a étudié, comme moi,
on est amené à voir mieux que les
ignorants les injustices, à ruminer sa
misère. Belle avance! On est plus
malheureux, cent fois, que ceux qui ne savent rien,
ignorent même les lettres de l'alphabet...
Enfin, contre la force pas de résistance.
À l'école tu iras, puisqu'il le faut.
On verra ce que ça donne !
Avec plaisir je
retourne en classe. J'ai un grand désir
d'apprendre, de m'instruire. Mais quel bougillon,
quel indiscipliné! Sans cesse, pendant les
leçons, je chuchote avec mes camarades, je
leur joue des tours, sans trop me soucier des
rappels à l'ordre. Pendant les
récréations, je griffonne aux murs
des figures grotesques, inscrivant au-dessous le
nom du maître ; je tourne à l'envers
les cartes de géographie ; je barbouille les
carreaux au blanc d'espagne... Les punitions
pleuvent : retenue en classe, au pain sec,
obligation de tendre une main, tous doigts
réunis, pour recevoir de solides coups de la
baguette... que je casse en menus morceaux quand,
j'en ai l'occasion. Certaine fois, après un
tour plus pendable que les autres, le
sous-maître, excédé, bondit sur
moi. Au lieu de fuir, je fais face,
j'égratigne, je mords, Une gifle me fait
chanceler. Hors de moi, je saisis un encrier et
l'expédie, avec son contenu qui ruisselle,
à la figure de mon agresseur. Alors quels
rires! Les grands de la classe crient: Bravo!
Vas-y! À un coup de poing, je riposte par un
coup de pied... Alors galopade autour des bancs.
Vivement, je grimpe sur l'un d'eux et, par la
fenêtre ouverte, saute dans la cour. Le
maître s'élance à ma poursuite,
hué par les galopins que ce jeu de chat et
de la souris enchante… À toute allure, je
gagne la rue, traverse en vitesse toute la ville et
me réfugie à la maison où,
mise au courant, ma mère adoptive me
gronde.
- Retourne à
l'école et demande pardon.
- Non! Le
maître, je le déteste. Quand je serai
grand, je lui en distribuerai des coups
!
Papa Léon,
bien sûr, me donne raison.
- T'as bien fait !
c'est lui qui a commencé! La loi Grammont
protège les animaux, mais quand on assomme
un gosse, personne n'intervient. Reste à la
maison. Il y a du travail pour toi. Un peu de
galette fera bien dans le paysage!
Dès le
lendemain, j'accompagne papa Léon. Il y en
a, du bois à couper. Et bien sûr, de
temps en temps, une tournée de goutte; le
travail achevé, une séance au
café. Ça me plaît. Pour faire
l'homme, j'avale rasade sur rasade. Un ouvrier de
notre équipe raconte que le tabac, quand on
le prise, « dégage le cerveau ».
Et je me mets à priser, éternuant
tant et plus, mais tant pis, puisque ça
dégage le cerveau ; et je chique. À
onze ans, c'est épatant! je suis ce qu'on
appelle un émancipé. Et, bien
sûr, je recommence à acheter de
l'eau-de-vie que je cache dans le grenier, buvant
et fumant, fumant et buvant.
Mis au courant par le
directeur de l'école, un inspecteur de
l'assistance publique vient à la maison, Il
blâme ma mère adoptive, il menace de
me retirer de chez elle pour me confier à
l'asile. Dès que cet inspecteur a
tourné le dos, papa Léon me monte la
tête.
- T'as raison, mon
p'tit gas ! Tiens bon ! Je vas leur écrire
ce que je pense.
Un mois se passe. Et
voici un agent de police. Second avertissement.
Moi, je pleure. Souvent je rencontre les orphelins
de l'Hospice en promenade, deux à deux.
Alors j'aurais moi aussi un sombre uniforme, on me
surveillerait, me tancerait, m'empêcherait de
boire café, cidre ou eau-de-vie ? Tout,
plutôt que ça! Plutôt mourir que
de perdre sa liberté !
De nouveau un agent
de police. Le commissaire m'attend, le lendemain,
à neuf heures. Accompagné par ma
mère adoptive, me voici au poste où
un employé de l'Assistance doit prendre
livraison de ma personne... Larmes,
gémissements, supplications, tout est
inutile. J'embrasse ma mère adoptive,
victime comme moi (mais je n'en crois rien,
à cet instant), du papa Léon et je
suis le fonctionnaire, le coeur gros,
hérissé, prêt à la
vengeance.
Rue Saint-Jean, un
énorme bâtiment ceinturé de
hauts murs sales. La cloche retentit, le portail
s'ouvre. Une voûte. Une cour immense,
planté de platanes. Le bureau de la
supérieure, la Mère de Starnor, aux
cheveux blancs. Elle me parle très
gentiment, et m'assure que, si je suis sage, tout
ira bien... Obéir, se soumettre... Je ne
réponds pas un mot. On ne me gardera pas
longtemps en cage. Je ne suis pas fait pour, vivre
derrière des murs!
Encore une cour, des
bâtiments tristes, un escalier. On me pousse
dans une grande salle, garnie de bancs, sur
lesquels des enfants sont assis, qui tricotent des
chaussettes, des chandails. De côté,
près des fenêtres, deux petites tables
où travaillent une femme et le tailleur de
la maison. Près de la porte, une table plus
grande, d'où soeur Louise, grande, maigre,
sèche, surveille chacun. Une croix
gigantesque, sur laquelle le Christ est
cloué, domine la salle.
À ma vue,
soeur Louise se dresse de toute sa hauteur. Elle
m'interroge d'une voix cassante. Nous serons
ennemis, c'est sûr! Dix minutes après,
je suis conduit dans une salle de bains, où
le baigneur me fait asseoir sur une chaise basse et
se met en devoir de couper la chevelure noire et
frisée dont je suis si fier. Je regimbe.
J'éloigne ma tête de la froide
tondeuse. Inutile ! Le règlement est pour
tous. « Tu seras tondu ras, mon bonhomme !
» Pendant que je patauge dans le bain, on
emporte mes vêtements. À leur place,
on me met la livrée de la maison dont la
pièce essentielle est une blouse à
carreaux. Me voilà
enrégimenté, numéroté,
classé orphelin!... Mon esprit est en feu.
Pour l'instant, je me laisse faire. Mais je suis un
enfant de la liberté, moi! Me soumettre ?
Jamais!... On ne m'y verra pas longtemps dans cette
boîte...
Honteux, j'apparais
dans la salle où l'on tricote. Mes camarades
me regardent avec curiosité ! Mais, pour
l'instant, le silence est de rigueur. Soeur Louise
m'interpelle.
- Arrive ici, Paul.
Sais-tu tricoter
- Non
!
- Ça ne
m'étonne pas. On t'apprendra.
Alors, sur deux
aiguilles, elle monte une douzaine de mailles,
m'explique comment je dois m'y prendre pour
fabriquer des jarretières. Moi, j'ai mon
idée. On ne me mettra jamais à ce
travail de fille, et je sabote consciencieusement
les jarretières à naître,
laissant tomber les mailles. Soeur Louise m'appelle
près d'elle, m'enseigne encore la
façon dont il faut s'y prendre. C'est pire
qu'avant. Vlan! une chiquenaude sur la main. «
Tu le fais exprès? » Mes yeux
répondent oui. Vlan! une gifle. J'encaisse,
mais la guerre est déclarée. Je sais
que les indisciplinés sont fouettés.
Ça, par exemple, on verra!
Une heure plus tard,
devant l'embrouillamini de mon travail, une
deuxième gifle part à mon adresse.
Instantanément, j'expédie tricot,
laine, aiguilles au fond de la
salle.
- À genoux!
- Non
!
- À
genoux!
Soeur Louise me
saisit aux poignets. je l'égratigne, je fais
sauter les agrafes de sa jupe. Le tailleur,
surnommé « petit père »,
accourt, mais je me couche sur le plancher, me
débats, mords la main du « petit
père » et lui casse ses lunettes sur le
nez. Chose extraordinaire, il ne réagit pas,
il ne tente même pas de me frapper. Dans la
suite, il ne se vengera qu'en étant
très bon pour moi. Je crie :
- Tuez-moi, mais je
ne me mettrai pas à genoux!
Soeur Louise
s'éloigne pour aller changer de jupe.
Revenue, elle m'ordonne de la suivre jusque chez
Madame la Supérieure, qui me raisonne avec
douceur et fermeté :
- Pour cette fois, tu
n'iras pas à la chambre noire. Mais il faut
une discipline! Tu te mettras à genoux, les
mains sous les genoux, pendant un quart d'heure. Va
et obéis !
Effrayé par ma
révolte ou ruminant déjà
quelque projet d'évasion, j'obéis. Et
me voilà sur le
plancher, les mains
aux genoux. Ça fait mal. je mets ma
fierté à n'en rien laisser voir.
L'heure sonne à l'horloge de l'hospice.
Aussitôt soeur Louise fait une courte
prière à haute voix. Je ne m'y
associe pas. Je pense à soeur
Saint-Arsène avec amitié, avec
tendresse. Je pense aussi à papa
Léon, à ses perpétuelles
malédictions contre les dévotes et
j'oublie soeur Saint-Arsène pour concentrer
ma haine sur soeur Louise. Parler d'amour, de
pardon, de pitié, et envoyer des gifles pour
un oui, pour un non ! Mes torts, je ne veux pas les
voir. Cette femme qui prie m'a giflé par
deux fois ! Une véritable aversion pour ce
qui est religieux s'empare de moi. Papa
Léon, tu connais le monde! Ah! si tu me
voyais en cet instant, agenouillé sur ce
plancher !
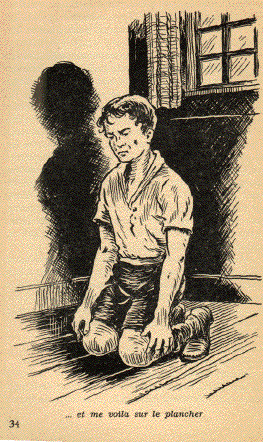
Mes camarades m'admirent.
Eux, dociles, subissent gifles et coups de
martinet, mais ils sont fiers que l'un d'eux, au
moins, tienne tête. Ils m'enseignent à
faire les mailles à l'endroit, à
l'envers, toutes sortes de tricots. Je m'en tire
très bien, mais sabote tout ce que j'apporte
à soeur Louise, que je persiste à
appeler Madame.
- Dis: ma soeur.
- Non Madame.
- Dis : ma soeur.
- Vous n'êtes
pas ma soeur.
Une gifle !
J'empoigne le fer à repasser de « petit
père », plein de tisons
enflammés, et le lance de toutes mes forces
sur soeur Louise qui le reçoit en pleine
poitrine, soudain pâle et tremblante. On me
conduit aussitôt chez la soeur
Supérieure qui, pour prix de ma
méchanceté, de mon indiscipline, de
ma violence m'inflige huit jours de cachot
souterrain, vers lequel le robuste infirmier d'If,
figure sévère, grosse moustache,
forte voix, me dirige sans tarder, faisant tinter
un impressionnant trousseau de clefs. Nous
traversons le grand jardin, franchissons une porte
épaisse donnant accès à un
couloir humide et sombre. C'est là. Bruit
grinçant de verrous, tours de clef
par-dessus le marché. Une fenêtre
percée au ras du sol laisse filtrer un peu
de lumière. À cinquante
centimètres du plancher, une sorte de lit
massif, en chêne, scellé dans le
ciment et garni de paille humide. Autour, six
anneaux de fer. Un pâle rayon de soleil joue
sur un mur lépreux. Du poing, je frappe ce
mur. je secoue les anneaux. Pleurant à
chaudes larmes, je m'assieds sur ce lit
destiné sans doute à recevoir de
pauvres fous en état de crise. La
pensée que j'ai eue tort, que je me suis
conduit comme une petite brute, n'effleure pas mon
esprit. Vengeance! Vengeance ! Papa Léon, au
secours !
Après des
heures, - je sanglote toujours - un bruit de pas.
Une ombre glisse devant la fenêtre du
souterrain. Les pas, maintenant, sonnent sur les
dalles du corridor. La clef grince, les verrous
sont tirés. L'infirmier à grosse
moustache me regarde avec
pitié.
- Pas drôle,
hein ? On s'ennuie. Voilà de la paille
fraîche, deux couvertures. Tu n'auras pas
froid. Et pas faim. On t'apportera de la
nourriture... Allons, assez pleuré. Huit
jours, ça passe encore vite.
Ah, non ! ils ne
passent pas vite. Les nuits, oui. je dors tant je
suis dégoûté, irrité.
Mais les jours n'en finissent pas. Empoignant les
barreaux de fer, je me hisse jusqu'à la
fenêtre qui me montre un mur, au sommet de ce
mur une barre de ciel où jouent des rayons.
Je sais ce qu'ils éclairent, ces rayons,
quand on m'apporte le repas de midi que j'attends
à coup sûr, suivant des yeux le lent
glissement de la lumière dorée sur la
crête du mur.
Le guichet s'ouvre.
L'aumônier m'appelle. Il me parle longuement,
gentiment, me prodigue de bons conseils que
j'écoute sans
répondre.
- Aimes-tu lire
?
- Oui. Je voudrais
mon livre d'histoire. Il est dans mon
sac.
Peu après,
tapi dans le coin le plus clair de la cellule, je
dévore le récit des combats de nos
ancêtres. Vercingétorix! Duguesclin!
Tant d'autres. Je me compare à ces hommes de
guerre. Mon imagination travaille. Moi aussi, je
suis un héros, captif comme ce
Vercingétorix, prisonnier de Rome, comme ce
Duguesclin, prisonnier des Anglais. Ils ont
souffert pour une grande cause. Moi aussi ! Ne
m'a-t-on pas injustement frappé ? Ce livre,
sitôt terminé, je le recommence. Et
les jours s'égrènent.
Une dernière
fois, les verrous sont tirés.
- Fini, ami Paul.
Souviens-toi de la leçon. Ne reviens jamais
ici. Crois-tu que c'est amusant, pour moi,
d'apporter trois fois par jour des repas à
un gosse ? Allez, viens !
Je trotte
derrière le gros infirmier jusque chez
Madame la Supérieure. Elle me parle de la
discipline qui doit régner dans un grand
établissement. À quoi irait-on, sans
elle ? « Même si tu ne le crois pas, on
ne veut que ton bien. La preuve ? Dès
demain, tu retourneras dans ta classe avec une
douzaine de tes camarades d'ici. Tu aimes
l'étude ? Eh bien ! travaille et tu auras ta
récompense. »
Retourner à
l'école, quelle joie ! Mais quelle tristesse
de porter l'uniforme des enfants assistés!
Il me semble que c'est un déshonneur
d'être présenté à tout
le monde comme un orphelin, un sans-famille. De
nouveau cette pensée me travaille, me
tenaille. Sauve-toi ! Décampe! Va là
où l'on est libre, là où l'on
peut boire quand on veut !Car la passion de
l'alcool me tient fidèle compagnie. Le petit
pot est pour moi l'emblème de la
liberté, le signe du bonheur. Sauve-toi
!
Pendant trois mois,
sagement, je fréquente l'école,
toujours accompagné par mon projet de fuite.
Un jour, je n'y tiens plus. Comme nous trottinons
en colonne, dans le petit matin, entre l'hospice et
l'école, je jette brusquement mon sac
d'écolier sur le trottoir et file à
toutes jambes laissant bouche ouverte la brave
femme qui nous conduit. Dix minutes après,
je franchis, essoufflé, le seuil de la
maison où ma mère adoptive m'embrasse
avant de lever les bras en l'air de
stupéfaction.
- À quoi
penses-tu ? Ils vont te chercher, t'emmener.
Retournes-y !
- Non! je n'y
retournerai pas. Non ! Non!
Je déjeune. Je
bois deux grandes tasses de cidre. À midi,
voici papa Léon.
- Toi, ici ! Je ne
peux plus rien pour toi. Est-ce que je suis le
maître ? Ils sont plus forts que nous. Enfin,
j'irai voir le président du tribunal, je lui
expliquerai... On verra ce qu'on peut
faire...
Vers le milieu de
l'après-midi, un agent de police. je tremble
comme une feuille. Une fois encore j'embrasse ma
mère adoptive. En route! De nouveau la porte
maudite, la voûte de l'hospice, le cabinet de
Madame la Supérieure.
- Pauvre enfant !
À quoi penses-tu donc? Crois-tu qu'on peut
toujours n'en faire qu'à sa tête ?
À onze ans !... je suis obligé de te
punir. Combien de temps vas-tu rester au cachot? je
n'en sais rien. L'inspecteur des enfants
assistés, à Caen, est averti. C'est
lui qui décidera...
Hochant la
tête, l'infirmier d'If me reconduit dans le
cachot souterrain, marmonnant :
- Si c'est pas
malheureux...
Et je reprends mes
stations, accroché aux barreaux de la
fenêtre, à surveiller la marche du
soleil en bordure du grand mur. Au soir du
huitième jour, l'économe de l'hospice
vient me voir. Encore huit jours ! Délit de
fuite, c'est grave, ça.
Après, quelle
colère, quel accès de rage Dès
que je le pourrai je me sauverai encore, loin, si
loin qu'on ne pourra pas me retrouver. On verra
bien ! Dans cette lutte, je serai
vainqueur!
Enfin le bruit
libérateur des verrous tirés.
L'infirmier à grosses moustaches
sourit.
- Une bonne nouvelle!
Seulement, faudra être raisonnable. Tu restes
à l'infirmerie avec moi. je serai ton
patron. Tu m'aideras en brave garçon. Tu ne
me feras pas de misères, hein ? On
constituera un bon ménage.
Oui, c'est une bonne
nouvelle! J'aime les malades... L'infirmier me met
au courant de tout. je dois balayer, laver,
chercher la nourriture des pensionnaires, les
médicaments, rendre de menus services. Il y
a là surtout des vieillards, tous
assistés, qui ont de la peine à se
traîner le long du couloir qui relie
l'infirmerie au fumoir. Plusieurs ne quittent pas
le lit. Je fais tout ce que je peux pour contenter
ces vieux. La religieuse de service est bonne,
souriante, toujours prête à
répondre à d'incessants appels. Je
l'appelle ma soeur avec joie. Je n'ai guère
le temps d'établir une comparaison entre
elle et soeur Louise, car la mort emporte celle
à qui j'avais tenu tête.
Peut-être était-elle impatiente,
colérique, parce qu'elle était
gravement malade ? Je suis ému. Je regrette
un peu d'avoir été si méchant
pour elle... Peu après, Madame la
Supérieure meurt à son tour... Mme de
Thiergaumont lui succède. Grande, forte,
elle est sévère mais très
juste.
En somme, pendant
quelques mois, je suis heureux dans cette
infirmerie, d'autant plus heureux qu'en cachette,
j'arrive à me procurer un peu de cette
eau-de-vie sans laquelle il n'est plus pour moi de
vrai bonheur. Pas assez, pourtant, à mon
gré. Pour boire à volonté, il
me faut reconquérir ma liberté
complète. La liberté ! La
liberté ! Ce mot chante sans cesse dans ma
tête, dans mon coeur.
Certain dimanche,
quatre camarades et moi décidons de
décamper au cours d'une promenade. Profitant
d'un jeu qui a dispersé notre troupe en
pleine campagne, nous détalons soudain.
Où aller ? Mes camarades décident de
se rendre chez la mère nourrice de l'un
d'eux, à Caen. Une vraie souricière !
Je connais ça. Je pars de mon
côté... Le lendemain matin, au saut du
lit - je l'appris plus tard - mes compagnons de
fuite sont « cueillis ». Moi, pendant
trois jours, je marche, marche, demandant ici et
là si l'on peut m'occuper. Une ferme
isolée m'embauche. Pendant. neuf jours, je
travaille de mon mieux. Au matin du dixième,
un domestique me hèle aux champs. «
Eh!... On t'attend à la maison. » je
m'y rends sans défiance, pousse la porte de
la cuisine et tombe dans les bras de deux
gendarmes. Tête basse je les suis
jusqu'à Caen où je retrouve, à
la prison, mes camarades... De là,
l'hospice, le bureau de la Supérieure.
Trente jours de cachot aux plus âgés.
Pour moi, quinze. je commence à en avoir
l'habitude... Ma peine terminée, on
m'annonce la décision prise : on va me
placer dans une ferme. Conduit à la halle
où on loue les domestiques, je suis
embauché par un propriétaire qui
m'emmène en voiture jusqu'à sa ferme.
Ce propriétaire - je n'ai pas trop le droit
de le blâmer - est un sac à vin et
à eau-de-vie. Il lui arrive de rentrer ivre,
le soir, vers le minuit. Tempêtant, jurant,
il réveille ses deux domestiques, un autre
gamin et moi
- Allez nourrir les
chevaux !
Il y a en vingt. Si
nous avons quelque peine à nous
éveiller, quelques coups de fouet nous
tirent de notre léthargie.
Je vis de tristes
jours dans cette ferme. C'est l'hiver; il fait
humide et froid. Conduire trois chevaux aux
labours, les mains crispées sur les guides
et le fouet glacés, tandis que le patron,
à moitié ivre, distribue des coups de
pied parce que le travail n'avance pas vite, une
besogne qu'on n'oublie pas ! Le maître, de
temps à autre, va s'abreuver à la
bouteille d'eau-de-vie cachée dans un
sillon. Il lui arrive de tomber et de s'endormir
sur la terre mouillée. Alors c'est moi qui
termine la bouteille. Part à deux ! Il
arrive aussi que l'ivrogne, rentrant tard,
après une partie de bamboche, insulte sa
femme, la tire hors du lit par les cheveux et la
traîne dans la chambre. Ne nous
étonnons pas si j'ai retrouvé cet
homme, bien des années plus tard, devenu le
domestique d'un entrepreneur de transports. Il
avait tout bu, si l'on peut dire, ses terres, son
bétail, sa fortune... Tout ça aurait
dû m'ouvrir les yeux. Mais quand on est
soi-même possédé par le
démon !
Bref, le travail
à la ferme est trop dur pour le gosse que je
suis. Un jour, on me ramène à
l'hospice où je reprends ma place à
l'infirmerie des vieillards. Pas pour longtemps,
comme on va voir...
|