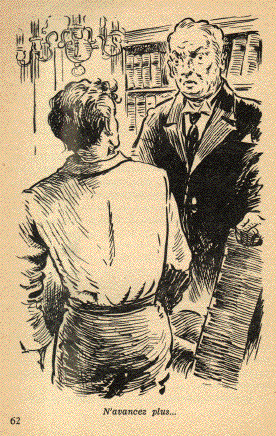La Grande Soif
CHAPITRE
CINQUIÈME
Voici la grande école.
De chaque côté de l'entrée
principale, une haute colonne de pierre porte ces
mots : «Colonie agricole et industrielle de
Sainte-Foy-la-Grande». Une allée
bordée de hauts platanes conduit à
une cour immense bordée par les
bâtiments où vivent les colons et par
le pavillon des services centraux et des
bureaux.
Le directeur me
reçoit. Ayant compulsé un dossier, il
me pose diverses questions. Enfin : « Si tu
veux être heureux, Paul, ici, il s'agit
d'obéir. C'est la règle absolue. Et
ne pas chercher à s'évader.
Défendu de boire et de fumer. La moindre
faute est punie sévèrement. Vous
pouvez disposer. »
Ces derniers mots
s'adressent au surveillant. On me livre au
coiffeur. Adieu mes belles boucles. Mon crâne
est tondu à ras... Pendant la douche, on
m'enlève mes habits civils avec mes
cigarettes, mes allumettes et mon argent,
remplacés par l'uniforme de la colonie. Je
proteste.
-
Silence.
On me mène
dans la cour, auprès de mes camarades qui
s'attroupent autour de moi.
- Un nouveau! V'la un
nouveau!
Gouailleuses,
questions et exclamations pleuvent.
J'en reste
abasourdi..
- D'où
viens-tu ? de Paris ?
- Un gros magot que
t'a volé pour qu'on t'envoie
ici?
- Quel empoté
! Il n'répond rien.
- Paysan,
va!
- Quel métier
vas-tu choisir ?
Je réponds non
sans fierté
-
Avocat.
Explosion de
rires.
- Avocat ? Et tu
viens au bagne des gosses !
- Avocat ! T'es donc
fils d'aristocrate ?
- Il est piqué
le pauv' type, loufoque à
fond.
Il en tombe de toutes
les couleurs. Les voyous parisiens n'ont pas la
langue dans une musette. Tout au long de la
soirée, ce que j'en entends! Je ne crois pas
être très naïf, très
candide, mais comme grossièreté,
comme obscénité, cela dépasse
tout ce que je peux imaginer. On est sali,
éclaboussé des pieds à la
tête. Ma réaction est
immédiate. L'humanité est
dégoûtante. Je la hais. L'hospice ?
une idylle à côté de cette
colonie de gars pourris et crachant des ignominies
à pleine bouche, à pleine gueule. Une
seule solution s'impose a moi : fuir le plus
tôt possible et n'importe
comment.
Pendant des semaines,
des mois, je suis comme assommé. je me sens
abandonné, trahi. C'est ça, la «
grande école » !
Ma seule joie est de
recevoir, de temps à autre, une lettre de
mon père adoptif. C'est le dimanche,
après la revue passée par le
directeur, qu'on distribue le courrier.
Aussitôt je m'isole et lis, relis ces lettres
débordantes de compassion, de bonté,
d'affection. Évidemment, mon père
adoptif ne sait pas dans quel milieu je suis
tombé. Et moi, par fierté absurde, je
ne lui en révèle rien, je mets une
coquetterie à tout lui cacher. Et je me
révolte de plus en plus, je maudis la vie,
les hommes qui s'ingénient à se
tourmenter les uns les autres... Pas un instant je
ne songe à m'accuser de ce qui m'arrive. je
suis une victime, une innocente victime. Seule la
bibliothèque a mon affection. Dès que
je peux, je lis n'importe quoi, assis sur les
marches de l'atelier de tonnellerie.
Pendant les heures de
classe, matin et après-midi,
j'expédie mes devoirs en vitesse, copiant le
plus possible sur mes camarades. Puis,
penché sur d'étroites bandes de
papier, j'écris tout ce qui me passe par la
tête, de vrais romans. Mon imagination bout;
au fur et à mesure que ma plume trotte,
d'autres idées surgissent et je noircis
papier sur papier accumulés dans la case de
mon pupitre. Cela ne m'empêche pas, je ne
sais vraiment pas comment, d'inscrire
régulièrement mon nom sur la table
d'honneur, soit pour le travail scolaire, soit pour
le travail manuel. Les camarades cessent de
m'importuner. Je leur parle le moins possible,
cadenassé en moi-même, mâchant
et remâchant ma haine de la
société. De la sorte une année
se passe, vivement, tant mon imagination
bouillonne.
Certain matin, au
cours d'une promenade, alors que je me trouve assez
loin de mes camarades, je m'aplatis dans le gazon,
rampe à la rencontre d'une vigne, me
redresse et détale. Je marche toute la
journée. Le soir, je demande à
coucher dans une ferme. On me reçoit
aimablement, trop aimablement, et m'offre la table
et le gîte. Au petit matin, on me
réveille, m'offre un bon déjeuner.
Après quoi, deux hommes me poussent
jusqu'à une voiture attelée, m'y font
monter. Hue, cocotte! Et je me retrouve à
Sainte-Foy-la-Grande. On avait reconnu mon uniforme
de colon. Et pour gagner la prime de vingt-cinq
francs payée à qui ramène un
évadé, plus les frais
remboursés, les deux hommes avaient
mené l'affaire rondement.
Bourru, le directeur
m'interroge.
- Tu es content de ton voyage
?
- Non, j'ai
été trahi.
- Recommenceras-tu
?
- Dès que je
le pourrai.
- Merci pour ta
franchise. Le régime de la maison ne te
plaît pas ?
- Je veux être
libre. Je n'ai jamais volé personne.
Pourquoi est-ce qu'on m'enferme dans une colonie
pénitentiaire ? Presque tous mes camarades
ont été condamnés. Moi, pas.
Alors, pourquoi, sans avoir rien fait, suis-je
« correctionnel » sous le numéro
470 ? Ce n'est pas juste. Je veux être libre.
Et faire et manger et boire ce que
j'entends.
- Tu te plains de la
nourriture
Alors, j'y vais d'un
élan, vidant tout mon sac.
- Monsieur le
directeur, voilà des mois que je suis ici.
Chaque dimanche on nous sert de la « miase
» (farine de maïs) délayée
dans de l'eau. Immangeable. Pratiquement, le
dimanche, on est au pain sec ; avec douze pruneaux,
ou douze noix ou un rien de raisiné. De
temps à autre, un bout de fromage. Alors on
a faim. Et de la salade servie à
poignées par les gardiens, une salade sans
huile; du vinaigre, par contre tant et plus ! Vous
ne seriez pas satisfait si vous n'aviez que cette
pitance sur votre table.
Le directeur devient
écarlate. Il se lève et
s'élance dans ma direction. Une canne se
trouve à portée de ma main. Je la
saisis.
- N'avancez plus. Je
me défendrai. Jamais je ne me laisserai
frapper sans riposter. Et si l'on vient contre moi
en nombre, d'une manière ou d'une autre, je
me vengerai.
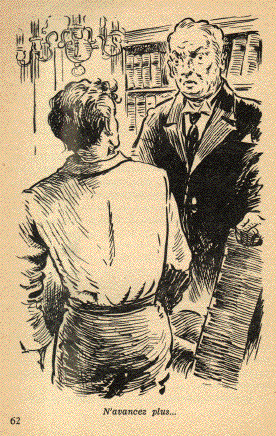
Le directeur reprend place
à son bureau.
- Ce que tu es
méchant !
- Oeil pour oeil,
dent pour dent.
- C'est du beau !
Voilà la reconnaissance que tu as pour ton
protecteur qui a le souci de trouver des amis pour
payer ta pension! Il vient de m'écrire
à ton sujet.
- Il ignore
certainement tout de cette maison, véritable
école du crime. J'aime l'alcool, c'est
entendu, mais qu'est-ce que ça,
comparé à ce que j'ai appris depuis
que je suis ici ! Oui je m'évaderai encore.
S'il y en a qui sont payés pour me faire
souffrir, moi, j'ai le devoir de fuir cette
souffrance.
Le directeur prend
une voix glaciale.
- Très bien.
J'ai écouté patiemment tes
élucubrations. Revenons à nos
moutons. Tu t'es évadé. je pourrais
t'envoyer quinze jours en cellule, mais, puisque tu
exprimes ta volonté de récidiver, ce
sera trente jours et tu porteras pendant trois mois
le pantalon des
évadés.
Cette haute
distinction consiste en un pantalon bleu d'un
côté, couleur de l'uniforme de
l'autre.
Quelques instants
après cette conversation, une porte se
referme, verrous et serrure fonctionnent. Bien
maigre, le mobilier, de quoi satisfaire un moine en
quête d'austérité: un lit en
bois scellé dans le parquet de ciment, une
planche, simili table, un banc, un seau dans une
niche. Dans le mur, une ouverture grillée
plus large que haute. Comme nourriture, une
assiette de soupe tous les deux jours. Pain sec le
matin et soir et pas lourd. On mangerait trois et
quatre fois plus. Des cachots voisins montent sans
cesse des imprécations : on crève de
faim ! Après les imprécations, les
obscénités. Parfois un rire
diabolique, suivi de cris. Lâches, brutes,
bourreaux ! On se vengera!
Un beau concert, en
vérité. Ma nature me pousse à
une sorte de sincérité dans le mal
comme dans le bien, ou l'à peu près
bien. Je n'ai jamais aimé les saletés
qui ne mènent à rien qu'à vous
égaler aux pourceaux. Mais, en ce moment,
tenaillé moi-même par la faim,
révolté par ce que je
considère comme une injustice, tous les
blasphèmes, toutes les insultes, toutes les
ordures verbales qui montent de ces cachots
m'apparaissent comme de légitimes
protestations contre les crimes ou simplement la
bêtise ou l'inconscience de la
société incapable de trouver autre
chose que le cachot et la famine pour remettre de
jeunes dévoyés, presque tous
abandonnés dès le berceau, sur le
droit chemin. Sous prétexte de les corriger,
elle les aigrit, elle les pourrit. Ah ! mon brave
père adoptif, si bon, si confiant, si vous
saviez ce que je sais, si vous entendiez ce que
j'entends ! Tapi dans mon coin, je maudis Dieu et
l'humanité.
Parfois une visite du
directeur. Le judas de la porte
s'ouvre.
- Tu penses toujours
à t'évader
- Plus que
jamais.
Les pas
s'éloignent.
Mais tout a une fin,
Les trente jours accomplis, je « remonte
» auprès de mes
camarades.
Nous recevons parfois
la visite du commandant Étienne Matter. Rien
de cassant chez ce soldat. Parce qu'il nous aime,
mais qu'avons-nous fait pour qu'il nous aime ? Il
nous comprend et sait nous parler. Tout
naturellement son coeur vient à la rencontre
de nos coeurs ; car on en a un, si perverti
soit-on. Avec une affection incroyable, il
évoque nos parents, nos amis, nos
protecteurs absents. Il nous cite des hommes
tombés très bas, plus bas que les
plus mauvais d'entre nous, et qui, repris dans leur
conscience, tourmentés dans leur âme,
ont gravi, échelon après
échelon, l'échelle du bien et sont
devenus des membres utiles de la
société. « Ne perdez jamais
courage, jamais. Beaucoup d'entre vous, je le sais,
n'ont pas eu de famille, ou ont été
abandonnés, jetés à la rue,
victime des circonstances. Ceux-là ont le
droit de se plaindre, de se révolter
même. Ce qui ne mène à rien
qu'à la chute dans le précipice. Un
seul moyen d'en sortir ; trouver en soi la force de
se relever, si meurtri soit-on ; remonter la pente
pas à pas, savoir se condamner
soi-même après avoir condamné
les autres et trouver dans cette condamnation le
secret du relèvement. »
L'énergie, la
sincérité affectueuse, la rude
simplicité de cet homme touchent les plus
rebelles. On l'écoute dans un grand silence.
Il est comme une lumière... Après son
départ nous parlons de lui avec respect.
Après quoi le milieu nous reprend. Que
reste-t-il de cette présence? Qui le dira
jamais ? Plus que nous ne le pensons
nous-mêmes.
Mon idée
à moi est qu'on ne saurait se
conquérir - c'est le mot du commandant
Matter - dans le triste milieu où nous
sommes plongés et que le premier devoir est
de le fuir. Aussi, avec cinq camarades, je
prépare une nouvelle évasion. Une
barque de pêcheur amarrée à la
rive de la Dordogne, plus ou moins
abandonnée, sera, cette fois-ci,
l'instrument de notre libération. Nous y
apportons en cachette du pain, des oeufs, un
fromage de Hollande entier, volés à
la ferme, des figues, des pruneaux, du chocolat
dont plusieurs camarades se privent pour
nous.
Une équipe,
dont je fais partie, travaille à ce moment,
sur les terres du château de Faugat. Notre
surveillant, toujours en défiance,
méchant comme un dogue, nous tient à
l'oeil. Pour faciliter notre fuite, il est entendu
que deux camarades, besognant à quelque
distance, simuleront une dispute et à grand
bruit se jetteront l'un sur l'autre. Le
surveillant, bien sûr, se précipitera
du côté des batailleurs. Pendant ce
temps les six complices
détaleront,
Tout se
déroule selon nos prévisions. Le
premier, je bondis dans l'embarcation. Les autres
font sauter le cadenas de la chaîne. «
Allez, leste! » Ils se regardent,
hésitent, tournent la tête du
côté du gardien qui accourt à
grandes enjambées. La peur les
prend.
- On ne part pas
!
- Lâches
!
À la gaffe, je
pousse le bateau au large pour prendre le courant.
bien maladroitement, car j'ignore tout de l'art
nautique. Et je sais à peine nager. Tant
pis. Arrivé au milieu du fleuve, la barque
glisse au fil de l'eau. Malheureusement - je
n'avais pas prévu ça - la Dordogne
passe devant les jardins de la colonie et le port
de Sainte-Foy. Une femme de surveillant, qui lavait
son linge, reconnaît l'uniforme du
navigateur. J'ai beau retirer ma veste au col
rouge, m'allonger sur le pont, l'appel
retentit.
Un colon
s'évade !
Aussitôt deux
mariniers sautent sur une barque et font force
d'avirons à ma suite. A l'instant où
ils me rejoignent, je me dresse,
décidé à me défendre en
vrai corsaire, à me jeter à l'eau
plutôt que de me rendre. je sors un couteau
de poche.
- Arrière! Ne
montez pas ou je vous tue!
L'un des mariniers
bondit sur le pont où je suis campé,
couteau levé. J'abats mon arme avec violence
sur la poitrine de l'ennemi. La lame, qui n'est pas
au cran d'arrêt, se rabat sur le manche en
m'entaillant profondément la main. Le second
marinier saute à son tour sur le pont de mon
bateau. Je fléchis les jarrets pour sauter
à l'eau mais des poignes de fer
m'immobilisent. Je suis vaincu. Cinq minutes
après, nous abordons. Cinq minutes encore,
et les mariniers, la prime de vingt-cinq francs
touchée, me laissent face au
directeur.
- Es-tu fou? Tu as
failli tuer un homme. Tu t'es blessé, tu as
voulu te noyer. Si jeune, chercher la mort, quelle
stupidité ! Belle liberté que la mort
! Regrettes-tu toutes ces folies ?
- Je regrette une
seule chose, d'avoir manqué mon
évasion. Plutôt la mort que cette vie
!
Le directeur faiblit
devant ma résolution
farouche.
- Ecoute. Tu as eu un
moment de folie. L'affaire en restera là si
tu me promets de renoncer à
t'évader.
- Non, encore non.
Plutôt mourir en cellule.
- Pauvre enfant ! Tu
y tiens donc tant que ça à ta
liberté ? je verrai si je peux quelque chose
pour elle. En attendant, tu ne feras que quinze
jours de cellule. Va, pauvre
garçon.
Ces mots, cette
indulgence me touchent plus que toutes les menaces.
En cellule ! Ça me
connaît.
Cette punition
achevée, je reprends ma place à
l'atelier, plus silencieux que jamais. Pendant des
mois, je vis dans une sorte
d'hébétude que les surveillants
prennent sans doute pour de la soumission. De la
tonnellerie, on me place au chai, ce qui
m'enchante, car j'ai l'occasion de boire. Mon
silence continue. On me croit dompté,
puisqu'on me nomme, un beau jour, «
frère aîné ». Ce grade,
car c'en est un, marqué par un galon rouge
sur la manche, donne certains avantages. Pendant
trois semaines, je suis donc frère
aîné. Mais, j'y
réfléchis, si je l'accepte, ce grade,
qui fait de moi une sorte de collaborateur des
surveillants, du directeur, je n'ai plus le droit,
moralement, de m'évader. On m'a «
acheté ». Ce marché ne me
plaît pas. J'entends jouer le jeu avec
franchise.
Un dimanche, je
rédige ma lettre de « démission
», je découds les galons, je les roule
dans un papier et remets le tout au directeur. Il
en prend connaissance.
- Tu es encore plus
fou que je ne pensais! Qu'est-ce que ça
signifie ?
- Un frère
aîné ne s'évade pas. Or, moi,
je veux m'évader. Ces galons ne valent pas
la liberté.
Cramoisi, le
directeur descend de son estrade et s'avance le
bras levé. Je me mets en position de
défense, prêt à la bagarre.
Mais, comme une autre fois, le directeur l'esquive.
Ces mots seulement
- Un mois de
cellule.
J'aime mieux
ça que les galons. Au cachot, au moins, je
peux en toute quiétude ruminer des projets,
échafauder des plans stimulés par les
imprécations montées des geôles
voisines. Il s'agit, désormais, de se
méfier des civils alléchés par
la prime, des colons mouchards, des lâches,
de tout et de tous. La haine me consume et, quand
le directeur ouvre le judas pour voir si je baisse
pavillon, je crie à tue-tête
:
- Jamais, jamais ! Je
m'évaderai! Je me fous des galons !
|