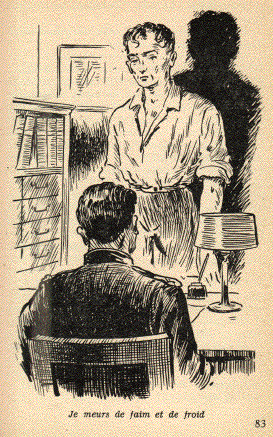La Grande Soif
CHAPITRE SEPTIÈME
Oui, libre ! En chemin de fer, dans les gares,
personne ne me surveille, ne m'espionne. À
ma guise, je peux admirer tout ce que m'offre le
voyage, des plaines aux montagnes de
l'Ardèche : ponts, torrents,
rivières, cultures, forêts, villes,
bourgs et villages. Tout m'intéresse, C'est
plus varié que les murs d'une
cellule.
Une famille de paysans m'accueille, un
peu effrayée, d'abord, de me voir si maigre,
si jaune de teint. Mais, par mon travail, je lui
prouve que la machine est tout de même en bon
état, si bien qu'au terme du second mois,
mon salaire est doublé.
Au cours de l'hiver 1900, je fais mon
instruction religieuse comme le souhaite mon
père adoptif. Deux ou trois fois par
semaine, dans la neige et le froid, je franchis les
deux kilomètres qui me séparent du
presbytère où le pasteur Eldin
m'accueille avec bonté. Mme Eldin m'offre
toujours une tasse de thé. Ce que j'entends
m'intéresse beaucoup. je lis dans la Bible
des choses magnifiques... Est-ce que j'y crois ?
Est-ce qu'elles pénètrent en moi ?
Plus ou moins. Cela dépend des jours et des
souvenirs qui me hantent... L'instruction
terminée, il faut quitter la bonne chaleur,
retrouver la neige, la bise, au bout du trajet - il
est en général onze heures - une
chambre glacée où la lueur d'une
bougie me montre des murs nus. Mais, corps et
esprit, je suis cuirassé.
À Pâques 1906,
première communion. Dès cinq heures,
ce jour-là, dans la nuit finissante, je suis
debout. Comme toujours, avec voiture et cheval, je
me rends à la ville pour livrer le lait de
la ferme. Retour hâtif, départ plus
hâtif encore pour le temple, à quatre
kilomètres. Pendant le culte, le sommeil me
tracasse. Mon nom tombe soudain du haut de la
chaire. Me voici membre actif de l'Église.
Actif ? Quel sentiment est-ce que j'éprouve?
Une grande tristesse. Mes camarades ont leurs
parents dans l'assemblée, des frères,
des soeurs. Moi, je suis absolument seul. je ne
vois que ça, ne sens que ça.
Orphelin, abandonné, pupille de l'assistance
publique, d'une colonie pénitentiaire,
voilà ce que je suis ou fus. Demain comme
hier, je serai seul.
La cérémonie
terminée, je regagne lestement la ferme, en
bel appétit. Mais il est tard, on ne m'a pas
attendu. Les patrons achèvent de festoyer
à l'étage. Pour moi, sur la table de
la cuisine, un morceau de lard, des pommes de terre
écrasées, un demi-verre de vin. je
mange, je bois seul. Et voilà que je pleure.
je voudrais aimer quelqu'un, me dévouer pour
lui. Ma sensibilité est à nu. Les
rires que j'entends, là-haut, me font mal,
cruellement mal. Ils n'auront donc pas un mot pour
moi, une attention, ces gens, le jour de
Pâques ? Je les déteste, je les envoie
au diable ... Peut-être terminerai-je la
journée par un éclat ! Heureusement,
de petits patrons du voisinage, avertis je ne sais
comment de ma détresse, m'invitent à
passer la soirée chez eux autour d'un
fraternel repas. Enfin, j'ai un peu chaud au
coeur.
Depuis ce moment, je me détache
de mes maîtres et reprends en grippe le
travail de la terre. Le café, de nouveau, me
voit souvent, alors que je m'en étais tenu
éloigné pendant mon instruction
religieuse. L'envie de voyager, de rôder ici
et là, de changer de métier, au
gré de ma fantaisie, s'empare de moi.
J'achète de la marchandise à vendre,
et adieu l'Ardèche.
Alors, fringale de déplacements
comme si je voulais me fuir moi-même. Il faut
que tout tourne et virevolte. A peine vue, une
ville me fatigue. A une autre. Quelqu'un me
plaît ? Je le quitte brusquement.
Peut-être pour me prouver que je suis enfin
libre comme l'air, que rien ni personne ne peuvent
me retenir... Marseille, Toulon, Nice, Monte-Carlo,
le nord de l'Italie, puis Paris, le nord de la
France, la Belgique, de nouveau la France. Quinze
jours ici, quinze jours là. Et tous les
métiers. À Decazeville je charge des
wagons ; sur les voies de chemin de fer je casse
des pierres pour le ballast ; je tire du sable de
la Gironde, du sel de l'étang de Berre, du
charbon des mines de Hénin-Liétard,
des poissons de la mer du Nord, au large d'Ostende;
j'actionne le soufflet du maréchal-ferrant,
je soigne des malades, passe de l'infirmerie, chez
un boucher, chez un boulanger, puis mendie un temps
pour ne pas en perdre complètement
l'habitude... Ce que j'en ai vu et appris de choses
pendant ces trois années d'errance, de
vagabondage, de métiers effleurés,
abandonnés ! Et les propos entendus, des
plus sages aux plus fous! Que de coquins, de
voyous, d'apaches, de souteneurs j'ai
coudoyés, d'égoïstes
féroces placés sur tous les
échelons de l'échelle sociale, et des
naïfs, des rêveurs, des
passionnés de justice, toute la gamme des
humains, de la brute au saint ! Je suis allé
de la cuisine raffinée à la
ratatouille de cantine; du repas sur le pouce,
devant le zinc du bistro, au grignotage d'un
croûton de pain sec ; du lit à
ressorts, dans un bon hôtel, au grabat
à punaises du café borgne, au matelas
de feuilles sèches derrière une haie.
Un jour de l'argent, trop d'argent, la noce, la
saoulerie. Puis ceinture, comme on dit. Quel
kaléidoscope, quelle ménagerie! Que
de haines, de heurts, de procès, de paroles
trompeuses entre gens tombés nus sur la
terre, qui retourneront nus dans la terre en
attendant d'y devenir poussière!
Là-dedans, parfois,
précisément là où l'on
ne le cherche pas, un type épatant, tout
coeur, tout générosité,
prêt à donner sa veste ou son quignon
de pain et qui ayant dit: « C'est pas juste !
» brave la prison, même la mort.
Dans les bas-fonds parisiens, je
rencontre des officiers de diverses armées
européennes, des ingénieurs, des
banquiers, des artistes jetés dans la plus
abjecte déchéance. par un vice qui
les tient, les suce, les pousse aux pires
extravagances. Avec eux, pour vivre ou
végéter, je ramasse des bouts de
mégots, de cigarettes, sur les grands
boulevards, aux terrasses des cafés, que je
vends chez un bistro de la place Maubert ; avec
eux, sur le Bottin, je relève des adresses
de marquis, de ducs ou de princes pour essayer de
les faire chanter et c'est sous la dictée
d'un ex-commandant de cavalerie hollandaise que
j'écris à un comte français
une lettre de mendicité où la
flatterie voisine avec la menace. Dans ce milieu
bizarre et dévergondé j'apprends tous
les trucs de la mendicité « à la
rencontre », quel genre de type il convient
d'aborder et ce qu'il faut dire: à cet
officier de marine, qu'on appartient à un
équipage de bateau marchand, mais qu'on a
raté l'embarquement ou qu'on est un
rescapé du naufrage dont il vient de lire le
récit dans le journal du matin ; à ce
petit vieux à l'air respectable, que votre
femme est morte dans la dernière catastrophe
de chemin de fer, que l'enfant est à
l'hôpital et qu'on a souvent envie de se
suicider.
Ce genre d'existence me plaît.
Sans fatigue, je gagne plus d'argent qu'un ouvrier
d'usine. Alors, à moi les apéritifs,
les petits verres de fine, les bons gueuletons !...
Et quand on n'a plus le sou, on tente fortune
ailleurs. Les voyages en chemin de fer ne
coûtent pas cher. On « brûle le
dur ». Prendre le train avec un billet de
quai, esquiver le contrôleur, prévenir
un camarade, à l'autre bout de la France, de
venir vous attendre avec le billet de quai à
la main, pour qui sait y faire, ne manque pas de
toupet, est prêt au pire, un jeu d'enfant
!
De tristes périodes, aussi, car
on n'a pas toujours la veine ; suivre, sous la
pluie, le ruban fastidieux d'une route nationale,
sauter dans un bois pour esquiver un gendarme,
coucher dans un cabanon abandonné ou sur un
palier d'escalier et se remettre en route, dans le
petit matin mouillé, en direction de nulle
part... Demander dans une maison de bonne apparence
de l'eau à boire, parce qu'on tremble de
fièvre et que la soif vous brûle, et
recevoir ce verre d'eau des mains d'une belle jeune
fille blonde aux yeux purs, s'éloigner,
emporter cette vision jusqu'à
Sainte-Menehould, où je rôde,
trempé, boueux, grelottant, vidé de
tout courage, à tel point - une fois n'est
pas coutume - que je pénètre dans le
poste de gendarmerie nationale.
- Vous voulez ?
- Manger. je meurs de faim, de froid.
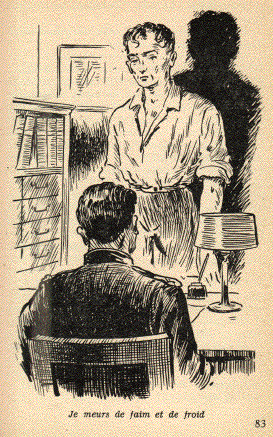
- Adressez-vous au maréchal des
logis.
Je répète : faim et
froid.
- Vos papiers? Ça va. Je ne peux
rien pour vous.
- Arrêtez-moi ? J'aurai au moins
un logis.
- Vous arrêter ? Le motif ?
Démolissez un réverbère et on
verra.
La rage au coeur, je quitte cette ville
inhospitalière. Trois coups à la
porte d'une ferme.
- Vous pouvez loger un pauvre malheureux
?
- On ne reçoit pas les
vagabonds... Suivez la route… À deux
kilomètres vous trouverez l'abri du
cantonnier.
Cet abri n'a pas de porte, sa toiture
est défoncée. je m'étends
contre la muraille du fond et reste là sans
sommeil, tremblant de froid à écouter
siffler le vent, glouglouter la pluie. Le
lendemain, mal en point, je me traîne
jusqu'à un village où un ivrogne
m'invite à boire, même à
manger. Ce poivrot a le coeur sur la main. Dire
qu'il y en a pour maudire l'alcool ? Elle serait
belle, la vie, sans lui !
- Qu'est-ce que tu fiches dans
not'patelin ? Tu viens d'où ? D'Paris ?
Retournes-y, N. de D. La campagne, c'est pas pour
des gars comme toi. Encore un coup de rouge ! Oui,
retournes-y. C'est beau, Paris.
Le poivrot parle d'or. Oui, retournons
à Paris. J'en ai marre de la campagne.
|