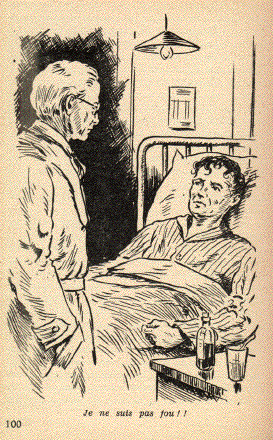La Grande Soif
CHAPITRE NEUVIÈME
Je voudrais pouvoir arrêter ici mon
récit, mais ce n'est pas un roman, c'est
l'histoire de ma vie que j'ai entreprise et je dois
aller jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte,
dans l'espoir de retenir quelques hommes sur la
pente au bas de laquelle j'ai roulé.
Ma peine terminée, la caserne me
prend, pour quelque mois seulement, car on me
réforme pour insuffisance de vue, à
Toulon, en 1905. Le régiment quitté,
me revoici, chose inattendue, à la colonie
de Sainte-Foy où je travaille au chai, en
toute liberté, bien entendu. Le directeur,
au courant de tout ce qui m'est arrivé
depuis que je l'ai quitté dans des
circonstances mouvementées, ne me
témoigne qu'intérêt et
sympathie. Je lui dois ce témoignage. Il a
fait tout l'humainement possible pour m'aider
à refaire ma vie.
D'humeur changeante, de Sainte-Foy, je
passe à Montpellier, dans un chai encore. Ce
genre d'occupation me plaît. Le vin, on l'a
sous la main et je lève le coude plus
souvent qu'à mon tour. Malheureusement pour
moi, je « porte » très bien le
vin. On me voit rarement ivre mais je suis presque
toujours allumé, parti pour la gloire, comme
on dit, toujours à chanter, à
siffler, car j'ai le vin gai. Insensiblement,
d'ivrogne occasionnel, je deviens alcoolique et
bois, en dehors du chai, absinthe, vermouth,
bitter. Il me faut du fort, du sec, du
concentré, ce qui racle la langue et pique
le gosier. À votre santé, les amis !
Et encore une tournée!
On me propose alors de partir pour la
République Argentine comme caviste dans un
vaste entrepôt de vins français.
Parfait! Je vais enfin pouvoir rouler
sérieusement ma bosse. Mais ce projet
échoue, car mes protecteurs s'y opposent
vigoureusement, craignant - ils ne me le cachent
pas - que perdu dans cette vaste Amérique du
Sud, sans appuis, sans amis, je sombre
définitivement... Assez
dépité, je quitte Montpellier pour
Bordeaux où un industriel, M. de
Graffenried, de la même trempe que mes deux
autres protecteurs, et qui s'était
déjà occupé de moi quand
j'étais colon à Sainte-Foy, me
trouvera une situation.
En route, je m'arrête à
Toulouse bien décidé, avant de
retomber sous la coupe des gens de bien, à y
faire une noce carabinée qui balaiera mon
rêve argentin. Pendant trois jours et trois
nuits, je bois presque sans arrêt. On me
relève finalement ivre-mort sur la voie
publique et l'on me transporte à
l'hôpital où des crises de delirium me
secouent furieusement. Quand inconscient, je me
débats, gesticule, crie. Enfin, après
une dizaine de jours, un calme relatif
renaît. Avant de me laisser partir, le
médecin-chef m'appelle dans son cabinet et
me lave la tête avec
véhémence.
- Vous méprisez la
société, dites-vous ? Vous feriez
mieux de vous mépriser vous-même. Les
bêtes, elles-mêmes, se conduisent mieux
que vous. Vous avez vingt ans, vous êtes
solide et vous vous détruisez comme à
plaisir. Attention ! Vous risquez gros. Au cours
d'une crise il pourra vous arriver de tuer
quelqu'un. Ou bien, vous deviendrez fou et une fin
ignoble sera votre lot. Si vous ne m'écoutez
pas, trois portes vous sont ouvertes. celle du
bagne, celle de la mort par convulsion, celle d'une
maison d'aliénés. Un beau choix,
hein? Vous êtes au bord de la catastrophe.
Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas
averti. Allez ! Si j'avais un fils qui se conduise
comme vous, je souhaiterais sa mort.
Je ne réponds rien. Et je m'en
vais, tête basse, veule, véritable
épave.
En gare de Bordeaux, constatant que je
n'ai plus que quelques francs en poche, je
décide... de les boire. À plus tard
ma visite chez M. de Graffenried. Le soir venu,
à moitié ivre, j'échoue dans
une baraque au bord de la Gironde. Je regarde
couler l'eau noire, luisante, j'écoute le
sinistre clapotis du flot contre le flanc d'un
bateau amarré près du bord.
Qu'attends-tu pour sauter dans le fleuve ? Le
courant t'emportera au diable. C'en sera fini de ta
misérable existence. Vivre comme tu vis est
pire que tout. La mort, une délivrance. La
nuit se fait moins noire. Une aube sale
apparaît dans le ciel où des nuages
blêmes se déplacent lentement. As-tu
le courage de faire le saut ?...
Un camarade longe le quai. Il me
reconnaît et m'offre un verre. Après
quoi, marchant comme un somnambule, je me
présente à l'usine où M, de
Graffenried me reçoit comme si
j'étais son fils. Lui aussi m'exhorte, me
tance affectueusement. J'écoute... Par son
entremise j'obtiens une place. Mais je me sens ou
me crois surveillé par la police et gagne le
large. Alors, pendant quelques mois, me voici dans
un hôpital de petite ville où je suis
infirmier. Bientôt l'ennui, une scène
de bamboche, une crise de cafard qui
s'achève à Paris, la ville dangereuse
entre toutes pour moi. Pendant quelques semaines,
je me dissimule, je me tiens à peu
près et même tout à
fait.
Ma conduite mérite
récompense. Je me l'accorde sous la forme
d'une saoulerie de grand style qui me jette dans
les rues titubant et vociférant. Des agents
soudain, autour de moi. Interdit de séjour !
À tout prix, il faut leur échapper.
je me débats, je m'excite, une fureur rouge
s'empare de moi, grandit encore à la prison
de la Santé, prend des proportions telles
qu'après des jours d'observation on
m'évacue sur l'asile d'aliénés
de Sainte-Anne. Là, pendant des heures, des
jours, soit auprès des malades, soit
auprès des internes, soit dans le cabinet du
médecin-chef Dr Magnin, je proteste avec
véhémence, disant, criant,
répétant la même chose:
- Moi, fou? On ne m'a pas
regardé. Maboul? À d'autres. Je ne
demande qu'à travailler librement,
honnêtement. Qu'on me lâche! Fou, moi,
maboul ?
- Dans quelles conditions avez-vous
été arrêté ?
Qu'avez-vous bu ? Comment êtes-vous
arrivé ici ?
J'ai beau me torturer les
méninges, j'ai tout oublié.
Amnésie totale... Pour me rattraper, je me
décerne d'excellents certificats.
- Moi, buveur ? Travailleur, oui. C'est
pas la même chose.
Je fais de grands gestes. Je regarde du
côté de la porte, prêt à
jouer la fille de l'air, mais les infirmiers sont
nombreux, de carrure imposante. Il n'y a
qu'à se soumettre. On m'emmène. Mais
j'explique encore:
- Moi, buveur ? Moi, fou ? Il y a
maldonne...
En attendant que décision soit
prise, bien nourri, bien soigné, je vis avec
les malades tranquilles, ou relativement
tranquilles. Va-t-on m'envoyer à
Ville-Evrard dans le service du Dr Legrain ? Non,
de Sainte-Anne je passe à l'asile de
Villejuif où je continue à jouer le
rôle du fou malgré lui. Quand je
proteste et assure que mon cerveau est en bon
état, le docteur répond avec
placidité que tout le monde est fou, au
moins cinq minutes par jour. je réponds :
« Alors enfermez tout le monde. »
À la cordonnerie, où je
travaille, plusieurs malades semblent tout à
fait normaux. Parmi eux, un homme taillé en
hercule, soigné pour épilepsie. Du
jour au lendemain, son attitude change. Il
s'enferme dans un silence triste, refuse les
cigarettes qu'on lui offre sous prétexte
qu'on cherche à l'empoisonner. Un matin,
comme il traverse la cour, une crise brutale le
saisit, touchant à la folie furieuse. De
grandes corbeilles déposées devant
les cuisines, il tire à poignées
cuillers, fourchettes, quarts, et bombarde qui
s'approche. En hâte, des infirmiers attachent
des couvertures à des pieds de chaise,
s'avancent de tous côtés ; ils cernent
le malade, le renversent à terre et le
maîtrisent ou cherchent à le
maîtriser, car le malheureux les
soulève et les secoue à bout de bras.
Après une lutte farouche, le pauvre bougre
que personne ne frappe, ne malmène, est
étroitement enserré par la camisole
de force.
À plusieurs reprises, dans la
suite, je parle avec le colosse. En dehors des
crises, son raisonnement est excellent. Mais il
souffre cruellement de se savoir malade. Il devient
de plus en plus sombre. Il se laisse aller et un
jour s'alite. Peu après, nous apprenons sa
mort.
Pour me changer les idées, je
demande à passer de la cordonnerie à
la buanderie. Là, au moins, tout est
mouvement, barboteuses, essoreuses, séchoir.
Comme chez les cordonniers, plusieurs ont, en
apparence, tout leur bon sens. D'autres, par
contre, sont en proie à des manies, ce
qu'ils disent, ils le répètent sans
fin, avec des gestes saccadés,
stéréotypés. On peut en rire,
cinq minutes, mais cela devient bien vite
hallucinant.
C'est au préau, le soir, qu'on en
voit, qu'on en entend ! Il y a les silencieux, les
angoissés au front plein de rides ; ceux qui
crient ; ceux qui découvrent des
fantômes sur les murs et les interpellent ;
ceux qui, brusquement, se mettent à courir
et s'arrêtent comme une mécanique
brisée; ceux qui se répandent en
discours pleins d'impossibilités et
d'idées folles. Moi qui me crois sain, qui
me proclame normal en temps et hors de temps,
pourrai-je résister longtemps à la
contagion ? Je me le demande avec terreur. En
vitesse, l'évasion.
S'évader, mais comment ? Partout
les gardiens sont à l'oeil, les portes
fermées et gardées. Une prison
renforcée. Pourtant, dans un certain coin de
la cour, un mur pas trop haut dont un homme leste,
à qui l'on ferait la courte échelle,
atteindrait assez aisément le sommet. Avec
prudence, je parle de la chose à un malade.
Il est d'accord. Une après-midi, me trouvant
dehors avec mon complice, l'occasion se
présente. Comme par hasard, nous voici au
pied du mur. Hop ! je mets un pied dans les mains
qui s'offrent, un autre sur une épaule
complaisante, je me ramasse pour la détente
qui me portera sur le faite. Vainement, car on
s'agrippe au bas de mon pantalon.
- Lâche-moi !
Résultat, on m'entrave les deux
jambes. Un infirmier nous a vus. Il crie: «
À l'aide! » On accourt de plu. sieurs
côtés. J'ai beau, de mon mieux, ruer
des talons, je lâche finalement prise et
tombe sur le sol. Ils étaient cinq, d'abord,
les infirmiers, ils sont une douzaine, maintenant :
« Emportons-le au quartier. » On me prend
à la tête, aux pieds, on me
soulève. Moi, je me cramponne à tous
les bras et à toutes les jambes qui se
présentent. Deux de mes adversaires
s'écroulent. je me redresse, je fais face
à la meute, les forces
décuplées, car je ne veux à
aucun prix retourner au milieu des fous...
Hélas ! Ils sont trop, mais je lutterai
jusqu'au bout. Allons-y ! J'en ceinture deux.
D'autres me tirent par les pieds. Nouvelle chute,
nouvel accrochage à des jambes, à des
bras. On me tire, on me pousse, on me traîne.
Des grappes d'hommes tombent. Il faut une bonne
heure pour franchir les trois ou quatre cents
mètres qui nous séparent de la porte
d'entrée. Ouf ! ça y est. On ne voit
que visages transpirants, bras tremblants, tant
l'effort fut grand. Quelle bagarre!
- Solide, ce type. Il recommencera. Faut
l'enfermer avec les grands agités.
Quelle réception dans le pavillon
des fous furieux! Cris de rage, hurlements de
bêtes fauves, invocations à des
personnes invisibles avec une plaintive douceur ou
des menaces haletantes. Me voici plongé dans
l'enfer du monde. On me pousse jusqu'à
l'infirmerie. Sitôt couché, on emporte
mes habits. Dormir, je le voudrais bien
après cette bataille qui m'a rompu les
membres. Impossible. Le tapage est infernal. Mes
deux voisins se lèvent continuellement pour
faire avaler à d'autres malades les plumes
ou les fils de laine arrachés au traversin
ou aux couvertures. Les infirmiers les recouchent.
Après cinq minutes, ils recommencent. Dans
un coin, on se bat. Il faut passer la camisole de
force à l'un des bagarreurs. D'ailleurs
s'élève un hideux concert
d'obscénités vomies à pleine
bouche.
Toute une semaine, je contemple cette
démence. Impossible de tomber plus bas.
C'est à mille mètres au-dessous de
l'ignoble, du dégoûtant, de l'atroce.
On a grand'peine à empêcher un
malheureux de manger ses excréments. Quand
le médecin passe, il ne prête qu'une
oreille distraite à mes plaintes, à
mes gémissements, car je souffre des
douleurs morales indicibles, à mes
protestations. « Je ne suis pas fou, moi !
» On me regarde sans répondre. On sait
bien pourquoi je suis ici, les infirmiers surtout,
et pour cause.
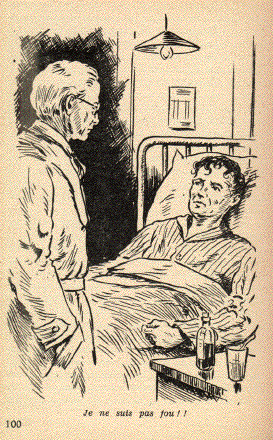
Puisque toute évasion est
désormais impossible, il n'y a qu'à
se supprimer. Dieu ? Je le maudis.
L'humanité ? Elle s'acharne sur moi. Comme
une bête nuisible, elle me jette dans un trou
empesté, dans un délire
d'insanités et de saletés.
Patiemment, je déchire des
lanières dans un de mes draps assez
usagés, je les attache, les tords, en fais
une corde terminée par un noeud coulant. Au
moment de la relève des infirmiers, il
arrive que nous soyons seuls pendant une ou deux
minutes. Quant aux déments, je suis bien
tranquille, ils ne me troubleront pas… À la
seconde favorable, je saute au bas du lit, je le
mets debout, j'attache la corde au barreau
supérieur, me hisse, engage ma tête
dans le noeud coulant et me laisse aller. Trop
tard. La clef a tourné dans la serrure et
deux infirmiers sont sur moi qui me
dégagent.
- Pourquoi se tuer ?
Je crie mon désespoir. Je
sanglote. « Je ne suis pas fou !... Pourquoi
est-ce qu'on m'enferme ici? » Dans mes cris et
mes supplications, je mets une telle ardeur, une
telle sincérité, une telle
détresse que mes « sauveurs » -
mais je les maudis de m'avoir sauvé -
paraissent touchés, malgré tout ce
qu'ils voient, entendent et endurent
quotidiennement. Ils me parlent avec bonté.
Ils s'excusent presque.
- Si l'on te met dans une cellule, c'est
pas pour te, punir, c'est pour empêcher que
tu te suicides. Demain, le médecin-chef te
verra et décidera. Viens, mon pauv' vieux
!
- J'ai soif !
On me donne à boire, on m'offre
trois cigarettes que je fume sans interruption,
assis dans cette cellule dont je ne vois rien.
Après une nuit d'insomnie, je regarde autour
de moi : quatre murs matelassés, une porte
vitrée au verre si épais qu'il est
incassable, tout en permettant de surveiller de
l'extérieur ; dans un coin un trou et une
grille aux barreaux espacés pour le tout
à l'égout ; pour lit de la paille et
une couverture piquée à la machine,
indéchirable. Les tuyaux du chauffage
central traversent la cellule.
Quand le médecin vient me voir,
je reste assis sur la paille, drapé dans la
couverture.
- Pourquoi avez-vous tenté de
vous ôter la vie ?
- Parce que je ne suis pas fou et ne
veux pas rester ici. Parce que j'y souffre trop
après tout ce que j'ai déjà
souffert. Je ne suis pas fou, docteur.
Regardez-moi, écoutez-moi, je vous en
supplie.
Un silence.
- Nous verrons ça un peu plus
tard.
- Du moins, si je pouvais lire.
- Entendu, vous aurez de la
lecture.
On m'apporte une pile de livres. Je les
dévore. Je m'y oblige pour entendre le moins
possible les agités des cellules voisines.
Celui qui est en face de moi, de l'autre
côté du couloir et que je vois
à travers la porte vitrée,
mène soudain un tapage si effroyable que je
suis bien obligé de l'écouter. Il
lance d'une voix stridente :
« Moi ! moi ! descendant des
Mérovingiens, des Carolingiens. Je suis
éternel. Je suis Jean le Bon, Richelieu,
Duguesclin, Louis XIV, Napoléon. J'ai fait
trembler l'Europe. Iéna... Austerlitz...
C'est moi, le vainqueur! On s'incline et tremble
quand on me voit... »
Le dément est campé, nu,
au milieu de sa cellule. Autour des hanches, un
ceinturon de paille auquel est suspendue une
épée tressée. Sur la
tête une couronne. Après un atroce
éclat de rire :
- Bérésina... Glace...
Retraite... Mais j'aurais la victoire !
Et il frappe du poing la
muraille.
- À moi, Cambronne! À moi,
ma vieille garde! Formez le carré! Victoire
!
Un silence.
- Moi, moi, César,
Vercingétorix! Moi, juge, avocat !
...
Des cris déchirants. Le
forcené saute sur une jambe, sur l'autre,
recule, se plie en deux, se redresse, lance les
poings dans le vide.
- Des rats, des serpents ! Au
secours!...
Couverture et paille tourbillonnent ;
contorsions effroyables de ce corps nu ; grimaces,
rictus de la figure contractée dans une
expression de souffrance inouïe. Le masque
même de la douleur au paroxysme, la totale
incarnation de la déchéance humaine.
L'homme tombe, se tord, se relève d'un bond.
Une écume blanche sort de ses lèvres.
Cris rauques. Et de nouveau la voix folle
vaticine.
- Moi, moi, Gengis-Khan, moi, Tamerlan,
moi, Télémaque, moi Mentor! J'ai
construit les pyramides d'Égypte... Oh, oh,
oh ! les rats, les serpents, oh, oh, oh !
...
Puis il s'effondre et se tortille comme
une couleuvre.
Pendant trois jours, sous mes yeux, le
dément se débat en proie aux
obsessions, aux angoisses d'effroyables tourments.
Puis un grand silence. Le delirium tremens a
tué sa victime.
Quel spectacle! Il s'en dégage
pour moi une leçon terrible qui porte plus
profond que toutes celles que l'on me prodigua et
que j'écoutais patiemment. Sur les effets de
l'alcool je suis renseigné, maintenant, par
une victime qui vient de donner sa vie en
rançon de sa passion. J'en reste tremblant,
atterré. Mon coeur et mes tempes battent.
Encore un peu de temps, si je ne réussis pas
à dompter le démon qui me
dévore, et je finirai comme l'homme nu. je
bataillerai contre des rats, des serpents, je
crierai au secours, l'écume à la
bouche. Je veux me libérer, je le veux. Je
promets, je le jure.
Un infirmier m'apprend que le mort de la
cellule voisine, entrepreneur de maçonnerie,
a connu la richesse, les honneurs, les tentations
aussi. À quoi elles l'ont mené, je le
sais.
Enfin, dans ma cellule, deux
médecins. Si je promets de renoncer à
l'évasion, au suicide, on me reprendra
à l'infirmerie.
- On va s'intéresser à
vous. Ce n'est pas le moment de
s'abandonner.
Une heure plus tard, je
pénètre dans le bureau des docteurs
qui me questionnent longuement. Ces mots, pour
terminer.
- Il vous faut une activité sur
place. Écrivez le récit de votre vie.
Nous le ferons passer dans un journal. Ça
vous occupera et sera une leçon pour pas mal
de gens et pour vous-même. Rédigez
aussi une demande d'élargissement
adressée au ministre de l'intérieur.
Cette demande, nous l'appuierons. Si tout va bien,
vous pourrez rentrer dans la circulation
normale.
« L'odyssée d'un orphelin du
XXe siècle » paraît peu
après dans le Fanion par les soins de M. de
Pressensé et de M. Bonjean, conseiller
à la Cour de cassation. Une note dit en
conclusion : « Après de telles lignes,
si cet homme a sa raison, c'est un martyr ; s'il
l'a perdue, c'est un fou sublime. »
J'espère bien n'être pas un fou,
même sublime !
Mes protecteurs, je le sais - ils me
l'écrivent travaillent aussi à ma
libération. Je suis plein d'espoir.
L'attente se prolonge. Le découragement
renaît. Tout ce que je vois et entends autour
de moi me détruit au moral et au physique.
Je décide de ne pas quitter mon lit, tant
qu'on ne m'apportera pas une réponse
favorable.
Au cours de sa visite quotidienne, le
médecin, certain jour, s'approche de
moi.
- Je sais votre décision de ne
plus vous lever. Par exception, faites-le
aujourd'hui. J'ai une communication importante pour
vous.
Me voici au bureau devant les docteurs
Collinet et Paquetet.
- Asseyez-vous. La réponse du
ministre de l'Intérieur nous est parvenue.
Soyez courageux. Il y a des coups qui sont rudes,
mais que l'on peut faire dévier. Vous
promettez d'être courageux ?
- Oui.
Alors cette note terrible dans son
laconisme :
« Réponse à la
demande de mise en liberté du sieur Paul R.
Cet homme est trop dangereux pour la
société. À garder à
perpétuité. Le ministre de
l'Intérieur : Georges Clemenceau.
»
À perpétuité ! Je
me relève et retombe sur ma chaise. La sueur
mouille mon front, des larmes coulent sur mes
joues. Quel coup de poignard ! À
perpétuité! Je murmure :
- Alors, je suis perdu. C'est
fini.
Emus, les docteurs se regardent, me
regardent. Enfin, de l'un d'eux:
- Un ministre peut revenir sur une
décision prise trop hâtivement. Restez
calme. Nous continuerons à nous
intéresser à vous. Et nous aurons de
l'aide. Renseignez votre protecteur et M. Matter.
Non, rien n'est perdu. À condition, bien
entendu, que vous promettiez de ne pas chercher
à vous évader ?
Assommé, je le promets.
J'écris aussitôt une lettre
douloureuse à M. Matter et me recouche,
tourné contre la muraille, le drap
ramené sur la tête, pour m'isoler des
déments et étouffer mes sanglots.
Rien ne peut m'arracher à mon chagrin.
À perpétuité! Et j'ai à
peine vingt et un ans..
... Que vois-je? Guidé par un
infirmier, M. Étienne Matter traverse le
pavillon des déments. Longuement ses mains
serrent les miennes. Il ne dit d'abord que: «
Mon pauvre ami ». Puis il parle. Il a eu, en
haut lieu, confirmation de la décision du
ministre. Mais une décision est
révocable.
- Les médecins plaident pour
vous. C'est énorme. En écrivant vos
mémoires, vous avez travaillé pour
votre cause. Courage! Vous sortirez de cet enfer.
Ayez confiance dans la bonté des hommes,
dans la fidélité de Dieu!
M. Matter s'exprime avec tant de
conviction, une telle lumière brille dans
ses yeux qu'un peu d'espoir renaît en moi.
Bientôt je quitte le quartier des
agités pour celui des malades paisibles
où j'aide les infirmiers. Se rendre utile,
quel soulagement à ma misère. Puis,
constamment, des lettres de mes protecteurs. Ah !
ils ne comptent pas les minutes, quand il s'agit de
m'écrire. Ils me tiennent, me soutiennent,
m'enveloppent de leur affection, moi, malheureux
entre les malheureux. Pourquoi sont-ils si bons
?
Les médecins, aussi, m'entourent
de bienveillance et les infirmiers ne me gardent
pas rancune de la bagarre qui nous mit si rudement
aux prises. Des mois passent, presque supportables,
car je sais que mon affaire est en bonne voie.
Enfin, la nouvelle, la grande nouvelle. Le ministre
est revenu sur sa décision. Hier, ce mot
pesait sur moi à m'étouffer: À
perpétuité. Aujourd'hui, ce mot qui
me rend fou... de joie: Libre.
|