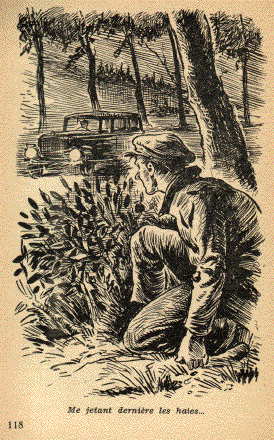La Grande Soif
CHAPITRE DIXIÈME
Paris et la liberté! je m'y enfonce avec
joie, avec délices, et pour balayer tout ce
que je viens d'endurer, tous les cris de folie dont
j'ai les oreilles retentissantes... je recommence
à boire. Par ordre administratif, je dois
quitter la capitale dans les quarante-huit heures.
Deux jours de vadrouille en compensation de mois
d'enfer, c'est bien mon droit.
Entre deux tournées de
café, je trouve le temps d'aller voir M.
Matter à son bureau. Il lui est facile de
constater que je ne suis pas
précisément à jeun. Il
m'entreprend avec vigueur.
- Quitter Paris, le plus vite possible,
pour la Belgique, soit. Si c'est pour boire,
là-bas, et rouler encore un peu plus bas,
à quoi bon ?
Pendant deux heures d'horloge,
abandonnant son travail, M. Matter argumente,
raisonne, lutte contre moi avec
opiniâtreté.
- Te modérer ? te modérer
? Cent expériences ne te suffisent donc pas
? Dès que tu as une goutte d'alcool sur le
bout de la langue, dès que tu en sens
l'odeur, tu es perdu. Sous tes yeux, dans des
conditions abominables, un malheureux meurt du
delirium. Tu es touché aux larmes,
bouleversé, d'autant plus que tu peux te
croire condamné à passer toute ta vie
dans un enfer humain... La liberté !
Aussitôt toutes les résolutions
balayées, ta bonne volonté
réduite à néant, parce que tu
t'es accordé un petit verre pour fêter
ton retour à la vie. Alors pourquoi pas un
deuxième, un troisième ? Et la roue
infernale recommence.
- Ça, c'est un cas exceptionnel.
Ce n'est pas tous les jours qu'on sort de la
boîte aux grands agités.
- On trouve toujours une raison, une
excuse.
- Quand je voudrai, demain,
après-demain, on verra bien. je
m'arrêterai net. Ou plutôt non.
L'abstinence me dégoûte. La
modération, voilà ce qu'il me faut.
Tempérant, d'accord, abstinent,
jamais.
M. Matter me regarde avec amitié,
avec tristesse.
- Mon pauvre ami, de mon mieux, je jette
la semence. Elle lèvera un jour. « Tu
réfléchiras. L'existence, certes, a
été cruelle pour toi, mais pas encore
assez pour t'arracher au vice que tu défends
avec passion, qui te brûle, te
dégrade, te tue. L'heure sonnera où
tu te rappelleras cette conversation. Dieu
permettra que ceux qui prient constamment pour toi
soient exaucés. Qui ? Tu les connais. Dans
le silence, et quoi qu'il arrive, ils
intercéderont jusqu'à ce que ton
âme soit touchée. »
J'esquisse un geste évasif. Je me
connais : abstinent, jamais. Renoncer à
l'alcool, ce dispensateur du bonheur, autant
renoncer à tout. Jamais, jamais. Je suis
secrètement et diaboliquement flatté
dans mon orgueil de tenir tête à tant
de braves gens, de les scandaliser, de les jeter
à la trace de mes aventures et de mes
chutes. Pas de bas calcul, de cynisme; Je les aime,
mes protecteurs obstinés à
opérer mon sauvetage, je leur suis
sincèrement reconnaissant de l'affection
qu'ils me prodiguent, à cause d'eux je veux
bien croire que Dieu existe et agit. Mais moi aussi
j'existe. j'entends me mener moi-même et ne
pas être mené. C'est çà,
la liberté.
M. Matter m'accompagne à la gare.
Un agent de la secrète, qui m'a pris en
filature, tourne autour de moi. Longtemps, je
séjourne à Ostende, puis à
Nice. Des lettres de mon père adoptif, de
son frère, professeur à Montpellier,
de M. Matter, de M. Jules Guex, qui avait
payé ma pension à Sainte-Foy, de M.
de Graffenried, pleuvent littéralement sur
moi. On m'assiège avec tant d'amour,
d'affection, qu'il m'arrive de me demander s'il n'y
a pas là de l'ironie. Je suis touché
et fier de susciter tant de sympathies, fier aussi
de m'entêter, d'aller mon chemin comme je
l'entends.
Après Nice, Bordeaux. Avec mon
ami Seguit je tire du sable de la Gironme au moyen
d'une drague à main. Dur travail, mais qui
rapporte et permet de boire du meilleur et du plus
fort. Mes repas, je les prends dans un café
où je suis bien vu de chacun parce que je
dépense gros, offre des tournées,
parfois même un bon dîner à
quelques malheureux. La fille des patrons, qui sert
les clients, ne m'est pas indifférente et je
ne lui suis, visiblement, pas indifférent.
Nous nous taquinons gentiment. Parfois un regard,
un mot qui échappe et laisse deviner bien
des choses, nous mettent au clair sur nos
sentiments réciproques. Je n'ai qu'à
parler pour être agréé. Les
parents, je le sais, sont d'accord. Et j'ai soif de
bonheur, de tendresse partagée. Quelle
bataille en moi! Ai-je le droit de demander la main
de cette brave et charmante jeune fille ? Car, bien
qu'élevée dans un café, elle a
de la tenue, elle sait se faire respecter et nul ne
se permet de plaisanter avec elle d'une certaine
façon... Et c'est bien cela qui me
tourmente. Ma vie cache d'affreux secrets que je ne
peux révéler à personne. Je
sais que l'alcool est mon maître. Que
deviendrai-je dans ce café, car le voeu des
parents est que je m'y installe ? Ma compagne sera
une malheureuse, une martyre. Puis, ne suis-je pas
interdit de séjour ? Les formalités
du mariage amèneront mon arrestation
immédiate. Belle entrée dans la
carrière matrimoniale! Alors, en quelques
mots, je brise ce qui avait été un
rêve et noie mon chagrin dans
l'alcool.
M. de Graffenried est au courant de
tout. Pour me sauver du désespoir et
m'arracher à moi-même, il est d'une
bonté qui me confond. Que de fois il
s'installe à côté de moi, dans
un restaurant ouvrier, pour le déjeuner.
Dès qu'il entre, un client se
précipite pour prendre et suspendre le
manteau de « Monsieur Albert ». Car pour
tous les ouvriers du quartier ce grand industriel
est « Monsieur Albert ». On ne s'offusque
pas de le voir payer, avec un humble et gracieux
sourire, soixante centimes pour son repas. On sait,
sans qu'il en parle jamais, ce qu'il donne à
l'hôpital, à la maison de
Santé, et qu'il est constamment en route
pour porter gâteries aux enfants, secours et
conseils aux parents écrasés sous le
poids de la tâche quotidienne. Chose
incroyable - je ne suis qu'un tireur de sable de la
Gironde, un bambocheur mal repenti - j'ai ma
chambre chez M. de Graffenried, rue de la
Franchise. Il nous arrive, le soir, vers neuf
heures, de nous rendre au café
Fondaudège. Lui, commande une tasse de lait
chaud, moi, mon invariable café
arrosé d'un petit verre de rhum. Il ne me
fait jamais aucun reproche. Seulement, posé
sur moi, son regard paternel... Nous regagnons
bientôt la maison en longeant les quais
où rodent les mauvais garçons du
quartier. Mais M. de Graffenried peut être
tranquille ; il ne lui arrivera jamais rien. Un
soir que je rentre seul, je suis suivi. Une voix de
rogomme lance dans la nuit: « Laisse-le, c'est
celui qui est toujours avec Monsieur Albert.
»
Soudain, ma vie prend un cours plus
agité. Pour une question de salaire
plusieurs de mes camarades sont en contestation
avec le fils d'un armateur. Une bagarre. Des coups
sont échangés. Témoin de
l'affaire je suis interpellé par la police
alertée et dois donner nom et adresse. Une
inquiétude me travaille. Bientôt un
agent de la sûreté vient me chercher
pour me conduire chez le commissaire, de là,
chez le procureur de la République.
J'affirme que je ne fus pas directement
mêlé à la bagarre.
- Je le sais. Je sais aussi que vous
travaillez honnêtement. Mais vous n'avez pas
le droit de vivre à Bordeaux, puisque vous
êtes frappé de dix ans d'interdiction
de séjour.
- C'est exact.
- À cause de votre bonne
conduite, je serai indulgent. Je vous donne
quarante-huit heures pour quitter la ville. Sinon,
je vous fais arrêter.
Ce mot m'irrite. Suis-je un voleur ? un
assassin ? N'ai-je pas été
suffisamment châtié pour une faute
sans gravité ? Va-t-on me traquer toujours
et partout, surtout aux heures où je
travaille avec courage et me rejeter sur les grands
chemins ?
Je plaide en ma faveur avec une
véhémence croissante. Que signifie
cette justice qui s'acharne sur les faibles, sur
les petits ? qui les empêche, quand ils ont
fauté, de refaire leur vie ?
Glacial, le magistrat écoute ma
plaidoirie. Quand je parle de lois iniques, il
sursaute.
- Vous avez terminé ? Dans
quarante-huit heures, si vous êtes à
Bordeaux, je vous fais arrêter.
Arrêter? Ce mot, toujours ce mot !
La colère me saute au cerveau.
- Alors, je vous tuerai !
En vérité, si j'avais
été armé, je ne sais ce qui
serait arrivé. Je viens d'avoir les cinq
minutes ou les cinq secondes de folie dont parlait
le docteur Magnin. Renversant tout sur mon passage,
je quitte précipitamment le cabinet du
magistrat.
Sans perdre une minute, je
prépare mon départ. Le soir, comme je
me glisse allée de Tourny pour me rendre
chez M. de Graffenried, deux agents de la
sûreté bondissent. Je ceinture le
premier et le jette à terre ; j'empoigne le
second et le renverse sur le premier. Les voici
tous deux sous mes genoux. La colère double
ma force peu commune. Un troisième, un
quatrième agent, en uniforme,
ceux-là, accourent, me passent les menottes
aux poignets. D'une secousse formidable, je romps
la chaîne, labourant mes poignets qui sont
rouges de sang. Une deuxième chaîne
est passée que je m'efforce de briser. Les
quatre hommes sont sur moi, maintenant. Je suis
réduit à l'impuissance.
Le lendemain matin, le substitut du
procureur - le procureur lui-même
préfère sans doute ne pas se montrer
- m'inculpe d'infraction à un
arrêté d'interdiction de
séjour, de menaces de mort à un
magistrat en fonctions et ordonne mon
incarcération au fort de Hâ.
Asile de fou ? Prison ? Qu'est-ce qui
m'attend ? Dans le doute, je me décide
à faire de la résistance passive.
Crainte de céder à un accès de
colère, de me répandre en menaces,
d'aggraver mon cas, je ne dirai rien à
personne, pas un mot, pas une syllabe, faisant
celui qui ne manifeste un peu d'activité
qu'aux heures des repas. Dans le silence, je ne
ruminerai que mieux ma vengeance.
Les gardiens du Hâ me prennent
pour une brute inconsciente. Livré aux
méditations personnelles, dans un cachot
humide et noir perdu dans les fonds d'une
arrière-cour, je mûris ma
résolution. Devant n'importe qui, se taire.
J'en prends une telle habitude, lèvres
serrées sur les dents, que devant le
tribunal, - le procureur, de nouveau, a
délégué son substitut - on a
beau me cribler de questions, je reste inerte,
muet. Pourtant, au début du
réquisitoire, excédé,
dégoûté, je me dresse pour
crier à tous ces gens : « Lâches
! » Mais le silence est si bien devenu mon lot
qu'aucun son ne s'échappe de ma bouche.
C'est mieux ainsi... Le président, les deux
juges se consultent. On m'annonce, enfin, que je
serai mis en observation en vue d'un
éventuel internement dans une maison
d'aliénés! Quel coup d'assommoir !
À perpétuité... à
perpétuité ! Ces mots sonnent
lugubrement à mes oreilles. D'une prison, on
sort, sa peine terminée. D'un asile
d'aliénés...
Deux agents me mènent à
l'hôpital Saint-André où l'on
va m'« observer » pendant quinze jours.
Les infirmiers, la religieuse, les médecins
s'évertuent à m'arracher un mot.
Peine perdue. Je les regarde. C'est tout. Par
exemple, quand apparaît M. de Graffenried ou
la bonne Mme Wolfard, quel supplice de faire comme
si l'on ne les comprend pas. Mais si je me mets
tout à coup à parler, les infirmiers
me dénonceront comme simulateur et ma
situation se compliquera encore. Continuons
à nous taire, même si mes amis me
croient devenu réellement fou.
Résultat des quinze jours
d'observation : une voiture m'emmène
à la maison d'aliénés de
Cadillac. Les sabots des chevaux sonnent sur les
pavés des bourgs. Un bruit sourd ; nous
passons sous une voûte. Quelques minutes
encore et me voici avec des malades tranquilles.
Prudemment, je recommence à parler. De mon
mieux, j'observe le règlement, je rends de
petits services, tant et si bien que je passe
à l'infirmerie comme aide-infirmier ce qui
me donne une certaine liberté. Grâce
à elle, j'étudie soigneusement les
murs d'enceinte, les portes et contemple avec une
reconnaissance anticipée la lourde et longue
échelle suspendue dans un couloir. Mais,
avant de m'en servir, il convient de savoir ce que
le médecin-chef pense de mon cas, s'il
estime que je ne dois pas faire mon deuil de la
liberté.
Quand je l'interroge, le
médecin-chef élude mes questions.
Enfin, devant mon insistance, il veut bien me
répondre. Mon dossier est sur sa table. Il
le feuillette, me regarde, feuillette encore,
secoue la tête.
- Vous étiez à Villejuif.
On est intervenu en votre faveur. On vous a
libéré. Malheureusement, la note du
ministre est restée dans votre dossier :
« Cet homme est trop dangereux pour la
société. À garder à
perpétuité. » Hem ! En
menaçant un magistrat de mort, - et quel
magistrat, un procureur de la République ! -
vous justifiez l'opinion du ministre. Tout
ça est grave, très grave...
Supposé - je n'en ai pas le droit - mais
supposé que je vous libère sans autre
et que vous mettiez votre menace à
exécution. Vous voyez ma
responsabilité ? Que l'on vous aide au
dehors - je vois que vous avez des protecteurs
actifs - en suivant les voies légales, soit.
Je ne m'y opposerai d'aucune manière.
Voilà, en toute franchise ce que je peux
faire et vous dire.
Bon. Recommençons à
regarder du côté de l'échelle.
Sinon, la perpétuité me guette.
Seulement, il s'agit, de réussir. Si l'on me
reprend, le quartier des agités m'attend et
je sais par expérience ce que cela signifie.
Chaque soir, avant de m'endormir, je mûris
les détails de mon plan, la tête sous
la couverture pour ne pas me laisser distraire par
les stupidités ressassées autour de
moi. Et j'en reviens sans cesse, pour me justifier,
à ces arguments : la société
m'a déclaré la guerre, je suis donc
en état de légitime défense ;
elle m'a, moi, homme sensé, non seulement
privé de ma liberté, mais
enfermé avec des déments ; mon
premier et du reste seul devoir est de fuir le plus
vite et le plus loin possible... Voyons maintenant
les détails de l'évasion : desceller
le barreau de fer d'une fenêtre, le long de
draps noués se laisser glisser jusqu'au sol
; s'emparer de l'échelle. Tout cela ne peut
se passer que de nuit. Mais l'infirmier qui couche
à côté de notre dortoir,
réveillé par le bruit - ces gens ont
l'oreille fine - accourra et me surprendra en
flagrant délit. Il faut donc, à tout
prix, mettre pacifiquement cet infirmier hors
d'état de nuire, mais, pour cela, des
complices sont nécessaires.
Après m'être procuré
des habits civils, j'arrive à persuader
à trois malades, choisis entre tous, qu'une
évasion est chose souhaitable. Je les
suggestionne et leur explique les moindres
détails. Jour et heure sont fixés.
Sous ma literie, les habits civils et des
cordelettes prises aux camisoles de force - elles
serviront à ficeler l'infirmier - sont
cachés. Tout est prêt.
À neuf heures, comme d'habitude,
l'infirmier-chef effectue sa ronde. À neuf
heures et demie, je frappe au petit carreau de la
chambre de l'infirmier.
- Qu'est-ce qu'il y a ?
- Un camarade est malade.
- On y va.
Entré dans le dortoir,
l'infirmier s'approche d'un de mes complices qui
simule des maux de coeur. Il n'a pas le temps de se
pencher qu'il est terrassé,
bâillonné, poignets et chevilles
liés, puis emporté comme un paquet
sur son lit où nous le laissons avec ces
paroles :
- T'en fais pas ! On ne te veut pas de
mal.
Vivement j'entortille un drap autour de
deux barreaux de fenêtre. Faisant manivelle
avec une barre de fer venue de la soute à
charbon, je tords vigoureusement le drap. Les
barreaux, rouillés, amincis par le temps, se
ploient, se rompent. Le passage est fait. La corde
de drap, préparée à l'avance,
est attachée et il n'y a plus, devant les
malades vivement intéressés
qu'à se laisser glisser. L'échelle,
décrochée, est dressée contre
la muraille d'enceinte. je grimpe le premier et
saute sans me faire aucun mal. Le premier camarade
saute à son tour. Malheur! il se foule une
cheville et reste étendu à terre. Les
deux autres, assis sur le faîte du mur,
n'osent se laisser choir dans le noir.
- Hardi, leste !
- Se casser les jambes, ça non
!
- Amenez l'échelle. Passez-la de
ce côté !
- Trop lourde.
- Zut!
Que faire avec le blessé, un
épileptique, très raisonnable en
temps normal ? Il me dit noblement:
- Te fais pas prendre à cause de
moi. Je suis fauché, toi pas, file !
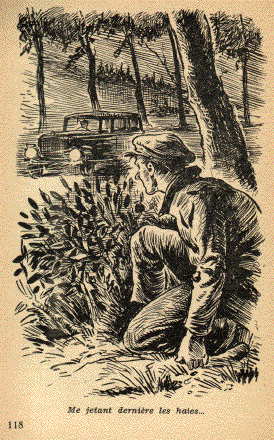
Je m'enfonce dans la nuit. Par la route de
Bordeaux, me jetant derrière les haies quand
approchent des phares d'auto, je m'éloigne
le plus vite possible du sinistre asile... L'aurore
se lève. Les maraîchers se
hâtent avec leurs voitures de légumes.
Enfin, la banlieue bordelaise. j'avance avec
précaution. Chez un coiffeur, je me fais
raser barbe et moustache. Bien malin que me
reconnaîtra ! Quand M. de Graffenried me voit
devant lui, il est effrayé de mon
audace.
-S'évader, s'évader! Tu
mets tout le monde contre toi.
Bien vite, avec sa bonté
habituelle, il met de côté les
reproches et approuve mon projet de passer en
Espagne. Il me procure un costume convenable, me
munit d'argent. Et je roule en direction du pays
des hidalgos. Tout va bien. En gare d'Hendaye, des
gendarmes parcourent le train. À celui-ci,
à celui-là, ils demandent leurs
papiers.
- Et vous?
C'est moi. je tends les papiers qu'un
camarade m'a passés.
- Pas bien ressemblant. Ce nom, c'est le
vôtre ? Où allez-vous ?
- À Irun.
- Pourquoi?
- Des affaires à régler
avec un marchand de charbon.
- Venez expliquer ça au
commissaire.
Je recommence mon histoire dans le
bureau de ce fonctionnaire qui sourit
doucement.
- Depuis quand avez-vous coupé
votre barbe, votre moustache? Vous hésitez ?
Je vais vous le dire: il y a deux jours. Et
voilà votre photographie. Vous vous
reconnaissez ?
J'ai beau crier : non ! La partie est
perdue.
- Me voilà dans l'obligation de
vous arrêter et de vous livrer au Parquet de
Bayonne... Vous souffrez ? Je comprends. Oh ! je
suis au courant de tout. Quand on vient d'où
vous venez, on a bien des excuses. Et puis, vous
n'avez fait de mal à personne. On vous en
tiendra compte.
Des gendarmes m'encadrent. De brigade en
brigade, je fais route jusqu'à Bayonne
où une cellule s'ouvre pour me recevoir.
Elle me verra pendant trois semaines, lisant,
bavardant avec le gardien-chef ou gesticulant et me
désespérant. Nombreuses lettres de
mes protecteurs, avertis de ma dernière
escapade. « L'alcool... le bon Dieu... nous ne
t'abandonnerons jamais. » Les braves gens
!
On chuchote derrière ma porte,
qui s'ouvre soudain et je reconnais trois
infirmiers de Cadillac, des costauds, surtout le
surveillant-chef des agités, connu pour sa
force herculéenne. Tapi dans le fond de la
cellule, je me prépare à la lutte,
car je préfère être
assommé que de retourner chez les fous.
L'hercule se montre diplomate. - Tu es solide,
Paul. Moi aussi. Si l'on s'accroche, il y aura du
mal de part et d'autre. Mais tu ne peux rien contre
le nombre. Nous, on obéit aux ordres.
Puisque tu as ta raison, agis en homme. On fera de
même, honnêtement.
Ces paroles me prennent par surprise, me
désarment. Les larmes aux yeux, vaincu sans
bataille, je tends les bras. On me passe la
camisole de force. Devant ma douleur muette, le
gardien-chef dit à ses camarades :
- Si cet homme est fou, on peut enfermer
le monde entier.
À Cadillac, une promotion
m'attend : du quartier des malades tranquilles, je
passe à celui des agités où
l'on m'offre la cellule la plus solide : porte,
plafond, parois bardés de fer, à la
fenêtre des barreaux énormes. Tout
autour, les glapissements et hurlements des fous
furieux.
À la première occasion, je
demande au médecin-chef quand je serai mis
en liberté.
- Au lendemain d'une évasion ?
Vous y allez fort. Pour l'instant, je ne peux rien
pour vous.
- Dans ces conditions, évitez-moi
l'humiliation de votre visite.
Quand il reparaît quinze jours
plus tard, je suis couché et me tourne vers
la muraille. je ne veux rien avoir affaire avec
personne.
Un jour, pourtant, le médecin se
penche sur moi.
- Parlons gentiment... Je comprends
votre souffrance. On vient de m'écrire
à votre sujet. Des personnes influentes
s'occupent de vous et je suis disposé
à les seconder. Demandez donc un entretien
au directeur. Expliquez-lui votre point de
vue.
Je suis ce conseil. Mais le directeur
demeure distant, indifférent. L'idée
me vient alors de m'adresser non au directeur, mais
au député-directeur. Je fais allusion
à la Commune dont il fut l'un des chefs ce
qui lui valut une condamnation à mort ; de
l'intervention d'amis qui le sauvèrent de la
fusillade du mur des Fédérés.
Et moi donc, sain d'esprit, vais-je mourir dans cet
asile d'aliénés sans que personne
s'en soucie ?
J'ai visé juste. Le directeur
pâlit. Pendant qu'il prend des notes, sa main
tremble,
- Donnez-moi votre parole d'honneur que
vous n'essayerez pas d'attenter à la vie du
procureur de la République de Bordeaux et
que, si je vous donne un peu de liberté,
vous n'en userez pas pour préparer une
évasion ?
- Le temps a effacé ma haine. Si
l'on se montre humain pour moi, je resterai
à l'asile, attendant qu'on me
libère.
Trois semaines plus tard, on m'apprend
que l'on ne peut me libérer à
Cadillac, mais que l'on va me transférer
dans une maison d'aliénés du Calvados
qui, administrativement, mettra fin à mon
internement. Trois mois après, c'est chose
faite et je franchis gaillardement le seuil du Bon
Sauveur pour m'enfoncer dans l'inconnu de la vie
retrouvée. Il ne m'est pas facile d'y
reprendre pied, car, toujours au nom du principe
des compensations, je bois plus que jamais. Tout ce
que je gagne, je le laisse chez le mastroquet. Je
vais de déchéance en
déchéance. Je n'écris plus
à mes protecteurs. je n'ose pas leur avouer
que je vidange les fosses d'une petite ville, que
mes vêtements sont en loques, que je me
nourris de mauvaise eau-de-vie' que je passe la
nuit sur un tas de chiffons, dans une cabane
délabrée, que je suis si sale, si
hirsute, si puant d'alcool et d'odeurs infectes
qu'on se détourne de moi avec
répulsion.
Après une ivresse
prolongée, le patron vidangeur qui m'occupe,
me congédie. Ça m'est prodigieusement
indifférent. Véritable brute, je
m'éloigne sans savoir où je vais.
Comme il faut bien aboutir quelque part, me voici
à Laval, crasseux, en haillons, en sabots de
bois, sans chaussette, les pieds en sang. Au moral
comme au physique, une ruine, Les enfants fuient
à mon approche. Ils ont raison. Je
déteste tout le monde. Dieu, je ne le nomme
que pour l'insulter. La vie ? Une comédie,
une saleté, une folie. Mes protecteurs ?
Ont-ils jamais existé ?
Une seule chose existe, une seule chose
compte: le tord-boyaux, le fil-en-six. Dix sous
dans la poche ? « Va bien, t'en as pour deux
verres ! »
De nouveau - je ne suis plus bon
qu'à ça - on m'embauche dans la
vidange. Même mes camarades de pompe et de
nettoyage me méprisent, tant je suis sale et
malodorant. je ne me lave plus. Pourtant, dans mon
métier, ce serait nécessaire. je loge
dans un hangar abandonné. Je me nourris de
pain, de Roquefort, de harengs salés. Jamais
rien de chaud. Comme boisson, de l'eau-de-vie.
Coeur, âme, pensée, elle tue tout.
Insensible à tout, je me fous de tout. La
fange, la boue, la puanteur, ça, ça
me connaît. Le reste, pourquoi s'en occuper ?
C'est pour les riches, les aristos...
Une nuit de travail, je suis ivre au
point de choir dans une fosse. On me chasse.
Titubant, je vais cuver mon alcool dans le hangar
où je reste, vautré, pendant trois
jours.
|