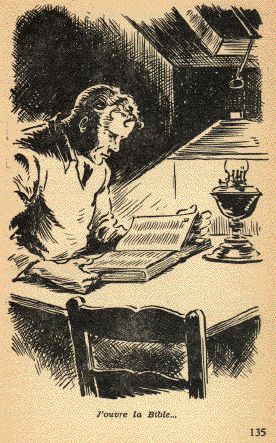La Grande Soif
CHAPITRE
DOUZIÈME
Nous arrivons de nuit
à Pontareuse et je ne peux que deviner le
site, les bâtiments.
Autour de la table se
trouvent réunis M. et Mme Piaget, leurs deux
jeunes filles et dix-sept pensionnaires
d'âges divers, tous buveurs de classe.
Fatigué, je parle peu et ne regarde
guère mes commensaux.
Le repas
terminé, le directeur lit, commente un
passage de la Bible et prie. Voilà du
nouveau pour moi. J'écoute d'une oreille
distraite et c'est avec empressement que
j'accompagne M. Piaget jusqu'au pavillon
situé à peu de distance du
bâtiment principal dont toutes les places
sont occupées. Ma chambre est au premier
étage, claire, propre. Un miracle,
après des mois de vie animale dans le hangar
disloqué de Laval.
- Bonne nuit
!
Ce voeu est presque
superflu. Après cette longue journée
de voyage et de buvaille, je m'anéantis dans
un lourd sommeil.
Le lendemain, j'ai
encore mal aux cheveux. Un de mes « camarades
» m'apporte le petit déjeuner,
abondant, excellent, et je n'apparais que vers
midi. Après le dîner, M. Piaget me
montre la propriété, admirablement
située, d'où l'on voit le lac et,
très loin, les cimes blanches des Alpes.
Chemin faisant, je suis mis au courant du
régime de la maison.
- Comme vous pourrez
le constater, notre établissement n'a rien
d'une prison. À quelques exceptions
près, nous ne recevons que des hommes qui
nous viennent librement, parce qu'ils souhaitent
trouver la force de vivre dans la
sobriété. Pas de murs, pas de haies,
pas de fossés. À quoi bon ? La grande
muraille, infranchissable, c'est la conscience de
chacun. Je veux espérer que la vôtre
parlera haut.
Ces mots me frappent.
Une muraille infranchissable qui s'appelle la
conscience? Être son propre gardien, son
propre surveillant ?
- Bien entendu,
chacun travaille ici. L'oisiveté donne de
mauvais conseils. Quel est votre métier
?
- J'en connais une
bonne douzaine. Terrassier, si vous
voulez...
Je dis ça,
parce que nous nous trouvons devant un chantier. On
agrandit de moitié la maison principale. Les
fondements seuls sont tracés. Un homme y
travaille.
- Oui, ça me
plaît. Et puis, comme ça, je vous
laisserai un souvenir de mon
séjour.
Mon compagnon est un
charpentier assez silencieux. Je lève la
pioche, j'enlève la terre avec la pelle,
puis m'arrête. Une pensée me
tourmente, me creuse. À peu de distance on
voit, en contrebas, le clocher et les toits de
Boudry. Mais ce n'est pas ça qui
m'intéresse. C'est grand, ce Boudry, un
bourg, presque une petite ville. Il y a donc des
cafés; dans ces cafés, du vin, des
liqueurs. Voilà près de deux jours
que je n'ai rien bu et mon gosier réclame ;
si je m'élançais à travers
champs, dans moins de cinq minutes la bouteille
serait sur la table. Mais ces paroles m'atteignent,
comme si on me les jetait à très
haute voix: « La grande muraille, c'est la
conscience de chacun. » Où est-elle,
cette muraille ? Elle me paraît d'autant plus
haute qu'elle est invisible.
Puisque je suis,
désormais, mon gardien, ai-je le droit de
bafouer ce métier inattendu et de
m'autoriser à prendre la fuite ? C'est
embêtant, ça, d'être son gardien
et de se trouver dans le cas, si l'on file à
travers champs, de se tromper soi-même. Je me
remets à frapper le sol de la pioche avec
une rage sourde. Un quart d'heure après,
nouvel arrêt, nouvelle discussion avec
moi-même. Encore la pioche... Encore
l'arrêt, l'affreuse lutte, accablante. Tout
près, cette maison, peut-être un
café... Ah ! comme il est plus facile de
sauter les murs des prisons !
La journée
terminée, je suis éreinté.
Mais le travail n'y est pour rien.
Le lendemain,
ça recommence. Les arrêts sont plus
fréquents encore. Constamment mon regard
saute sur les toits de Boudry, s'arrête sur
le verre et la bouteille dont je lis
l'étiquette, comme si elle était
devant moi. Les fondements sont heureusement plus
profonds et la terre rejetée me cache
presque l'horizon, puis tout à fait. Je
besogne au pied d'un haut remblai. S'il
empêche la vue, il n'empêche pas la
soif. Elle me rabote la langue. Sans cesse je
rentre à la maison pour boire du thé.
Des cinq et des six litres par jour. C'est fade.
Ça glisse sur le palais comme de l'eau
tiède. Du liquide, quand-même... Pour
me dompter, à chaque gorgée, je me
répète : « Je ne veux plus me
faire de mal. »
Depuis quand suis-je
au travail ? Douze jours. Est-ce que cette soif ne
s'éteindra pas ? De guerre lasse, je grimpe
sur le remblai et dévore des yeux l'amas des
toits bruns... Vas-y ! Es-tu bête, mon pauvre
vieux ! Dire que tu as de l'argent. Ne le sens-tu
pas ? Il te brûle la poche. Résister,
pourquoi ? Ta conscience ? Il n'y a qu'à
t'asseoir dessus. Vas-y ?... Et pourtant je n'y
vais pas.
Mais cette lutte me
tue. Je deviens sombre, je ne parle plus à
personne, même pas à M. Piaget qui met
dans ses poignées de mains, dans son regard
une confiance telle que je suis prisonnier... de
lui, bien sûr, un peu, mais surtout de
moi-même, et c'est ça le pire. Le
soir, dans ma chambre, je me maudis, j'envoie
Pontareuse au diable, je me débats contre ma
passion toujours présente qui enfonce son
aiguillon, et je finis par m'endormir la rage au
coeur.
Pour, discuter avec
moi-même le moins possible, je m'abrutis de
travail. Soir après soir j'assiste au culte,
j'écoute chant, lecture et prière. La
ferveur, la sincérité de celui qui
lit ou explique la Bible est telle qu'elle m'impose
le respect. Les sarcasmes meurent sur mes
lèvres. Je réfléchis. Tous les
détails de ma vie, à la fois
douloureuse et folle, me reviennent,
m'assiègent. Sur chacun d'eux, ou presque,
le mot alcool est gravé.
Un soir, dans ma
chambre, avec plus de curiosité que
d'intérêt, j'ouvre la Bible qu'on m'a
donnée. Mes regards tombent sur les Psaumes.
Et voilà que je ne peux plus
m'arrêter. Plusieurs, semble-t-il, ont
été écrits pour moi. Et je
relis : Aie pitié, ô Dieu, aie
pitié de moi. Mon âme se retire vers
toi, je me réfugie sous l'ombre de tes ailes
jusqu'à ce que les calamités soient
passées. Je crie au Dieu très haut,
à Dieu qui accomplit son oeuvre pour moi.
Ailleurs: Selon la grandeur de tes compassions,
efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon
iniquité et nettoie-moi de mon
péché. Car je connais mes
transgressions et mon péché est
toujours devant moi.
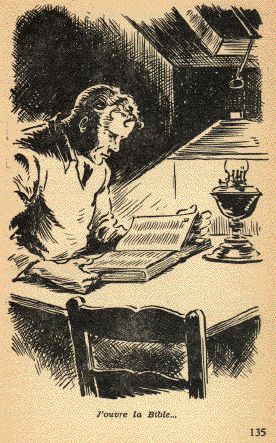
Une autre fois, je lis
l'histoire de Job qui avait eu tout le bonheur
possible. Réduit à la plus sordide
misère il n'en continue pas moins à
bénir Dieu. J'admire, mais je me reconnais
incapable d'une pareille
résignation.
La conversion de Saul
de Tarse me bouleverse. Cet homme « respirant
encore la menace et le meurtre contre les disciples
du Seigneur » est durement terrassé sur
le chemin de Damas. Autour de lui une
lumière resplendit comme un éclair.
Dompté, tremblant, il demande : «
Seigneur, que veux-tu que je fasse?» Des
écailles tombent de ses yeux. Un homme
nouveau est né qui aura la force de dire:
« Nous nous glorifions même dans les
afflictions, sachant que l'affliction produit la
patience, la patience, la vertu
éprouvée, la vertu
éprouvée, l'espérance...
» N'aurai-je donc pas, moi aussi, mon chemin
de Damas ? Cesserai-je un jour, d'être un
misérable esclave ? Une lettre de mon
père adoptif, est à portée de
ma main. Je la prends et la relis. Avec une
affection pressante il me demande, il me supplie
une fois encore de rompre avec mon passé, de
« naître de nouveau ». Alors,
j'essaye de balbutier une prière, de
demander à la force suprême de me
soutenir, d'éclairer mon esprit. Mais une
voix ricane en moi: « Tu pries, pauvre ami ?
» Quel calvaire que cette lutte qui jette l'un
contre l'autre le vieil homme, tant aimé, et
celui qui cherche à naître! Une chose,
pourtant, peu à peu, m'apparaît comme
certaine tout ne fut que stupidité et folie
dans mon existence. Ma volonté, mon
énergie, je ne les ai
déployées que pour mal faire, pour me
démolir et démolir les autres par le
mauvais exemple. Ma vérité fut
faiblesse et lâcheté. C'est
l'évidence même Mais ces mots blessent
mon orgueil, me torturent et je souffre plus que je
ne peux dire. La vérité - pas ma
vérité d'hier - me brûle comme
un feu. Que de fois je me suis évadé
des hospices, des prisons, des asiles au
péril de ma vie, pour ne plus être
prisonnier, en réalité pour me
constituer prisonnier de mon vice! Je n'arrive plus
à dormir. Le repos d'esprit n'existe plus
pour moi. Que c'est épouvantable, ce
sentiment d'être une faiblesse, une
nullité, au moment même où il
faudrait sentir en soi une force invincible
!
Vers ce
temps-là un de mes protecteurs, M. Jules
Guex, vient me voir à Pontareuse. Il a
traversé l'Allemagne et l'Italie pour me
rendre visite. Depuis des années, je le
sais, il prie pour la délivrance « de
notre pauvre Paul ». Va-t-il être
exaucé? Sa présence m'est un grand
réconfort, m'humilie aussi
profondément, car je réalise, comme
jamais encore, que depuis des années
plusieurs hommes ! - et quels hommes ! - nomment
quotidiennement dans leurs prières le
misérable ivrogne que je suis, plus ardents,
plus affectueux après chaque chute, plus
confiants après chaque tromperie. Pourquoi
cela ? Parce que Dieu vit en eux. S'ils n'y
croyaient pas, où en serais-je ? Depuis
longtemps j'aurais sombré sans laisser de
traces… À cause d'eux, par eux, Dieu cesse
soudain d'être un mot, une force lointaine
qu'on accepte un jour à moitié, qu'on
nie le lendemain. Il est près de moi, il
vit, il agit, il a pitié, il console et
relève...
Aux ronces de
l'étroit sentier que je gravis, je laisse en
lambeaux ma haine des hommes, mon orgueil. À
genoux dans ma chambre, je pleure au pied de la
croix sur laquelle le Christ saigne pour le rachat
de tous les hommes, même et surtout des plus
misérables. Du fond de mon abîme je
jette mon cri : Seigneur, aie pitié de moi !
Arrache-moi au joug de mon tyran ! Si tu te charges
de ma faiblesse pour me donner ta force, ma vie
t'appartiendrai Seigneur, aie pitié de moi
!
L'aurore pointe que
je lutte et supplie encore. Déjà un
début d'exaucement : chassant le grand vide
de la tristesse, l'espérance monte en
moi.
Un saint ? Non,
certes, un pauvre homme qui tâtonne, qui ne
croit plus guère en lui, qui cherche sa
force hors de lui, plus haut que lui. Je
m'applique, par des expériences, à
découronner cet alcool que j'ai tant
aimé et adoré. Il donne des forces!
ai-je dit mille fois après tant d'autres. Ne
buvant que de l'eau, du thé, du lait, je
charge chaque jour de nombreux tombereaux de sable
et cela par une forte chaleur. Je me rappelle les
minutes de travail fébrile après
l'absorption des petits et grands verres,
après quoi venait une sourde fatigue, un
état d'épuisement qui demandait, qui
exigeait de nouveaux verres suivis d'une nouvelle
excitation, bientôt d'une prostration que
plus rien ne pouvait éloigner. Maintenant,
plus d'efforts saccadés ; le travail suit
son cours, régulier. Sa journée
accomplie, l'homme sobre a chargé
peut-être un quart de tombereau en plus que
le buveur que j'étais.
À son
réveil le bambocheur est fatigué,
courbatu, de mauvaise humeur ; pour la chasser,
pour « tuer le ver », un coup d'alcool
est nécessaire. Il le croit, du moins, et se
rend à la besogne énervé, les
muscles en coton. Après sept heures d'un bon
sommeil l'ouvrier qui s'abstient de l'alcool, ou
n'en boit que très peu, se sent
reposé, dispos. Je le constate chaque jour.
Qui me disait cela, voici peu de temps encore, en
entendait de belles !
Parmi les
pensionnaires de Pontareuse quelques-uns, le
très petit nombre, y sont parce que leur
famille les a contraints. Ceux-là ne pensent
qu'à boire en cachette. Certes, ce n'est pas
à moi à leur jeter la pierre.
À l'occasion d'un départ, ils
organisent un dîner qu'on arrosera de vin, de
liqueurs et me demandent de prêter ma chambre
- le pavillon est à l'écart - pour
cette agape. La tentation est grande. Que faire ?
Ni dénonciateur, ni complice. Allez
où vous voudrez, sauf chez moi. Cette
première et petite victoire me donne quelque
espoir pour l'avenir.
Le domestique tombe
malade. Le directeur vient à moi
:
- Vous sentez-vous
assez fort, moralement, pour conduire à
Neuchâtel, plusieurs jours de suite, des
chargements de bois ? Ne répondez pas trop
vite. Réfléchissez !
Je
réfléchis.
- Oui, vous pouvez
compter sur moi.
Se promener seul,
loin de l'établissement, tout à fait
libre, passer devant des dizaines de cafés
sans arrêter le cheval et entrer un moment,
un tout petit moment, pour boire un petit verre,
ça, c'est une tentation ! Chaque fois, je
dois me raisonner, me raidir, presser l'allure du
cheval, tourner la tête d'un autre
côté, mais je tiens
bon.
Mon séjour
à Pontareuse se termine brusquement. Un
certain lundi matin, comme je termine le chargement
de la voiture de bois, survient le charpentier avec
lequel j'ai creusé les fondements de
l'annexe. Il rentre chez lui. Comme il est
marié, père de plusieurs enfants, on
l'autorise parfois à visiter sa famille le
dimanche. Alors, malgré ses promesses, il
boit et revient à Pontareuse de fort
méchante humeur. Tout le monde le craint,
car il est sournois et brutal. Ce lundi, dès
qu'il me voit, sans raison aucune, il me cherche
querelle. Je le prie de me laisser tranquille. Il
grommelle que les Français n'ont qu'à
rester chez eux et assaisonne son propos
d'insultes. Mon amour-propre se cabre. Je riposte
que les Français valent bien les Suisses.
Dans un subit accès de colère,
l'homme bondit et me porte un coup de la lime
à aiguiser les scies qu'il tient à la
main. J'évite l'estocade et riposte par un
direct à la figure qui expédie le
belliqueux charpentier à terre, la joue
fendue. Le directeur accourt. Les camarades,
témoins de la bataille, témoignent en
ma faveur. J'ai été provoqué,
attaqué, mais le jugement ne m'est pas
favorable.
- Le coup qui a
blessé, c'est vous qui l'avez porté.
Et vous avez eu tort de frapper si fort. Voyez
comme le malheureux saigne.
Je dois partir. Je
fais ma valise. Pendant ce temps le directeur
téléphone de côtés et
d'autres. On me recevra, pour divers travaux, dans
une campagne, Grandchamp, à trois
kilomètres de Boudry, en attendant qu'une
autre solution intervienne.
Là, je vis de
beaux jours. Mes journées achevées,
on m'autorise à me servir dans la
bibliothèque fort bien garnie, et la nuit
est souvent avancée quand je me
décide à fermer le livre que je
dévore. L'histoire des premiers
chrétiens et de la Réforme me
passionne particulièrement.
Un dimanche, avec un
camarade employé à la
préfecture de Neuchâtel, grande
excursion dans la montagne. Sur le chemin du
retour, peu avant Boudry, mon compagnon
s'arrête chez un parent et je traverse seul
le bourg.
Le café du
Lion d'Or retient mon attention. On m'a
raconté que Marat est né là.
Ayant lu je ne sais combien de livres sur la
Révolution, l'histoire du tribun m'est
familière et cela m'intéresserait
fort de visiter l'intérieur de sa maison
natale. Pour cela, il n'y a qu'à entrer et
à commander une consommation. On
accède au café par quelques marches.
Je gravis la première. Une force
intérieure m'y retient. Je fais demi-tour et
franchis une centaine de mètres. Demi-tour
encore, et me voici sur la deuxième marche.
Quelle lutte ! Des mains invisibles me poussent
vers la porte. Une seule bouteille! Personne n'en
saura rien, Qui me connaît dans ce
café ? Et Marat, t'appelle. S'il pouvait
savoir, il rirait bien de ta timidité...
Mon coeur bat
à gros coups... Je me raisonne: « Tu
étais esclave. Vas-tu te reconstituer
prisonnier ? C'était bien la peine de
batailler pendant des mois et d'appeler Dieu
à ton secours! » Je redescends les deux
marches et m'éloigne à grands pas.
Nouvel arrêt. Nouvelle discussion avec
moi-même. « Tu as fait une longue
course, tu as soif. De qui as-tu peur ? » Je
suis attiré comme par un aimant. Cette fois,
une, deux, trois marches. Avancer la main, la poser
sur la poignée de la porte, entrer d'un air
innocent, c'est tout simple. Une voix. Hein ?
Qu'est-ce qu'elle dit ? « La conscience est la
barrière infranchissable. » Et ces
gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je vois autour de
moi mes protecteurs. Ils me regardent avec
tristesse. « Vous voulez vraiment me priver de
mon plus grand plaisir ? Une fois, une
dernière fois ! » Derrière la
porte vitrée apparaît la
maîtresse de céans. Je la vois avec
ses cheveux noirs, sa bonne figure. Elle semble me
dire : À quoi rêves-tu sur cette
marche d'escalier ? Entre donc ! » Cette
invite muette produit l'effet contraire et je
m'enfuis comme un voleur jusqu'à une
fontaine où je me désaltère
à longs traits.
Peu après,
seul dans ma chambre, je relis le récit de
la tentation. Alors Jésus lut emmené
par l'Esprit dans le désert pour être
tenté par le diable... Il le mena sur une
montagne fort haute et lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire et lui dit: « je te
donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu
m'adores. » Alors Jésus lui dit: «
Arrière, Satan, car il est écrit:
« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le
serviras lui seul. » Alors le diable le
laissa.
Arrière, Satan
!... Alors le diable le laissa. Moi, quand
cessera-t-il de me tourmenter ?
Sans cesse, changeant
de visage et d'arguments, il revient à la
charge. À Perreux, dans l'asile
d'aliénés situé près de
Pontareuse, où je passe quelques semaines
comme infirmier, il est tenu en échec par la
discipline de la maison ; mais il prend sa
revanche, quand il me trouve au service d'un
entrepreneur de transports, entouré de
camarades qui tous aiment à boire. Les
occasions de vider bouteille sont multiples, les
clients ont le verre facile. D'abord, je refuse.
Les sarcasmes pleuvent: « Alors, le vin te
fait mal ? Quelle mazette ! Tu as signé la
tempé ? Tu te consacres à la tisane,
au sirop, à l'eau de fontaine. Veille-toi de
ne pas tourner à la grenouille. » Ces
quolibets me sont insupportables. Pourquoi pas un
verre ? Un second l'accompagne, un
troisième. Et chaque jour la dose augmente.
Et chaque jour, aussi, la lutte reprend en moi,
épuisante. J'ai honte de ma faiblesse, je
m'accuse d'être un trompeur, un lâche,
un hypocrite, car je n'ose avouer ma chute à
mes protecteurs.
Pour ne pas tomber
plus bas que jamais, fuyons. Et je quitte la
contrée où j'avais cru trouver la
victoire définitive, cette Suisse qui est
maintenant pour moi une seconde patrie. Adieu,
Pontareuse, et pardon !
|